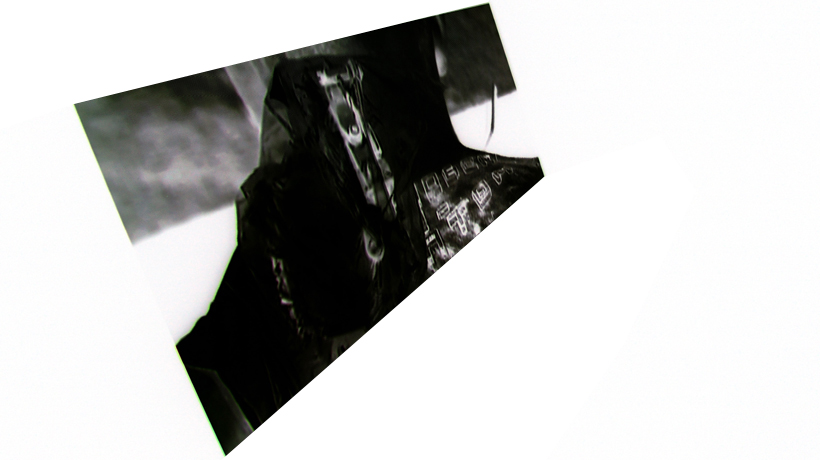press
2006 : Damien Sausset, DV, Art Press, numéro 323, avril
DV
Quelle est l’actualité de « L’homme à la caméra » le célèbre film de Dziga Vertov ? Cette question est au centre de l’exposition de TTrioreau. Initialement réalisé en 1929, le film de Dziga Vertov s’inscrivait dans une dynamique particulière : l’édification de l’union soviétique avec l’idée d’une révolution permanente. En filmant la ville d’Odessa, ses nouvelles industries et surtout l’intrusion de la modernité via le travail des ouvriers et les activités de toutes les forces vives, le cinéaste voulait donner une retranscription cinématographique des bouleversements en cours. Véritable manifeste pour une nouvelle vision ou ville et citoyens deviennent les éléments d’une possibilité d’enregistrer la vérité du monde, vérité bien plus exacte que celle perçue par l’œil humain, « L’homme à la caméra » inaugurait également des principes dynamiques de montage - « L’œil mécanique de la caméra, qui se refuse à utiliser l’œil humain comme pense-bête, recherche à tâtons dans le chaos des événements visuels, (…) le chemin de son propre mouvement ou de sa propre oscillation, et fait des expériences d’étirement du temps, de démembrement du mouvement ou au contraire d’absorption du temps en lui-même. » - Bien qu’absent de l’exposition, le film de Dziga Vertov ne cesse de hanter les deux films de 64 minutes 32 secondes que TTrioreau présente à Bourges. Le premier montre un long travelling aérien tourné de nuit au-dessus d’Odessa dans une tentative de cerner visuellement la ville. Lors de ce parcours, la caméra offre l’étrange image de vastes zones d’ombres sillonnées uniquement par le balai des phares de voiture le long des boulevards. Régulièrement, un bâtiment visiblement important (hôtels, église, mairie) car violemment éclairé vient trouer l’obscurité. Premier constat, la ville hésite. Elle n’est plus la perle soviétique symbole du communisme en marche. Elle n’est pas encore cette ville que l’Ukraine aimerait ouverte aux investissements étrangers. Ces pôles lumineux, sans véritable nécessité si ce n’est de faire signe, sont bien les marques d’une industrie capitaliste colonisatrice et déjà en train d’apposer les marques visuelles du spectacle qui lui est toujours nécessaire. Le film devient même tragique car au lieu du montage disruptif de Dziga Vertov, TTrioreau se contente d’un simple panoramique dépourvue du moindre montage. Impossible de filmer comme Dziga Vertov la monumentalité d’une ville engagée dans la révolution. Ici, l’effet de plongé la transforme en théâtre abstrait ou surgissent des formes, des lueurs, des flux, des mouvements linéaires. Dans les deux films (celui de Dziga Vertov et de TTrioreau) nous sommes bien face à un spectacle, l’un violemment engagé dans une syntaxe nouvelle alors que l’autre joue sur le registre d’une certaine objectivité, qualité qui nous le savons désormais est justement au cœur même de la définition du capitalisme comme représentation d’un ordre économique particulier. Le second film, présenté en vis-à-vis, offre l’image du dos de l’artiste tatoué par un professionnel. Lentement émerge une phrase en russe « Où est l’homme à la caméra ? », phrase par laquelle Dziga Vertov avait annoncé son film dans la Pravda. En inscrivant sur son corps cette injonction, TTrioreau propose une réflexion à double détente. Dans un premier temps, il s’interroge sur la qualité du message transmis. Son film montre évidemment que toute transmission d’information est soumise à l’entropie. Celle-ci paraît dans l’écriture cyrillique - incompréhensible - mais aussi dans le travail de tatouage ici filmé comme une maladie qui se répand et boursoufle un corps humain. L’encre suinte, dégouline comme si l’épiderme ne pouvait l’accepter. L’information s’inscrit ici dans un processus de brouillage qui en même temps devient un processus de subjectivation. La peau n’est plus un support mais le dernier rempart contre l’éparpillement des identités. Et il fallait sans doute en passer par Dziga Vertov, par cette l’illusion d’une utopie pour justement réactiver notre rapport au monde. Voilà la seconde leçon de cette exposition : puisqu’il devient impossible d’explorer le réel dans tout son hétérogénéité, l’activité artistique se doit de nouer un lien entre expérience personnelle et l’histoire collective. « Où est l’homme à la caméra ? », la sentence est une réponse au nihilisme de la célébration des valeurs. Elle les déjoue en offrant la vision simultanée d’un artiste qui se risque à prendre position comme citoyen en demandant à l’image d’être ce qu’elle n’est pas encore tout en offrant le spectacle critique d’un espace - la ville - d’où sont exclue tous les idéaux démocratiques. TTrioreau ne cesse, et ses dernières expositions à Glassbox puis au Frac des Pays de la Loire à Carquefou l’ont démontré, de s’intéresser à la ville et l’architecture comme symptômes d’un brouillage des valeurs de notre société. Ici, c’est la question même du politique qui ne cesse d’affleurer. Mais la gravité d’un tel questionnement ne pouvait qu’emprunter au cinéma sa valeur de séduction artificielle.
Damien Sausset