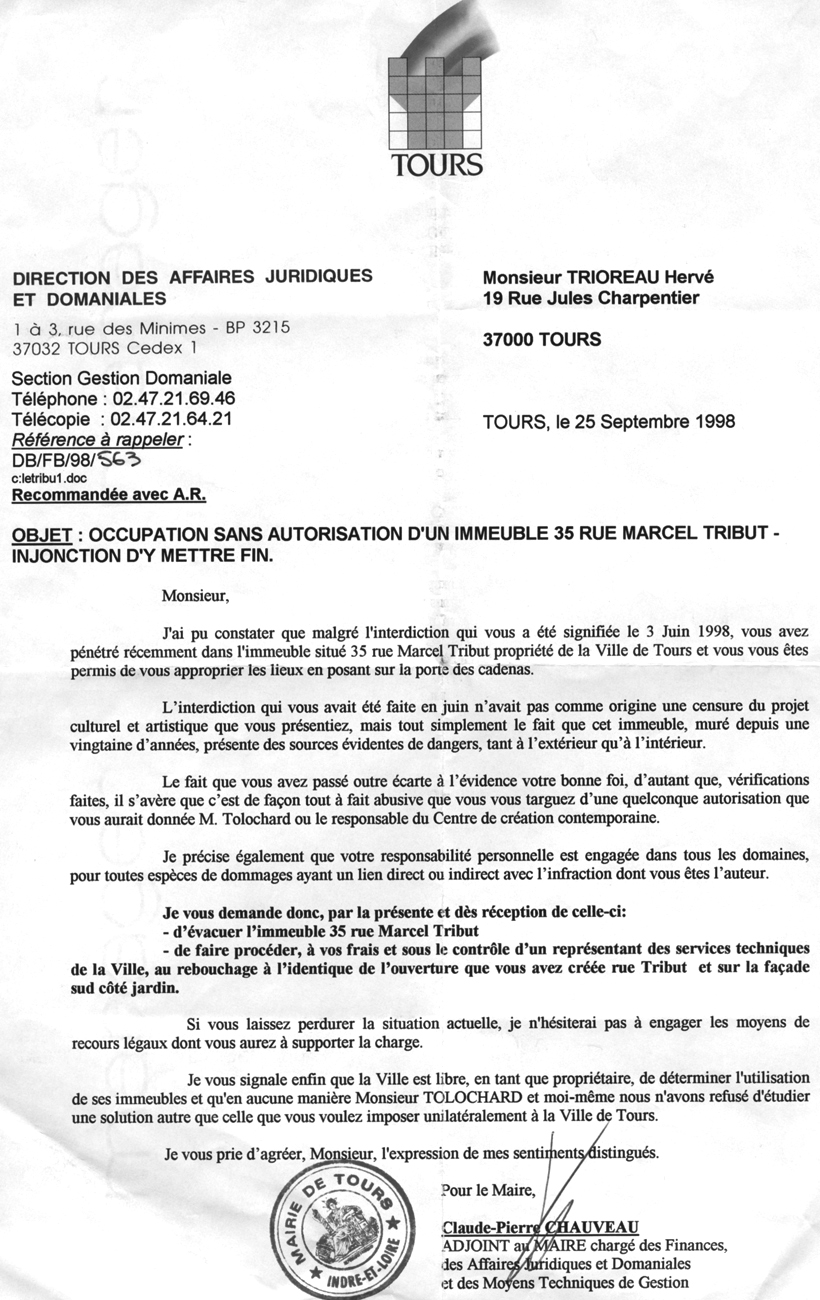press
1998 : Renaud Rémond, 35, rue Marcel Tribut, 37000 Tours, Art Présence, numéro 28, p. 18-21
35, rue Marcel Tribut, 37000 Tours
Le projet ici proposé s’inscrit dans la continuité d’un travail entamé depuis trois années dont le propos est axé sur une redéfinition du champ architectural. Aujourd’hui, nous souhaitons poursuivre notre expérimentation à travers l’investissement d’une habitation privée : une installation met en œuvre un dispositif comprenant une maquette, exacte reproduction du 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, dont les parties internes, c’est-à-dire les différentes pièces cloisonnées, sont détruites par une caméra de surveillance couleur montée sur un vérin hydraulique télescopique.
A l’opposé du premier temps de cet événement architectural suivra la mise en place d’une structure mobile (un moniteur posé sur une photocopieuse couleur) permettant la reconstitution par strates transparentes photocopiées de l’intérieur du bâtiment déconstruit.
35, rue Marcel Tribut, 37000 Tours
35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS s’ordonne comme le récit, l’archive, d’un événement qui n’a pas (encore) eu lieu : la destruction prochaine du bâtiment, site donnant son titre à l’intervention.
Première phase du récit : une caméra vidéo, posée sur un vérin hydraulique télescopique, traverse le plafond d’une maison, pour détruire à l’étage supérieur la maquette de cette même maison. Le film vidéo de la destruction est simultanément retransmis à l’extérieur, au-dessus du seuil. La seconde phase de l’installation-récit, a pour cadre l’espace d’une galerie, où sont exposées les archives de la destruction : le moniteur diffusant le film vidéo est couché sur une photocopieuse couleur qui en reproduit les images. La stratification des copies (feuilles de plastique transparentes) reproduit ainsi l’image inversée du bâtiment détruit, et forme elle-même, par entassement, une architecture-palimpseste. D’un bâtiment l’autre, la circularité du processus décrit un « devenir-image » de l’architecture, dans l’entrecroisement construction / dégradation.
L’enjeu d’une forme architecturale vouée à la destruction réside dans son caractère intermédiaire. L’intervalle entre sa disparition et l’échéance d’un immeuble à venir, à la faveur d’un réinvestissement normatif, en fait provisoirement un territoire au statut social indécis, une marge d’indétermination. Le bâtiment ne s’inscrit plus dans le réseau politique que comme vestige. Investissant cet espace, protaTTrioreau exhibent la production de structures anomales, ou irrégulières, immanente au champ de normalisation urbaine. L’architecture n’est statique que par l’identité contrôlée que celle-ci assigne. En proposant une perception alternative, l’installation l’inscrit comme processus polémique. Elle interroge notre confiance en la solidité structurelle du bâtiment, en son immobilité et sa permanence, pour la décrire comme intervalle, passage ou transition.
BATIR, PHOTOCOPIER, FILMER - La fin comme début, le début comme fin et ainsi de suite. Fin de l’installation de protaTTrioreau. Des photocopies plastiques transparentes s’amoncellent, reconstituant par strates successives le récit documenté d’une destruction et la forme d’une nouveau bloc architectural. Ces plastiques sont des reproductions : ils témoignent pour les images d’un film vidéo diffusé par un moniteur dont l’écran est placé sur la photocopieuse. Transparents, leur superposition confère à l’architecture, progressivement reconstituée, une matérialité fantomatique et provisoire. Au terme du processus, un nouveau bâtiment s’élève peu à peu dont la matière même serait la visibilité (les copies), la transparence, le récit d’une destruction.
D’UNE ARCHITECTURE, L’AUTRE - L’installation de protaTTrioreau nous projète dans la question du récit, comme processus, donc durée et narration. Première phase du récit. Une maison, 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, vouée à la destruction. C’est ici que s’opère la première temporalité de l’installation. Une caméra vidéo, posée sur un vérin hydraulique, monte à travers une pièce jusqu’à traverser le plafond percé d’une ouverture, au-dessus de laquelle, à l’étage supérieur, est posée la maquette de la maison elle-même. La caméra, par sa percée, détruit l’intérieur de la maquette, avant de redescendre. Au même moment, à l’extérieur de la maison, au-dessus du seuil, un moniteur retransmet les images filmées (travelling ascendant, destruction, travelling descendant), d’abord en temps réel, puis de façon répétée, en boucles. Première reconstitution d’un événement qui n’a pas (encore) eu lieu. Seconde phase du récit. Le film vidéo est diffusé, extrêmement ralenti, par un moniteur couché sur une photocopieuse qui en reproduit les images, selon un intervalle déterminé, sur des feuilles de plastique transparentes. Les photocopies comme autant de détails de la destruction de la maquette, s’entassent jusqu’à reconstituer l’image inversée du bâtiment détruit. Leur stratification forme une nouvelle architecture. Seconde reconstitution d’un événement qui n’a pas (encore) eu lieu. Récit, c’est-à-dire parcours, d’une architecture, l’autre.
SUPPORTS - Qu’est-ce qu’une transformation, une mutation, une dégradation ? De l’architecture urbaine à cette architecture-palimpseste, protaTTrioreau mettent en œuvre un dispositif d’entrecroisement des supports formant un réseau caractérisé par sa transversalité. La maquette, copie de la maison et représentation première dans l’installation, donne lieu à une représentation seconde : le film de sa destruction. La continuité de l’enregistrement vidéo devient ensuite elle-même la matière d’une stratification, selon un découpage photographique et, à terme, d’une reconstitution architecturale. Chaque support est ainsi successivement éprouvé, comme agressé de l’extérieur, par le jeu d’autres supports, déplaçant respectivement leurs propres frontières. Déplacer le support comme territoire stable et assignable de la représentation, c’est, d’un même geste, confronter les matérialités multiples (maquette, vidéo, photocopies plastiques …) à leur propre épuisement, à leur propre extériorité. Au lieu d’un territoire ou d’une carte, un trajet et un mouvement. De l’architecture à l’architecture, la répétition est la fin d’un réseau de déformations multiples. Pour protaTTrioreau, les supports de la représentation ne s’inscrivent plus que comme moments provisoires et dynamiques d’un processus opératoire, chacun na valant plus que relativement au traitement dégradé dont il est capable. Il va sans dire que, dans cette stratégie d’agressions des différents supports, le processus est polémique, dont la matière même fonctionne comme conflits, destructions, différences. Toute représentation est à ce titre violence, déformation. Remettant radicalement en cause l’espace urbain comme réseau statique, il s’agit, 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, de déplacer notre confiance en la solidité structurelle de l’architecture. La matérialité même du site est rendue, ductile, à une multiplicité qui est aussi fragilité et épuisement. L’installation déploie ainsi un processus polémique de volatilisation des supports. D’une part, volatilisation dans l’acception de « fragilisation » matérielle : d’une structure « lourde » et immobile (la maison) vers une architecture-fantôme, dont la seule matérialité serait légèreté, transition, transition et visibilité. D’une clôture privative et opaque à une transparence ténue, décrivant un devenir-image de l’architecture et de la matière. Au terme : un bâtiment transitoire et qui ne renvoie plus qu’à ce qui le hante ; une construction qui ne se constituerait que comme regard. Mais il faut aussi entendre cette volatilisation matérielle comme épuisement : l’échéance d’une disparition. Le dispositif opératoire de protaTTrioreau s’ordonne comme récit d’une destruction à venir. De même qu’il interroge la pesanteur statique de l’architecture urbaine, il déplace la question de sa permanence, de sa durée. Cette architecture n’est que provisoire : elle est passage et transition.
VITESSES - A cet entrecroisement des supports répond la multiplicité des vitesses de l’installation-récit. La durée qu’elle déploie est composée de péripéties, de micro-récits (l’aventure des différents supports), inscrivant dans le procès de la représentation des intensités successives : ralentissements, accélérations. La vitesse propre à l’installation, celle qui confère sa temporalité générale, se manifeste comme stratégie de lenteur (et ce dès le début de l’installation : lenteur du travelling). Pourtant, sous cette impression initiale, se noue une superposition de rythmes plus complexes. Chaque représentation a sa durée, sa vitesse singulière. L’immobilité initiale de la maquette répond ainsi à ce dont elle est la copie. Le processus de mobilité est introduit dans le dispositif par une représentation seconde : l’enregistrement vidéo, lequel, malgré sa lenteur relative, consiste déjà en une accélération. Mais l’événement représenté spécifiquement par la vidéo est la destruction de la maquette : laquelle, en terme de temporalité et comparativement à sa représentation dans la durée de l’enregistrement, se donne comme brièveté, rapidité. Aussi le film vidéo, bien qu’introduisant la mobilité, consiste essentiellement en une décélération. Si toute représentation est déformation, la violence est ici tant matérielle que temporelle : le rapport de l’événement à l’instance qui le décrit est espacement, étirement d’une durée. Suit une seconde décélération : la vidéo est elle-même ralentie, l’installation atteignant tout à la fois son seuil minimal de vitesse et l’inflexion critique maximale du récit. Il s’agit d’affecter la mobilité d’une pathologie d’inertie, d’étirement. Quel seuil d’épuisement la durée narrative peut-elle tolérer (comme on expérimenterait de quels affects un corps est capable) ? La continuité du processus, par ce ralentissement, subit donc un premier traitement agressif : elle semble comme empêchée. Le va-et-vient rythmique de la photocopieuse forme ensuite une nouvelle courbe ascendante d’accélération. Mais l’installation connaît là, au sein du réseau des représentations, une nouvelle déformation critique de la vitesse : fragmentation répétitive du continuum filmique. Ainsi, c’est l’ensemble du dispositif qui se constitue comme hétérogénéité conflictuelle de durées. La temporalité générale est une ligne brisée faîte de ruptures intensives. Est-ce encore un récit, dans cette stratégie conflictuelle d’hétérogénéités multiples ? Certes, ces déformations fonctionnent comme autant d’agressions extérieures à la durée initiale, mais ces vitesses singulières se modifient réciproquement et, partant, se traversent et se recomposent entre elles. Aussi ne faut-il parler, à propos de 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, que d’unité et de continuité problématiques. Le récit n’est plus une totalité, mais une composition d’hétérogénéités dont les ruptures sont offertes à la béance de la visibilité. L’installation de protaTTrioreau refuse toute préséance tant au point de vue « unité / continuité » qu’à celui « fragmentation / discontinuité ». L’un et l’autre s’affectent intimement : la fragmentation est une composition, de même que le découpage est un montage (au sens cinématographique du terme). Singuliers, les micro-récits tout à la fois construisent et dégradent le processus en son entier, et jouent comme autant de perturbations constitutives. L’unité du processus est laissée béante, ou problématique : ainsi la seconde partie de l’installation (la photocopieuse) peut légitimement être vue indépendamment du site 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, quoique n’étant qu’un détail de 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS. De l’architecture à l’architecture, le dispositif fonctionne simultanément comme composition et possible décomposition, unité et séparation, au sein d’un réseau polyphonique et relationnel de vitesses multiples.
LES 24 VERITES DECOUPEES - De la vidéo-surveillance au champ cinématographique, de la photocopie à la photographie, du découpage au montage : digression à propos du groupe Dziga Vertov. Le film de 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS voit sa continuité fragmentée image par image, décomposition qui est simultanément, reconstitution d’une forme, d’une architecture de visibilité. Dans PRAVDA, il est dit : « Mettre un son juste sur une image fausse, pour retrouver une image juste », phrase ensuite corrigée par VENT D’EST : « Non pas une image juste, mais juste une image ». Tout montage (collure) est découpage (rupture). Faire du montage-enchaînement de deux images, une technique stratégique du conflit, comme les connections disjonctives d’un son et d’une image pour JLG. Opposer au récit comme totalité la juxtaposition découpée d’éléments hétérogènes, comme autant de particules locales et rivales. « Vingt-quatre fois la vérité par seconde », c’est alors cette décomposition de la continuité filmique en ses éléments photographiques. L’image n’est plus juste, mais le détail d’une multiplicité découpée.
ESPACE INTERMEDIAIRE - Le traitement des supports et les vitesses distinctes au sein d’un même dispositif, permet à celui-ci, outre de se constituer comme récit, de penser la transition. On l’a dit, le site de l’installation, 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, est voué à la destruction. Il s’agit pour protaTTrioreau d’accompagner cette transformation, d’en inscrire la mémoire. L’enjeu de la forme architecturale urbaine, la maison dont la clôture privative est de part en part réglée par les normes sociales et juridiques, réside dans son caractère intermédiaire. L’intervalle entre sa destruction et l’échéance d’un immeuble à venir, à la faveur d’un réinvestissement normatif, en fait provisoirement un territoire sans réel statut social et qui ne s’inscrit plus dans le réseau urbain et politique que comme vestige. Un tel espace est alors offert à la possibilité d’un détournement. L’installation met en œuvre, à l’intérieur du champ de normalité qu’est par excellence l’espace urbain, des propositions alternatives en investissant les marges d’indétermination de ce territoire. L’architecture n’est statique que par l’identité contrôlée que lui assigne un champ de normalisation politique. La fixation de cette identité a pour effet la dénégation de tout mouvement, de tout événement, qui dès lors ne pourront avoir lieu qu’à l’occasion d’une destruction / reconstitution.
LA PRESEANCE INVERSEE : LE RECIT - La question ouverte par 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS est celle d’un récit problématique. Un récit, c’est-à-dire à la fois une durée (séquences temporelles) et un trajet (déplacements topographiques). Quels en sont les lieux ? protaTTrioreau proposent la connexion d’un lieu proprement dit (la maison) à un événement (la destruction de la maquette), puis au récit de ce lieu et de cet événement (l’archive, la mémoire). Interrogeant la question du récit, le dispositif nous en montre les ruptures constitutives, partant l’unité problématique. La dernière phase de l’installation peut ainsi être vue indépendamment de ce qui la précède (le site de la destruction), dont elle demeure pourtant le prolongement. Détail singulier de l’ensemble du processus, elle y introduit une discontinuité interne, en pouvant fonctionner séparément du reste, selon une temporalité et une spatialité distinctes. Une possible fragmentation est maintenue dans l’installation-récit. Ce qui, dans la totalité du processus, est continuité, reprise et mémoire, peut légitimement s’ordonner comme singularité, autonomie et événement. Mais protaTTrioreau rendent le récit problématique en un sens plus souverain encore, par l’exposition des documents d’un événement imminent. Quelque chose a (déjà) eu lieu : la destruction de la maquette. Quelque chose n’a pas (encore) eu lieu : la destruction de la maison. Il nous faut alors admettre les paradoxes d’une temporalisation à rebours pour nous tenir face à l’exacte mesure de la liaison événement / représentation. Qu’est-ce qu’un récit ? Le récit est toujours récit d’un événement, cependant il faut immédiatement ajouter que sans récit l’événement n’a pas (eu) lieu. Il n’a pas de lieu de l’événement (en tant que ce qui est passé) est son propre récit. La mémoire mise en œuvre par l’installation 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS s’avère proprement fantomatique, ou fondée sur un pas encore, à l’image de l’architecture-palimpseste finale. Il s’agit d’une représentation sans objet, ou plus exactement de l’inversion du rapport réalité / représentation. Pour que l’événementialité ait eu lieu et s’articule dans un récit, elle doit paradoxalement présupposer sa reprise, sa mémoire. Autrement dit, l’événement « sort » du récit. Reconstitution d’une destruction qui n’a pas (encore) eu lieu, 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS décrit ce mouvement : la préséance inversée du récit sur la réalité qu’il inscrit. Le partage entre l’original et sa duplication est déplacé : dans le processus dynamique de leur préséance inversée, c’est tout aussi bien l’événement « réel » qui fonctionne comme duplication de son propre simulacre. Dans la lignée successive des copies de l’installation, l’original n’a de consistance que fantomatique, et sa copie soit-disant fictive devient elle-même l’événement, que « l’original » imitera.
UN REBUS - Trois instances, donc : le lieu, l’événement (avoir-lieu), le récit (avoir-eu-lieu), dont il faut décrire la circulation, les connexions et les ruptures. Détour par Mallarmé considéré comme un rébus. « Rien n’aura eu lieu que le lieu ». Comment comprendre cette énigmatique formule ? Elle ne peut revenir au « Seul est le lieu », où celui-ci, présence immédiatement donnée, se dispenserait de toute médiation-récit (équivalent : le lieu est lieu). De même : « Le lieu a eu lieu », où s’exprime la fausse préséance du lieu sur son récit différé. On l’a dit, la reprise précède l’événement. Pourtant, « Le lieu n’a eu lieu que comme avoir eu lieu » ne convient pas non plus, où se dit la préséance inversée du récit sur le lieu. « Rien n’aura eu lieu que le lieu » : ce qu’il faut entendre ici, et où le lieu est enfin pensé comme événement, c’est : « Le lieu n’a eu lieu que comme aura eu lieu ». Par l’utilisation du futur antérieur, et non d’un infinitif passé, le récit n’a plus de préséance sur ce qu’il décrit (ce qui, loin de le dépasser, se contente d’inverser, en le conservant, le partage traditionnel entre l’original et sa copie). Le récit est en fait synthèse disjonctive entre un déjà là et un pas encore. Il n’annonce qu’autant qu’il remémore. Il est, de façon indécidable, fuite et fidélité. Aucune préséance ne s’exprime plus, dans l’exacte contemporanéité de l’événement et sa mémoire.
CIRCULARITE SIMULTANEE - Le récit est toujours récit de l’événement : archive. 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, la forme architecturale finale est la reprise, ou la reconstitution d’un événement passé, par entassement de documents. Mais, réciproquement, l’événement n’a eu lieu que dans sa copie, et devient lui-même la reprise paradoxale de son propre simulacre. L’installation de protaTTrioreau est le récit d’un événement dont l’imminence peut donc apparaître à la fois comme (encore) future et (déjà) antérieure. Le récit traverse l’événement comme l’événement traverse le récit : loin de toute préséance, l’un et l’autre n’apparaissent qu’à travers cette relation simultanée l’un sur l’autre. Quelque chose, reconstitué, n’a pas (encore) eu lieu ; mais, par effet de boucle, ce quelque chose a trouvé son lieu comme récit, et a ainsi (déjà) eu lieu par avance, dans le jeu de sa répétition anticipée. 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, le simulacre n’imite donc pas davantage l’événement, que l’événement n’imite le simulacre, dans ce lien d’auto-constitution circulaire et simultanée. Lorsque se forme, au terme du dispositif de protaTTrioreau, un nouveau bâtiment de feuilles plastiques transparentes, sa texture même peut être dite fantomatique, c’est-à-dire revenante, quoique pas encore venue. »
Renaud Rémond