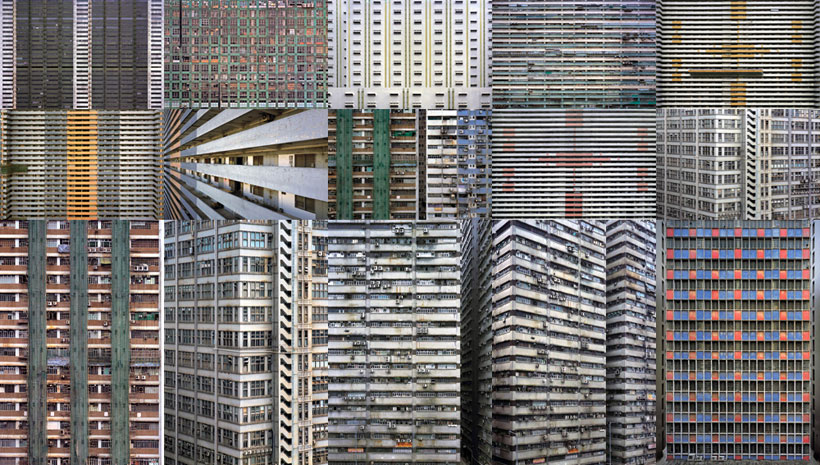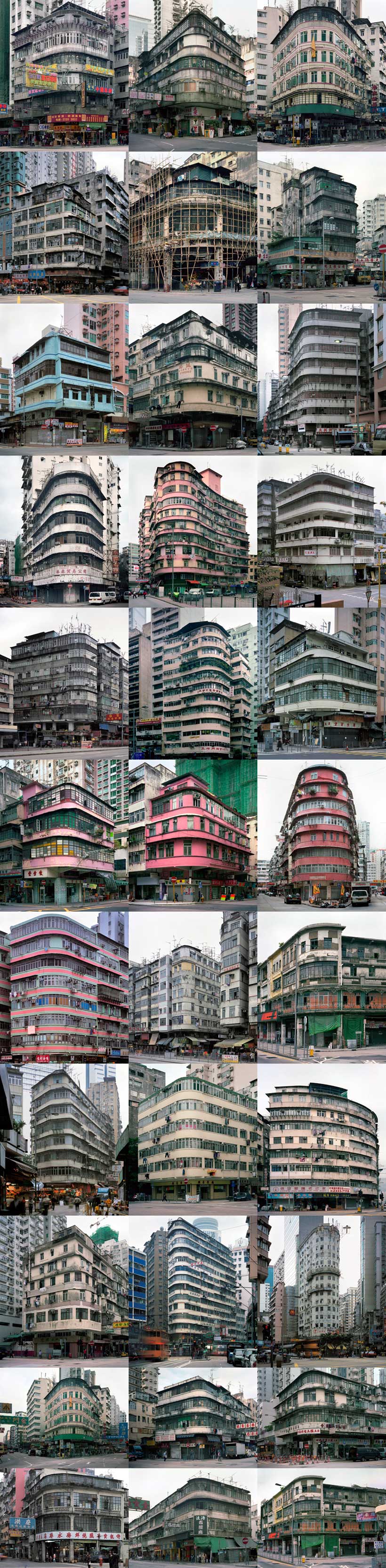texts
TTrioreau - Hervé Trioreau / 1995 - 2007
Ses propositions s’inscrivent dans une réflexion liée à la nature du réseau urbain. Ses installations agissent sur la structure même de l’espace construit. Elles mettent en place des déplacements qui en perturbent notre perception et désignent de façon politique le caractère normatif de l’architecture. Son travail intervient dans les intervalles urbains ; il établit des jonctions dans les rapports intériorité / extériorité. Prenant en compte les enjeux liés à l’urbanisme, et ne visant pas à la seule représentation, il crée nécessairement « in situ » et principalement hors des lieux d’exposition. TTrioreau, se concentre sur l'analyse des structures du tissu urbain. Ses interventions dans l'état des choses en architecture sont souvent très radicales et contraires aux idées établies sur le rôle et le sens du domaine de construction. Dans son système des transformations, le dedans et le dehors ne représentent que deux notions relatives, ainsi que le rapport entre le tout et le détail, entre l'espace réel et l'espace imaginaire. Là où l'on construit, on démolit également : la ville et les bâtiments sont des variables soumises à la logique du marché. Les édifices perdent leur caractère prestigieux de création architecturale pour devenir juste une bonne occasion pour l'investissement du capital qui, au moment où il ne rapportera plus, se déplacera ailleurs en laissant ces maisons se dégrader. Seuls les documents et les maquettes résistent à ces manipulations du marché. Les dispositifs de TTrioreau agissent sur les zones urbaines, sur leurs murs et leur mémoire. Cherchant à inclure tous les possibles ou devenirs, il crée des territoires hybrides qui se constituent par défaut ou hégémonie et mettent le corps à l’épreuve en le privant des partitions habituelles. Ce sont des espaces transgressés ou transgressifs qui n’offrent pas d’équilibre définitif puisque la limite s’estompe au profit de l’interférence. Si le changement paraît toujours imminent, il est en réalité déjà effectif : sans véritable lieu d’existence, il investit l’ensemble d’un territoire, le transforme en une zone hybride d’où les frontières se retirent. TTrioreau exhibe la production de structures anomales, immanente au champ de normalisation urbaine. L'architecture n'est statique que par l'identité contrôlée que celle-ci assigne. En proposant une perspective alternative, l'installation l'inscrit comme processus polémique. Elle interroge notre confiance en la solidité structurelle du bâtiment, en son immobilité et sa permanence, pour le décrire comme intervalle, passage, transition…
La formation de compromis
[…] Le XIXème et surtout le XXème siècle sont riches d’interrogations sur la perception de la réalité. Mais, ce qui semble inédit, c’est cette volonté de convoquer la sphère de l’intime (souvent sur un mode faussement psychanalytique) tout en jouant sur la qualité de l’information transmise (ou sur son brouillage). L’idéal bourgeois d’un espace public, idéal forgé au temps des Lumières et qui présupposait que l’articulation entre espace public et espace privé permettait justement l’autonomisation et l’émancipation de l’individu, cet idéal donc avait définitivement vécu. C’est à partir de ce constat que travaille TTrioreau – avec son dépeçage méthodique des idéaux liés à l’espace public moderne. […]
Damien Sausset, La formation de compromis, La scène française, Art Press 2, p. 114-125, numéro 01, mai-juin-juillet 2006
Du monument au document
Comment qualifier l’espace urbain à l’heure du junkspace et de la ville générique de Rem Koolhaas, ou encore des expériences de l’« art contextuel » ? La ville n’est-elle que le produit d’une série de phénomènes chaotiques, soumise à une flexibilité, une mobilité permanentes, sans fondation possible ? Quel statut a l’espace public ?
L’espace de la ville apparaît en effet comme un palimpseste d’objets autonomes qui entretiennent avec le territoire des relations éphémères et dont les usages et les fonctions changent.
S’il n’y a plus de fondations, si l’espace privé ne cesse d’envahir l’espace public, si le consensus n’est plus possible, que serait un monument contemporain dans l’espace urbain ? De quelles valeurs serait-il le véhicule ?
Pourrait-il nous aider à penser la fondation à nouveau, autrement ?
L’usure de l’espace public
L’envahissement par la technique
Les villes actuelles sont peuplées des restes de la révolution industrielle du XIXe siècle. Il faut s’arrêter un moment sur cette naissance, lorsque les anciennes formes de travail ont été écrasées par le travail à but économique né de l’industrialisme : le travail rémunéré, par lequel nous acquérons une identité sociale, une place dans le système social et économique. Le travail est considéré comme un devoir moral, une obligation sociale. Une idéologie du travail se met en place, qui tient pour acquis que plus chacun travaille, mieux tout le monde s’en trouve, tandis que ceux qui travaillent peu ou pas portent un préjudice à la collectivité et ne méritent pas d’en être membres.
La technique apparaît dans sa forme moderne en même temps que l’avènement des sociétés industrielles capitalistes : le travail est lié à l’idée de technique, de technicité, il est spécialisé. Travailler dans le système moderne, c’est mettre en valeur sa capacité à utiliser et à savoir optimiser une technique donnée, c’est augmenter toujours plus ses compétences. La science économique régit et standardise l’ensemble des activités humaines.
Cet envahissement est une naturalisation. Technique et travail agissent en effet comme des nouvelles formes de naturalisation : asservissement de l’homme, soumission à la rationalité économique (rendement, performance, rentabilité, productivité, automatisation…). La technique apparaît comme un nouvel instrument de domination. L’homme instrumentalisant s’est substitué à l’homme pensant et agissant. Tout est moyen en vue d’une fin, tout est surenchère : « le progrès technique produit lui-même, en même temps que des méthodes qu’on n’a pas prévues, aussi les finalités d’emploi qui n’ont pas non plus été planifiées » . On ne fait plus de distinction entre les différentes formes de relations à la technique. Et ainsi s’organise cette « civilisation froide » dont les « rapports froids, fonctionnels, calculés, formalisés, font des individus vivants des étrangers au monde réifié qui est pourtant leur produit, et où une formidable inventivité technique va de pair avec le dépérissement de l’art de vivre, de la communicativité, de la spontanéité » .
L’envahissement par le privé
Le « privé » s’incarne dans la domination de la vie quotidienne, dans ce moment où l’espace public devient entièrement dévolu à ses satisfactions.
Le « privé », c’est aussi l’exaltation de l’individualité, de l’individualisme.
Des artistes ont fortement contribué à répondre à cet envahissement, en introduisant de nouveaux modes de questionnement de l’espace public : c’est l’exemple de Sylvie Blocher qui, parce qu’elle interroge sans relâche les liens entre sphère privée et sphère publique dans son travail, propose également une nouvelle définition de l’idée d’autorité. Autorité qui, elle-même, pourrait nous guider vers une nouvelle définition du monument…
10 minutes de liberté, Living pictures, 1998-2002
A l’invitation d’un enseignant d’un collège d’une banlieue du Nord de la France, l’artiste fait la proposition suivante : cinq cents personnes de l’établissement, élèves, enseignants, personnels administratifs et techniques, etc., sont invités à écrire une phrase concernant quelque chose qu’ils gardent habituellement sous silence, phrase qui sera ensuite imprimée sur un tee-shirt. Il s’agit de « tester notre propre distance face à la liberté ». Tout reste secret jusqu’à ce jour où chacun enfile son tee-shirt et se retrouve dans la cour du collège, au moment de la récréation. Puis, Sylvie Blocher propose à chacun d’être filmé, restant le temps qu’il souhaite face à la caméra, avec comme seule contrainte de mettre de l’autre côté de la caméra, fictivement, un visage ami ou ennemi. Une certaine idée de l’intime, du privé, se dégage de la proposition de l’artiste : pas le privé au sens de ce qui se réduit à la vie biologique, soumise à la reproduction des mêmes gestes (manger, se reproduire) ; pas celle d’un « moi je » qui veut tout, ici et maintenant, qui se réduit à son désir de consommation. Pas celle non plus de la conversation privée, qui tend à « instrumentaliser le dire et à annexer l’autre au nom de l’impératif communicationnel » : apparaît alors une « nouvelle communauté de parole, faite de dissemblances, de disjonctions et de ruptures dont témoignent les vacances dans le dire, les hésitations et les balbutiements des Modèles » . Un intime propre à chacun, inhabituel, demeurant parfois énigmatique aux yeux des autres. Parmi les phrases imprimées sur les tee-shirts, on peut ainsi lire : « j’aime les animaux vivants », « j’ai souvent envie d’aller ailleurs », « les plus gênés s’en vont », « la vie est un enfer », « grand-mère, je veux que tu renaisses », etc. Sylvie Blocher opère un renversement : ce qui était habituellement dissimulé, enfoui, privé, est apparu au sein d’un espace collectif, public. Chacun y exerce sur l’autre une autorité d’un nouveau genre ; pas d’ostentation, pas de violence ni d’agressivité mais une nouvelle réciprocité : « c’est cela une Living picture, un visage vivant qui se retire du champ social pour s’infiltrer dans l’art par une partie non mise à vue du Moi » . Ce questionnement sur les relations entre privé et public s’accompagne également d’une manière de considérer le champ de l’art selon une certaine conception de l’autorité (de l’artiste, de l’art, de l’œuvre d’art) : à travers l’élaboration d’un art anti-épique, anti-ostentatoire, anti-monumental, en quelque sorte.
L’envahissement par le « social »
C’est la fin de la séparation entre domaine public et domaine privé, entre les activités de la cité et les activités du commerce, du monde marchand : c’est l’envahissement de la sphère privée, initialement sphère du foyer, de la famille, par l’économie puis le transfert de cette économie aux préoccupations collectives. Dans le monde moderne, privé et public se recouvrent constamment.
C’est l’espace de la consommation, du commerce, du « shopping ». C’est la victoire du « social », ce moment où le comportement se substitue à l’action comme mode de relation primordial entre les hommes : le conformisme, le comportement social sont devenus les normes de tous les domaines de l’existence (école, travail, politique…).
Face à ces phénomènes d’envahissement de la sphère publique, la « résistance » de Jean-Pierre Raynaud apparaît comme un exemple intéressant, dans son projet de Tour aux Minguettes, à Vénissieux, au sein d’un quartier en réhabilitation (1986) : l’artiste semble vouloir y questionner la signification du monument à l’heure de la crise de la modernité. Il s’agit d’ « immoler l’une des tours restantes et désertée par ses habitants en la tapissant de 9000 mètres carrés de carreaux de céramique blanche sertis de ciment noir ; recouvrir tout, les portes, les fenêtres, les loggias ; édifier là, non pas une œuvre dont le parti pris forcément esthétique me paraissait un affront pour la population, mais livrer aux autres quelque chose qui ait à voir avec leur mémoire » . Sous la céramique, apparaît un immeuble hanté par la présence de ceux qui y ont vécu et y sont morts. L’architecture s’articule selon un balancement permanent entre présence et absence : la nouvelle tour apparaît en effet comme une réserve de significations, un objet questionnant, dont le sens est comme suspendu, entre ce qui s’est passé dans ce lieu et ce qui est à venir. De l’objet usuel (l’immeuble d’habitation), on est passé à une sorte d’objet utopique qui n’a plus d’utilité évidente, immédiate ; un monolithe blanc, silencieux, comme endormi : « le blanc est comme le symbole d’un monde où toutes les couleurs, en tant que propriétés des substances matérielles, se sont évanouies. Ce monde est si élevé au-dessus de nous qu’aucun son ne nous arrive. Il en tombe un silence qui court à l’infini comme une froide muraille, infranchissable, inébranlable. Le blanc, sur notre âme, agit comme le silence absolu » . L’expérience de l’isolement, de la finitude, joue contre les phénomènes d’esthétisation à outrance du monde contemporain. On retrouve le sens du monument, comme réserve de significations, non épuisées, contre l’envahissement du « social ». Il s’agit d’entretenir la discussion sur les valeurs et d’accepter les réponses, la pluralité des réponses. Il s’agit d’entretenir une mémoire collective qui, tout d’un coup, peut apparaître, n’est plus noyée, recouverte par le flot continu des signes du monde marchand.
Le monde commun
Monumentalité versus modernité ?
Il faudrait s’interroger en détail sur l’attrait particulier que semble exercer l’architecture monumentale pour les régimes totalitaires. C’est que la monumentalité représente tout ce contre quoi la modernité issue des Lumières s’est construite :
- La soumission à la conception holiste de l’organisation sociale : le tout est plus important que les parties ; rien n’existe en dehors de l’adhésion au tout ; l’homme acquiert son statut d’humain uniquement parce qu’il appartient à la totalité sociale ;
- La reproduction de la structure verticale, pyramidale, hiérarchique de la société, structure non contestable ;
- La constitution d’un espace soumis à la centralité, à l’ancrage, à l’enracinement : un espace magique, sacré.La monumentalité, c’est ce qui est massif, compact. C’est la mise en scène d’une unité abstraite, qui nie toute pluralité, tout débat, mais aussi toute temporalité, toute idée de finitude. C’est ce qui doit être immuable, éternel, la mise en scène d’une communauté abstraite, d’une volonté de faire corps qui se traduit par l’obsession de la grandeur et du colossal. C’est la constitution d’un espace qui se définit par une série d’excès : « à l’encontre des régimes constitutionnels qui créent l’‘espace vital de la liberté’ en aménageant, grâce aux lois positives, un espace entre les hommes (inter-esse), les régimes totalitaires, selon Hannah Arendt, ‘en écrasant les hommes les uns contre les autres’, détruisent tout espace entre eux, même celui si réduit qu’est le désert de la tyrannie. ‘Aux barrières et aux voies de communication entre les hommes individuels, elle (la terreur totale) substitue un lien de fer qui les maintient si étroitement ensemble que leur pluralité s’est comme évanouie en un Homme unique aux dimensions gigantesques’. Cercle de fer qui institue un espace plein, compact, clos, refermé sur lui-même. » .
Comment faire pour que l’espace de la modernité, traversé par des crises successives, ne soit plus un espace qui isole, divise, sépare, détruit toute possibilité de monde humain commun et d’ordre inter-humain ?
Un monument non monumental
En 1997, on inaugure à Bilbao le Guggenheim Museum, conçu par l’architecte Franck O. Gehry. L’économie de la ville de Bilbao repose sur le commerce, les mines et les chantiers navals, la crise des deux derniers secteurs ayant sinistré la région. Le bâtiment de Gehry, situé entre le fleuve Nervion et un pont routier, prend place au sein d’un espace englobant silos, bâtiments en brique, coques de navires abandonnés, lignes ferroviaires envahies par les herbes. Ici, la forme semble dépendante de la configuration chaotique du territoire. L’espace se caractérise par son étirement et son horizontalité. La diversité et l’éclatement des espaces d’expositions font songer à une jungle avec ses nœuds de circulations, des transitions, ses espaces intercalaires. Le dehors et le dedans s’enflent à la manière d’une fleur géante, une « fleur de métal » : une forme organique qui développe sa structure à partir du contexte urbain, paysager, comme une plante dont la croissance est dictée par le sol, le fleuve. L’intérieur est prolongation, propagation de la vie vers l’extérieur. La fleur évoque une substance transformante, à la manière de la fleur d’or, fleur magique dans l’alchimie médiévale (du latin flos, substance transformante et lieu de germination). L’aspect extérieur du bâtiment n’est que fragments, découpes de blocs métalliques ou en pierre, superpositions de formes tronquées, déformées, d’excroissances : l’architecture apparaît à l’intersection des forces internes et externes d’utilisation et d’espace. Comme le mur ou la limite qui sépare l’intérieur de l’extérieur, elle devient le théâtre de cet affrontement entre plusieurs forces, plusieurs tensions. Les parties du bâtiment reliées au sol sont en pierre blanche, ce sont des masses pétrifiées. S’y opposent les écailles de métal argenté des parties supérieures, situées du côté du fleuve, dans lesquelles viennent se refléter nuages et eau. Le bâtiment, par ses formes éclatées, nous révèle qu’il n’y a plus de points de vue singuliers, plus d’unité close sur elle-même : le pur dedans ne peut qu’imploser. Le Guggenheim Museum est l’expression d’un relativisme absolu. La domination de la tradition, qui instaure un processus fondé à la fois sur le principe de la stricte clôture (il tend à fermer l’humanité sur elle-même, à la couper radicalement des autres formes d’humanité) et sur le principe de l’éternel retour (il tend à imposer la répétition infinie du même genre de vie) est comme brisée, rompue.
L’architecture n’agit plus comme un refuge contre le territoire, elle vit et se développe avec lui. Le bâtiment subit des métamorphoses, il s’étire, se dissémine. Le jeu des reflets entre masses en métal et en pierre et vagues du fleuve, du ciel, flux des lumières de la ville et des circulations, fait enfin apparaître le réel dans sa multiplicité et ses brisures. L’architecture est relation, confrontation. Le projet de Franck O. Gehry nous met face à une nouvelle forme de monument : un monument critique, espace de confrontation, voire de conflit, mettant clairement en crise la tentation monumentale de l’architecture, au profit de sa capacité à défendre les valeurs d’un monde commun - et non celle d’un monde clos sur lui-même, hors temps, hors espace -, à travers une forme symbolique dont nous observons la dissémination, l’éclatement. Monument critique, conscient que les valeurs de la modernité issue des Lumières sont en crise et qu’il ne s’agit pas de les représenter idéalement, ni tragiquement.
Un dispositif autre dans l’espace public
Face aux phénomènes d’envahissement de l’espace public, l’art manifeste un grand intérêt pour l’architecture et les problématiques soulevées par son attachement traditionnel à la fonction monument. Pour TTrioreau, la disparition de la distinction entre ce qui est privé et ce qui est public doit se traduire par la critique d’un espace urbain devenu le paysage de la consommation, envahi d’infrastructures géantes qui relient les centres commerciaux aux quartiers résidentiels, d’enseignes publicitaires qui s’ordonnent en autant de séquences spatiales répétitives et dont les nouveaux monuments sont les logements individuels, qui sacralisent la sphère privée. Il s’agit d’investir les environnements habités (ce qui est commun aux hommes) et de déconstruire l’espace privé, sacralisé, de la maison ou de la demeure. La critique est notamment visible dans l’intervention BP 297 - 9 rue Edouard Branly 18006 Bourges cedex, réalisée en 2001 à la galerie de l’Ecole nationale supérieure d’art de Bourges : deux photographies fixées sur la structure d’un caisson lumineux monté sur rails représentent le plus ancien immeuble de logements sociaux construit à Bourges, faisant la jonction entre espace résidentiel et zones industrielles, également siège de l’agence d’office public d’HLM de la ville. Cet immeuble est promis à la destruction.
Le caisson se déplace à l’extérieur de la galerie, investit l’espace de la rue et crée une excroissance inattendue qui vient perturber les mouvements des piétons et des voitures. Le déplacement des signes, l’immersion de cette image dans l’espace public, hors du champ de la galerie d’exposition, est une manière de mettre en cause la fonction de l’architecture : habitat, observation et surveillance, standard ? Il faut créer des passages, des transpositions d’un espace à un autre : privilégier les interstices, les intervalles, les débordements qui répondent aux fonctions urbaines d’information (espace de la rue, événementiel) et de jeu (rencontres, hasard, mouvement). Les dispositifs de TTrioreau sont la plupart du temps démontables, et donc réactualisables dans différents lieux. Manière de remettre en cause la permanence de l’œuvre, sa fixité, au profit d’un questionnement sur la fonction du monument, sa pertinence, sa mobilité possible : désigner le caractère normatif de l’architecture, la soumission des villes aux lois du marché ; concevoir des « monuments critiques », éphémères, de l’ordre du dispositif ou de l’installation, comme nouveaux signes dans la ville, véhicules de valeurs qui résistent à l’envahissement du monde marchand.
L’usure du monument
Les deux modernités
La modernité issue des Lumières a apporté et consommé une rupture radicale avec les sociétés traditionnelles hyper hiérarchisées, figées, de type holiste. Elle l’a fait au nom de valeurs bien connues :
L’individu, la personne humaine ;
La justice, la liberté ;
L’esprit critique, comme recherche permanente de délimitations par l’exercice du jugement ;
La solidarité issue de la fraternité ;
L’action politique comme action justement, emblématique d’un espace public au sens de démocratique, d’égalité des citoyens.Mais cette modernité paraît aujourd’hui battue en brèche, déséquilibrée par une autre modernité qui privilégie d’autres valeurs et semble les pousser à l’excès. Cette seconde modernité exalte :
L’individualisme, donc le refus de toute référence, de toute contrainte, de toute sujétion ;
Le libéralisme dans le sens du laisser faire, triomphe en particulier de la « loi du marché » ;
La dérégulation dans tous les domaines ;
Le réseau comme illusion du non-hiérarchisé, l’horizontal contre le vertical ;
L’expansion de la ville sur le modèle de la ville générique ;
Le principe du « tout se vaut ».Cet affrontement entre deux modernités (pouvant être considérées comme les deux faces d’une même modernité, l’une « positive », l’autre représentant la face « sombre et cachée ») a engendré une formidable confusion, une profonde déstructuration des valeurs mais aussi des codes, des langages. Cette crise a entraîné une ambivalence dans les manières de définir l’espace public, l’espace vital de la liberté, mais aussi l’espace privé, selon que l’on se réfère aux valeurs de l’une ou l’autre des deux faces.
Tout monument devient un document
A travers les processus de symbolisation, l’homme est parvenu à dépasser sa situation individuelle. Il expérimente l’existence comme tout signifiant. Le monument est le transport d’une signification abstraite dans une forme sensible : d’un ensemble de situations spécifiques, l’homme abstrait des formes signifiantes qui rendent possibles l’existence d’un monde commun. Le monument est support de mémoire, et, surtout, « production de communauté » : « si l’on appelle culture la capacité d’hériter collectivement une expérience individuelle que l’on n’a pas soi-même vécue, le monument, par ceci qu’il attrape le temps dans l’espace et piège le fluide par le dur, est l’habileté suprême du seul mammifère capable de produire une histoire » . Le monument s’oppose au document qui est structuré par les lois du discours spontané et transmet une information non mise en œuvre. Le document est du côté du banal, du reproductible, du mobile, du descriptif : « si le monument a pour mission de maintenir présente une absence, le document a plutôt pour effet d’entraîner l’absence de référent » . Mais cette fonction principale du monument, c’est-à-dire, en tant qu’objet culturel, de symboliser (de « libérer la signification de la situation immédiate », selon Christian Norberg-Schulz ) tend à disparaître avec la modernité. La modernité, parce qu’elle est aussi critique, ne peut s’empêcher d’adopter une attitude de soupçon vis-à-vis de cette fonction du monument. Le monument, qui constituait une sorte de « structuration seconde » du lieu (une concentration et une exaltation des significations, une réserve de significations) redevient un simple document. Il y a perte de la valeur, de la charge symboliques.
Le recours à l’argument de saint Anselme
A ce moment de la réflexion, il semble donc que l’on ne puisse plus concevoir de monument possible. On tombe sur des contradictions logiques entre les termes qui s’excluent : « monumentalité moderne », « ériger un monument moderne », etc…
On pourrait retourner la situation comme saint Anselme l’avait fait : « il y a un être tel qu’on ne puisse en percevoir de plus grand et donc il ne peut pas n’exister que dans l’intelligence, il existe donc indubitablement » . De cette fameuse articulation ontologique, nous pouvons extraire un renversement extrêmement puissant sur le plan logique : il ne fonde pas une utopie (du style « la modernité finira bien par venir »), mais il fonde l’existence réelle par ce « saut » que c’est justement parce que la pensée est insuffisante à concevoir « ce qu’on cherche » que « ce qu’on cherche » existe hors de la pensée. Cet autre monument que nous concevons ne peut qu’exister que dans notre esprit. Il existe bel et bien. Peut-être que nous ne le voyons pas clairement, encore.
Nous ne voyons pas clairement, tout simplement parce que nous ne sommes pas vraiment dans un espace public correspondant au monde humain commun, correspondant aux « valeurs pures » de la modernité : effectivement, la « révolution » n’est pas achevée…
Et vouloir fonder (maintenir, défendre) un monde humain commun ne peut se faire que conformément aux valeurs modernes, donc :
Ce ne sera pas en fondant un nouveau totalitarisme, amenant avec lui une représentation monumentale du corps social ;
Ce sera en respectant la discussion, le politique, la démocratie, au plus près du sens étymologique du mot « public » ;
Ce ne pourra être que suivant un cheminement critique, qui ne se contente pas de décomposer à l’infini, de détruire pour détruire.L’étude du bâtiment de Franck O. Gehry nous fait entrevoir une définition du monument qui se distingue de celle du document parce qu’il agit comme une réserve de significations et assume donc pleinement sa fonction symbolique. C’est un monument qui ne traduit pas une vision idéalisée de la réalité, mais donne à voir ce « sujet brisé » , disséminé, propre à la crise de la modernité et par là, agit contre toute tentation monumentale. Les expériences de TTrioreau semblent se rapprocher du document, dans la mesure où le dispositif, le monument éphémère agissent d’abord comme des médias, devenus les nouveaux véhicules des valeurs modernes. Dans ce cas, on pourrait presque dire que le média a remplacé le public.
Et si, finalement, reprenant l’argument de Saint Anselme, l’espace public n’était-il pas lui-même un monument ? C’était bien le cas chez les Grecs, avec l’espace de l’agora, incarnant la défense du domaine public, de la liberté, du politique, fier de sa distinction radicale avec le domaine privé. C’était un espace qui ne se réduisait pas à sa localisation physique, mais plutôt un espace du paraître au sens le plus large, au sens de ce moment où j’apparais aux autres comme les autres m’apparaissent, où la réalité du monde m’est garantie par cette apparition réciproque. Cela est peut-être toujours possible, à condition de savoir quelles valeurs on défend : celles de la première modernité ou celles de la seconde ? A condition de se tenir à l’écart des excès inhérents aux deux « faces » de la modernité : vision abstraite et « idéologique » de l’humanité, opérant un retour au monumental, au colossal comme négation du réel ; fascination pour les phénomènes de dérégulation, d’envahissement du « shopping », de la technique, discours du « tout se vaut » opérant une fuite en avant vers la désorganisation, la destruction complètes…
Alice Laguarda
La revue d’esthétique, n°46, éditions Jean-Michel Place
gmTT-ck + edge on a ledge
« SUPER », XIXèmes ateliers internationaux, Frac des Pays de la Loire
Agissant sur la structure même de l’espace construit, les propositions de TTrioreau mettent en place des déplacements qui perturbent notre perception et désignent de façon politique le caractère normatif de l’architecture.
Pour le Frac des Pays de la Loire, il réalise une maquette de la salle d’exposition en plexiglass miroir. Représentation en même temps que reflet de l’espace de monstration, jeu sur les rapports extériorité-intériorité, cet objet intègre également, en les reflétant, les œuvres des autres artistes invités et sème le trouble. En effet, TTrioreau place à l’intérieur de cette maquette une fausse cloison en inox miroir positionnée légèrement en biais, projet qu’il envisageait initialement de produire à l’échelle de l’espace réel. Il casse ainsi l’espace parallélépipédique, le cube blanc, de la salle d’exposition, et déstabilise le regard.
Par ailleurs, en clin d’œil à la résidence, TTrioreau reprend de manière homothétique cette cloison et la transforme en lame de rasoir à double-tranchant. Cet objet, produit en série de sept multiples, renvoie à la notion de découpage de l’architecture ainsi que, plus malicieusement, au nombre d’artistes invités.
Enfin, TTrioreau choisit de souligner de néons les fissures du vitrage du Frac. Nées de l’affaissement du bâtiment et de la tension du béton sur le verre, ces marques témoignent de l’histoire structurelle du lieu.
Cet ensemble de propositions, discret hommage à Gordon Matta-Clark, rend compte avec cohérence de la spécificité de la démarche de l’artiste. TTrioreau renouvelle le point de vue sur cet espace en tranchant, en fragmentant l’architecture et sait rendre visible les symptômes enfouis d’une architecture en mouvement.
Super Bowl
[…] Mais la référence légère au contexte se fait plus violente avec les pièces de TTrioreau qui mettent directement en scène la structure-réceptacle. On peut y voir une critique de la normativité architecturale des lieux de l’art autant qu’une fascination en acte : étincelante, rutilante, la maquette de TTrioreau est spectaculairement placée sur un véritable piédestal. Ailleurs, le surlignage au néon des défectuosités des vitres entretient un dialogue ironique avec le bâtiment : façon de pointer les failles et les « rides » de la construction ou bien parachèvement du discours sur la fétichisation du lieu jusque dans la mise en lumière de ses défauts ? […]
Patrice Joly, Super Bowl, Zéro Deux, p. 43, numéro 37, printemps 2006
Entretien avec TTrioreau / Hervé Trioreau / 16 janvier 2006
« Mon projet pour le Frac a évolué par rapport à plusieurs éléments qui restent fondateurs.
Le premier projet était lié à Sarajevo. Je suis allé dans cette ville pendant la guerre en 1995. J’y avais réalisé des photographies et quelques vidéos, et en retombant sur ces images il y a quelques mois, je me suis aperçu que je n'avais pas du tout filmé les gens ou la guerre, mais plutôt, avec une certaine distance, un type d'architecture. Cette architecture rendait compte des cicatrices de la guerre : des bâtiments fissurés, détruits, portant les symptômes de la guerre.
Je relie cette approche aux projets de Gordon Matta-Clark, sur l'idée d'une fragmentation, d'une fissure du bâtiment, d'un écartement. Gordon Matta-Clark (gmTT-ck) a su casser le point de vue sur un espace en découpant, en tranchant l'architecture.
Un troisième élément fondateur possède une dimension in situ, et se connecte donc à l'espace d'exposition du Frac. Il se trouve que le Frac a quelques problèmes structurels liés à ses fondations en béton : le béton s'affaisse, et automatiquement les indices qui rendent compte de cet affaissement sont les verres sécurit qui se fissurent peu à peu au niveau de la salle d'exposition et au niveau de la salle d'entrée.
Ces éléments me paraissaient importants pour pointer certaines de mes préoccupations autour de l'idée de déstabilisation architecturale, et autour de la notion de l'espace de monstration (la salle d'exposition).
Dans mon premier projet, qui a fait que Laurence Gateau a eu quelques nuits blanches, je voulais construire une fausse cloison, une sorte de leurre dans l'espace d'exposition. Je pensais occulter la fenêtre meurtrière du fond, par cette paroi qui aurait fait toute la longueur du mur réel. Cette paroi aurait été positionnée avec un tout petit angle de 10° qui cassait visuellement l'espace parallèpipédique du Frac. Je voulais créer une sorte de déstabilisation du regard. Au Frac, on est dans un cube parfait. Avec ce faux mur, je proposais non pas un projet sculptural ou volumétrique, mais je m'inscrivais complètement dans l'espace architectural du lieu. Ce projet s'effaçait en même temps qu'il communiquait avec l'ensemble des projets des autres artistes, où il y a pas mal de sculptures, des rotations, des invitations à des glissements du regard, une vraie circulation. L'idée que l'espace en lui-même puisse ré-accentuer l'ellipse présente dans ces îlots au sein de l'espace d'exposition me paraissait intéressante. À l'intérieur même de cette fausse paroi, il y avait la reprise, à l'identique et en superposition, de la fissure de la vitre cachée. La réinscription de la fissure du verre à l'intérieur de cette cloison rendait un hommage discret à Monsieur Matta-Clark, et rendait visible l'idée de l'affaissement, et du marquage architectural. Ce verre se fissure du fait de la gravité, dans le sens de la tension verticale du béton sur le verre.
Ce projet n'a pas pu se réaliser, il nécessitait la construction d'une cloison de 25m x 5,20m, et c'était trop compliqué. J'ai donc reconsidéré les éléments fondateurs de ce projet abandonné.
Dans mon « nouveau » projet, il y a une maquette de l'espace d'exposition du Frac, maquette qui mesure 1m x 80 cm. Elle est constituée de plexiglas miroir, elle reflète donc entièrement l'espace d'exposition intérieur-extérieur, et aussi automatiquement les pièces des autres artistes résidents. À l'intérieur de cette maquette-là, je positionne le projet utopique, à savoir une fine lame représentant la fausse cloison évoquée précédemment, lame très proche d'une lame de rasoir. Cette lame est en inox miroir, très fine. On a donc deux matériaux différents, le plexiglas-miroir qui est vraiment parfaitement réfléchissant, et cette lame qui d'une certaine manière tranche la maquette et joue sur des reflets complètement différents.
La maquette est positionnée au niveau du regard, et par l'intermédiaire des ouvertures portes et fenêtre, on peut voir la lame et l'intérieur de l'espace d'exposition. Ces ouvertures inventent aussi une sorte d'oculus, qui permet de voir l'ensemble du lieu réel à l'échelle 1 et l'ensemble des pièces des autres artistes.
La maquette est posée sur un pied très léger, presque en lévitation. C'est une sorte de boule à facettes, qui représente l'espace d'exposition en même temps qu'elle le reflète.
Dans la seconde partie de mon projet, je redessine les fissures déjà évoquées (celle de la salle d'exposition et les deux autres visibles dans le hall) avec un néon, qui reprend exactement la ligne de fracture des trois verres brisés. Ce néon est positionné avec des ventouses transparentes sur la fissure.
Côté salle d'exposition, la fissure est soulignée de lumière orangée (en relation avec le travail de Nicolas Moulin), révélatrice de la pression qui s'exerce sur le verre. Côté hall, les deux autres néons sont en hauteur, leur lumière est blanche, ils sont presque cachés, le visiteur les verra surtout la nuit. Ils apportent une réponse très graphique aux wall paintings de Jan Christensen.
Enfin, ma troisième pièce est une sorte de petit pied de nez par rapport à la résidence mais aussi l'élément constituant du projet global. Je reprends de manière homothétique la lame d'inox miroir qui est dans la maquette, et je la fais tailler comme s'il s'agissait d'une véritable lame de rasoir à double-tranchant, de grande dimension (environ 80cm x 40cm). J'en réalise sept, c'est-à-dire le nombre des résidents. Je ne sais pas encore à quel endroit elles seront installées, ni de quelle manière. Je trouve qu'elles introduisent un écho intéressant à la tête coupée de Pascal Bircher.
Voilà, ces différentes pièces sont pour moi les fondations du projet utopique, mais elles restent très importantes dans cette réflexion que je mène autour de la fragmentation, de la mise en mouvement de l'architecture. Je veux rendre visible ce mouvement-là, je veux être capable de trancher l'architecture, au marteau piqueur ou au scalpel. »
gmTT-ck / edge on a ledge : bienvenue en zone inconnue
…35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS et RUE MASSENET, 44300 NANTES, deux projets réalisés par protaTTrioreau en 1998-1999, mettaient en oeuvre un dispositif permettant l’enregistrement de la destruction anticipée de deux bâtiments depuis l’intérieur, par le truchement de maquettes à l’instar de celles fabriquées pour les effets spéciaux en cinéma. Cette constitution d’archives d’un événement annoncé n’est pas sans rappeler un voyage dans le temps, dans lequel TTrioreau rend possible des points de vues inexistants.
L’archive comme système de pensée
La résidence est un mode de travail que TTrioreau applique de manière générale à sa pratique artistique. Il n’arrive pas avec un projet prédéfini, c’est le contexte de celui-ci qui le défini, voire qui le nomme puisque plusieurs d’entre eux portent comme titre l’adresse même du lieu d’exposition. Tant et si bien que l’artiste ne présente jamais deux fois une œuvre, chacune d’entre elle ayant été conçue et réalisée pour le lieu qui l’accueille. Son travail peut également se passer de lieu d’exposition et prendre place dans l’espace urbain. Ceci explique le soin auquel TTrioreau porte à la documentation et à la diffusion de ses œuvres, comme la newsletter qu’il envoie régulièrement à son fichier d’adresses électroniques, ou le site Internet très complet qu’il a mis en place - http://herve.trioreau.free.fr. Ce dernier rend compte de ses projets un à un (y compris ceux qu’il n’a pas encore réalisés), ses conférences et workshops, par le biais de textes, de photographies, de plans, de simulations en trois dimensions, d’enregistrements sonores - véritable travail d’archivage – mais pas uniquement. Au fur et à mesure de ses nouveaux projets, le travail de TTrioreau se complexifie puisque le contexte d’une résidence et d’une exposition peut tout à fait influer et se mêler à celui d’une autre exposition. Le cheminement qui relie ses oeuvres devient de plus en plus sinueux tant l’artiste manipule avec une grande liberté l’espace (la localisation, la géographie), mais aussi le temps (la chronologie). Ainsi à la fin de l’année 2005, l’artiste a mis en place quatre événements (la conception d’un livre et de quatre expositions) qu’il a liés entre eux en pointant des problématiques inhérentes à son travail, comme la relation entre l’œuvre et son image, l’architecture et la temporalité, l’écran et l’urbanisme, l’urbanisme et le corps. Si l’archive et Internet permettent de rendre compte de ce travail dense et riche, ils correspondent également à son mode de pensée et à son déploiement, à son enracinement dans le réel puis à son envol vers une quatrième dimension futuriste et abstraite.
Du projet à la maquette, de la maquette au projet
TTrioreau utilise les formes mêmes de l’architecture et de l’urbanisme – maquettes, caissons lumineux, images, écrans - qu’il détourne et auxquelles il intègre ses interprétations et modifications.
Au cours des XIXe Ateliers Internationaux, il a focalisé sur le bâtiment du Frac des Pays de la Loire, en tant qu’architecture et espace d’exposition, pour lequel il fait trois propositions. Le sujet de l’œuvre devient l’architecture qui la contient - l’architecture comme œuvre - sur laquelle il se propose d’intervenir, qu’il vient perturber. Sa proposition initiale pour SUPER, l’exposition collective prévue à l’issue de cette résidence, était de construire un mur qui rompe la régularité de l’espace orthogonal d’exposition, une cloison en biais, qui crée une diagonale partielle. L’artiste a matérialisé son acte de découpe du lieu #, récurrent dans son travail, en produisant sept lames (sept étant le nombre d’artistes de SUPER) de rasoirs en inox poly-miroir du même format que la maquette, objets réflexifs, énigmatiques et démesurés (gmTT-ck / edge on a ledge #2). La construction du mur s’étant avérée irréalisable, TTrioreau change l’échelle de son projet et produit une maquette de 121 cm x 86 cm x 26 cm de l’espace d’exposition en y intégrant son intervention (gmTT-ck / edge on a ledge #1). Celle-ci, fabriquée en plexiglas miroir, est présentée à 130 cm du sol sur un pied de cymbale rappelant les écrans de projection, inclinée de manière à ce que le spectateur puisse y plonger et en même temps déstabiliser l’espace d’exposition. Cette maquette devient une réalisation en elle-même, et non plus une étape avant réalisation. Un objet entre maquette et sculpture, un vaisseau spatial prêt à décoller…
TTrioreau a auparavant réalisé d’autres œuvres liées à des architectures, comme celle en forme d’étoile à sept branches conçue par le peintre Georges Mathieu en 1968, qui accueille à Fontenay-le-Comte l’usine HOROQUARTZ - gestion des temps, entreprise spécialisée en systèmes liés au temps comme des horloges ou des pointeuses. Nous sommes déjà dans la science-fiction. De cet ensemble, TTrioreau réalise à Glassbox en 2005 une installation qui extrait la forme du bâtiment, la transforme en sculpture - écran vertical, la baigne dans la lumière verte d’un TIMECODE électronique. Lors de son exposition à Entre-deux à Nantes la même année, il réalise PRYSM, une maquette en miroir de la Maison Radieuse de Le Corbusier située à Rezé-lès-Nantes, objet qui intègre l’environnement urbain du lieu dans lequel il est présenté.
Dans ces trois cas, des architectures ont donné leur forme à des sculptures qui, si elles ne sont plus forcément identifiables en tant que telles, ne perdent pas pour autant leurs références et leurs histoires. Si de manière générale la maquette est la préfiguration miniature d’un projet architectural ou artistique, TTrioreau inverse le processus en reproduisant la maquette d’une architecture existante. Finalement, quelle qu’en soit l’échelle, l’artiste concrétise dans tous les cas ses projets.
Souligner les failles de l’architecture
L’une des pratiques de TTrioreau consiste, à différents niveaux, à corriger l’architecture. Suite à plusieurs voyage à Hong Kong entre 1997 et 2004, il réalise un projet architectural inspiré d’une pratique répandue dans de nombreux quartiers défavorisés (NEW TERRITORIES), l’extension pirate d’appartements, dans le but d’augmenter les surfaces habitables des logements.
Au Frac des Pays de la Loire, il fabrique et met en place sur les vitres du bâtiment des néons qui épousent les fissures provoquées par le poids du béton (gmTT-ck #1 / gmTT-ck #2 / gmTT-ck #3). Cette proposition rejoint un travail que l’artiste a réalisé lors d’un voyage Sarajevo en 1995, durant la guerre, lors duquel il a filmé l’architecture « fissurée ». Comme c’est souvent le cas dans son travail, l’artiste crée des va-et-vient entre différents lieux a priori mis en oppositions comme intérieur/extérieur, centre/périphérie, grands ensembles/œuvres d’architectes. Signalétique du défaut, de l’accident, au Frac des Pays de la Loire, il met discrètement l’accent sur les vices de forme du bâtiment – qu’il ramène là à sa fonctionnalité et à sa capacité à perdurer – et dans le même temps, il camoufle ces fissures, leur donne une forme esthétique, qui n’est pas si éloignée d’une décoration. Un éclair rougeoyant (gmTT-ck #1) qui dialogue avec l’œuvre de Nicolas Moulin (elle-même référence au film Roller Ball), et qui se reflète dans sa maquette en miroir, tout comme se reflète l’espace et l’exposition dans son ensemble. A l’instar de l’architecture, l’œuvre accueille les œuvres des autres artistes, ainsi que le spectateur.
TTrioreau est-il un robot ?
Le travail de TTrioreau paraît froid et désincarné : sa signature ressemble à une marque (dans les deux sens du terme : un logo et une trace de son ancienne collaboration avec Vincent Protat), ses représentations de l’espace urbain et de l’architecture ne comprennent aucune présence humaine, les formes qu’il crée ne renvoient au premier abord qu’à elles-mêmes, les matériaux et les techniques qu’il utilise sont sophistiqués. Cet effet est renforcé par le soin auquel l’artiste porte à la présentation de ses œuvres, pour lesquelles il crée des environnements et des ambiances spécifiques. Pourtant l’altérité y a sa place, mais de manière détournée. Le miroir et le film sont les deux médiums que l’artiste a choisi pour faire rentrer une présence humaine et mettre en mouvement ses univers. Ses installations, comme ses maquettes, constituent le décor abstrait de fictions que le spectateur vient peupler. De ces univers cinématographiques naît une narration, comme l’installation DV, présentée au Transpalette à Bourges en 2006, qui comprend deux films HDV en vis-à-vis. Sur l’un des écrans plasma est diffusé le survol en travelling circulaire d’une ville en hélicoptère (Odessa) et sur l’autre l’enregistrement de la réalisation d’un tatouage : mais où est passé l’homme à la caméra ? en alphabet cyrillique, texte qu’il a désormais gravé sur le haut du dos. Cette phrase issue d’une publicité du film L’homme à la caméra de Dziga Vertov, est parue non signée dans La Pravda en 1929, chaque matin, pendant sept jours, avant la sortie du film. Cette référence à l’archive, voire cette fabrication de l’archive, est récurrente dans le travail de TTrioreau depuis le début. Parce qu’il ancre ses oeuvres dans le quotidien, qu’il use d’images et de codes qui nous sont familiers, qu’il part d’une base d’archive et de documentation extrêmement précise, il nous amène dans une certaine forme de science-fiction pragmatique. Dans l’architecture de son travail, il crée un processus prenant la forme d’une boucle infinie dans un montage où la construction passe par la destruction.
35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS et RUE MASSENET, 44300 NANTES, deux projets réalisés par protaTTrioreau en 1998-1999, mettaient en oeuvre un dispositif permettant l’enregistrement de la destruction anticipée de deux bâtiments depuis l’intérieur, par le truchement de maquettes à l’instar de celles fabriquées pour les effets spéciaux en cinéma. Cette constitution d’archives d’un événement annoncé n’est pas sans rappeler un voyage dans le temps, dans lequel TTrioreau rend possible des points de vues inexistants…
Anne Langlois
for gordon maTTa-clark
TTrioreau
Hervé TrioreauTimeCode
GlassBox, Paris
du 23 octobre au 26 novembre 2005
vernissage le 22 octobre 2005
http://www.glassbox.bePrysm
Entre-Deux, Nantes
du 26 novembre au 23 décembre 2005
vernissage le 25 novembre 2005
http://www.entre-deux.tkDV
Le Transpalette, Bourges
du 15 janvier 2006 au 18 février 2006
vernissage le 14 janvier 2006
http://www.emmetrop.fr.fm
D’une manière générale, c’est sous le double horizon de l’architecture et du réseau urbain que s’inscrivent les travaux de TTrioreau. Quelle est la nature de l’espace construit ? Quels déplacements sont susceptibles de s’y produire ? Qu’en est-il du rapport entre intériorité et extériorité ? Voilà quelques unes des questions qui structurent les propositions de TTrioreau.
Au cours de la seconde moitié de l’année 2005, ce ne sont pas moins de quatre moments qui vont venir relancer et approfondir cette production. Quatre événements articulés autour des thématiques que forment les couples catalogue/œuvre, architecture/temporalité, architecture-écran/urbanisme et urbanisme/corps.
BP 297 - 9, rue Edouard Branly, 18006 Bourges cedex
_première étape : (annulée par l’éditeur Marc Sautereau / BookSorming - ArchiBooks)
BP 297 - 9, rue Edouard Branly, 18006 Bourges cedex, sortie d’un catalogue édité par ArchiBooks - Le Gac + Sautereau éditeurs à l’occasion de la FIAC qui se déroulera du 6 au 10 octobre 2005 à Paris. Ce catalogue au titre éponyme d’une exposition réalisée à Bourges en 2001 avait déjà été montré lors d’une autre exposition (en tant que maquette-prototype), à Fontenay-le-Comte en 2004. Au centre de ces deux expositions et du catalogue, l’image d’un immeuble de la zone périurbaine de Bourges. Si ce catalogue a bien pour point de gravité l’exposition de Bourges, il n’en est pas pour autant la simple « documentation » : sa forme même, un parallélogramme irrégulier évoquant la silhouette de l’immeuble représenté, continue plus l’élan de la première installation qu’il n’en fixe la trace. Son intégration à part entière dans une autre installation, à quelques années d’intervalle, confirme cette proposition. Si les questions du transfert, du déplacement étaient au cœur des travaux de Bourges et de Fontenay-le-Comte, le catalogue, de par sa forme et sa fonction, entend poursuivre cette dynamique : ne pas figer les choses, ne pas simplement faire inscription, mais continuer en un autre lieu la démarche appliquée lors des deux installations.
BP 297 - 9, rue Edouard Branly, 18006 Bourges cedex
ArchiBooks - Le Gac + Sautereau éditeurs
18/20, rue de la perle, 75003 Paris
http://www.archibooks.comAuteurs : Frédéric Bouglé, Emmanuel Decouard, Jérôme Duvigneau, Alice Laguarda, Renaud Rémond, Christian Ruby
Conception graphique : Daniel Perrier
54 pages, français / anglais / allemandAvec le concours de La Box, Ecole nationale supérieure d’art de Bourges et la DRAC Centre
TimeCode
_deuxième étape :
TimeCode, TTrioreau occupe GlassBox à Paris du 23 octobre au 26 novembre 2005 (vernissage le 22 octobre). Ici, trois dispositifs vont être mis en relation, vont dialoguer et se répondre en une boucle polysémique. Point de départ, l’usine HoroQuartz dessinée par le peintre Georges Mathieu. La structure en étoile à sept branches sera transférée dans le lieu de l’exposition, non pas en tant que simple maquette mais en une sorte de surface barrant l’espace, fragmentant le lieu de GlassBox. A ce premier dispositif répond TimeCode. Il s’agit là d’un panneau où sont installés dix chiffres défilant au rythme de 1/24 de seconde. Là où la gestion du temps n’apparaît pas dans HoroQuartz (ce qui est pourtant l’activité de la véritable entreprise : HoroQuartz – gestion des temps), TimeCode semble s’inscrire dans cette perspective : les chiffres défilent d’une manière comparable à celle de l’indexation cinématographique. Mais le parallèle s’arrête ici. Le défilement produit par TimeCode est perpétuel ; pas de valeur d’indexation possible mais un temps qui semble s’échapper, briser l’écoulement de l’enregistrement en un faux-semblant de chronométrage. Prysm, enfin, vient comme clore la boucle. Structure à prismes verticaux réfléchissants, lumineux et rotatifs, Prysm démultiplie l’espace d’exposition et les spectateurs ; elle met en mouvement en même temps qu’elle fragmente à nouveau le regard posé sur elle-même ainsi que sur l’ensemble de l’exposition.
TimeCode
du 23 octobre au 26 novembre 2005
vernissage le 22 octobre 2005GlassBox
113bis rue Oberkampf, 75011 Paris
T : +33 (0)1 43 38 02 82
bau@glassbox.be
http://www.glassbox.beGlassBox reçoit le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Ile-de-France), du Café Charbon, la Mère Lachaise, le Nouveau Casino et l'Espace Paul Ricard
TimeCode est réalisé avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France – aide individuelle à la création 2005
Avec le concours et le mécénat des entreprises DDM ELECTRONIQUE, HEXIS – GROUP et SELFLITE – ABISKO – TRIOLA
Prysm
_troisième étape :
Prysm, TTrioreau est invité à Nantes par l’association Entre-Deux du 26 novembre au 23 décembre 2005 (vernissage le 25 novembre). En résidence au FRAC des Pays de la Loire à Carquefou et à l’Ecole régionale des beaux-arts de Nantes, TTrioreau va préparer une triple installation dans trois espaces publics nantais. Au centre de ce dispositif, un no man’s land, dénommé Terrain de la Meuse, en contrebas des zones périurbaines nantaises et dans l’alignement de la Cité Radieuse de Rezé-lès-Nantes conçue par Le Corbusier et de la zone périurbaine Les Dervallières. Au centre de ce terrain, TTrioreau va installer un large panneau, format cinémascope, composé de prismes réfléchissants (à l’instar de l’installation précédente à GlassBox). Ces prismes vont réfléchir l’espace, les bâtiments alentours et les voies routières avoisinantes. Ce qui préoccupe TTrioreau ici, ce n’est pas tant la notion d’architecture en elle-même, mais bien plutôt la question du cadrage. De quelle manière et à quelles conditions voit-on, discerne-t-on quelque chose dans l’espace public, telle est la question posée. L’architecture que forme le panneau à prismes est une architecture-écran qui viendra fragmenter les données urbanistiques au sein desquelles il s’intègre. Intérieur/extérieur : là où le Prysm de GlassBox réfléchit l’intériorité de l’exposition, celui de Nantes capte l’extérieur. C’est du même processus dont il s’agit, seule l’articulation entre la logique de la mise en situation et une fragmentation dédoublée diffère et pousse la réflexion de TTrioreau vers une transgression des espaces normés et statiques. Autour de cette première proposition deux autres installations viendront compléter ce travail de TTrioreau : l’une dans les locaux de l’association Entre-Deux aux Dervallières, l’autre au cœur même de la Cité Radieuse.
SEMAINE / revue hebdomadaire pour l’art contemporain / no. 76 / parution le 25 novembre 2005 / publié et diffusé par Analogues, maison d’édition pour l’art contemporain, 4, rue des Thermes, 13200 Arles, France, 04 90 96 27 65, http://www.analogues.fr / directeur de la publication Gwénola Ménou / 4 euros TTC
Marie-Laure Viale & Jacques Rivet ont fondé l’association Entre-deux à Nantes en 1996. Artiste et historienne de l’art pour l’une, formation en économie et statistique pour l’autre, ils se présentent comme producteurs et médiateurs d’œuvres d’art public : « nous invitons des artistes à agir dans les interstices, les « entre-deux » dans le but d’intensifier les échanges, par exemple, entre deux quartiers d’une ville / Les Dervallières et Zola à Nantes. Nous croyons au rôle prépondérant de l’espace public - compris comme espace de délibération. Pour développer cet espace, l’urbanisme, même le plus intéressant, n’est pas suffisant. Il a besoin d’art public ad hoc. »
Entre-deux a produit et réalisé les œuvres suivantes : Bruno Peinado, A bâtons rompus 3, 1997 / Matthieu Laurette, Vivons remboursés !, 1997 / Robert Milin, Cyclistes, 2000 / Pierre Joseph, interview de Jean Joret, traceur de coque, 2001 / Pierre Huyghe, Passagers, 2001 / Abraham Poincheval, Clémentine Henriot et Johann Van Aerden, RMI, 2001 / Mircea Cantor, Ping Pang Pong, 2002 / Gabriela Vanga, Sans titre, 2003 / Bruno Serralongue, Diaporama sur écran-vitrine, 2004
Prysm
du 26 novembre au 23 décembre 2005
vernissage le 25 novembre 2005Entre-Deux
Marie-Laure Viale & Jacques Rivet
4, bd Pasteur, 44100 Nantes
T/F : +33 (0)2 40 71 81 41
viale.rivet@wanadoo.fr
http://www.entre-deux.tkEntre-Deux reçoit le soutien de la Ville de Nantes, la DRAC des Pays de la Loire et la Région des Pays de la Loire
Exposition réalisée avec le concours des entreprises ATELIER HA et SELFLITE – ABISKO – TRIOLA
DV
_quatrième étape :
DV, du 15 janvier 2006 au 18 février 2006 (vernissage le 14 janvier), Le Transpalette à Bourges, TTrioreau va finaliser un projet mûri durant de longues années. Au centre de cette proposition, il y a le film de Dziga Vertov, L’homme à la caméra. Mais, ici encore, c’est un régime oppositionnel qui va présider au travail de TTrioreau. Dans quelle mesure ? Pour le résumer au plus court, on peut décrire le film de Dziga Vertov comme une tentative de mise à jour de l’activité citoyenne dans la ville d’Odessa en Ukraine ; au ras du sol, la caméra est cet œil qui rend compte de la modernisation, de l’industrialisation de la ville : L’homme à la caméra est un quelque sorte le point de liaison entre le cinéma, la ville et la citoyenneté. Par ailleurs, Dziga Vertov promeut dans son film le montage cinématographique comme vérité, vérité plus pure que l’œil propre du corps. Or, la proposition de TTrioreau opère par rapport au matériau de base un strict décalage : en deux long métrages, TTrioreau va court-circuiter la thématique de Dziga Vertov. Pour le premier film, il s’agit d’un long panoramique aérien qui opère des cercles concentriques autour de l’actuelle Odessa. La ville est mise à distance en une vision panoptique, elle en devient manipulable au fur et à mesure que les architectures, les bâtiments se transforment en pures formes géométriques. Le second film, quant à lui, reprend une des annonces publiée par Dziga Vertov dans la Pravda avant la sortie de son film. Le contenu de cette annonce – Mais où est passé l’homme à la caméra ? (en alphabet cyrillique) – va être tatoué sur le dos de l’artiste, opération filmée en un long plan séquence. Alors que les bâtiments deviennent géométries dans le premier film, ce sont maintenant les lettres de l’annonce qui se transforment en volumes, en quasi esquisses de bâtiments durant la séance de tatouage. Mise à distance contre proximité, montage contre plan-séquence : TTrioreau inverse ici les rapports. Pour autant, le jeu n’est pas gratuit car, au bout du compte, comme le montre la phrase tatouée sur la chair même de l’artiste, une plus grande proximité est atteinte. C’est de l’inscription de l’architecture, du sens toujours décalé de cette dernière sur le corps propre dont il est question ici : tout se passe comme si la peau prenait la place de l’œil, une peau comprise comme membrane sur laquelle vibre le sens polysémique de l’architecture. Les deux films seront projetés simultanément, en vis-à-vis, dans une même temporalité. Le point de liaison entre les deux projections ne sera pas assuré par un acteur physique, mais par l’immatérialité d’une ellipse sonore qui bouclera les deux moments dans une seule et même architecture.
DV
du 15 janvier 2006 au 18 février 2006
vernissage le 14 janvier 2006Le Transpalette
association Emmetrop
26, route de la Chapelle, 18000 Bourges
T : +33 (0)2 48 50 38 61
transpalette@wanadoo.fr
expotranspalette@hotmail.com
http://www.emmetrop.fr.fmFilms HDV co-produits par l’Association Bandits-Mages avec l’aide de la DRAC Centre, la Région Centre, l’aide à la maquette du DICREAM - CNC/DAP et en partenariat avec l’Institut Français d’Ukraine
Le Transpalette reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Direction des Affaires Culturelles du Centre, du Conseil Régional du Centre, du Conseil Général du Cher, de la Ville de Bourges et du Crédit Mutuel de Bourges
DV
TTrioreau va finaliser un projet mûri durant de longues années. Au centre de cette proposition, il y a le film de Dziga Vertov, L'homme à la caméra. Mais, ici encore, c'est un régime oppositionnel qui va présider au travail de TTrioreau. Dans quelle mesure ? Pour le résumer au plus court, on peut décrire le film de Dziga Vertov comme une tentative de mise à jour de l'activité citoyenne dans la ville d'Odessa en Ukraine ; au ras du sol, la caméra est cet œil qui rend compte de la modernisation, de l'industrialisation de la ville : L'homme à la caméra est un quelque sorte le point de liaison entre le cinéma, la ville et la citoyenneté. Par ailleurs, Dziga Vertov promeut dans son film le montage cinématographique comme vérité, vérité plus pure que l'œil propre du corps. Or, la proposition de TTrioreau opère par rapport au matériau de base un strict décalage : en deux long métrages, TTrioreau va court-circuiter la thématique de Dziga Vertov. Pour le premier film, il s'agit d'un long panoramique aérien qui opère des cercles concentriques autour de l'actuelle Odessa. La ville est mise à distance en une vision panoptique, elle en devient manipulable au fur et à mesure que les architectures, les bâtiments se transforment en pures formes géométriques. Le second film, quant à lui, reprend une des annonces publiée par Dziga Vertov dans la Pravda avant la sortie de son film. Le contenu de cette annonce - Mais où est passé l'homme à la caméra ? (en alphabet cyrillique) - va être tatoué sur le dos de l'artiste, opération filmée en un long plan séquence. Alors que les bâtiments deviennent géométries dans le premier film, ce sont maintenant les lettres de l'annonce qui se transforment en volumes, en quasi esquisses de bâtiments durant la séance de tatouage. Mise à distance contre proximité, montage contre plan-séquence : TTrioreau inverse ici les rapports. Pour autant, le jeu n'est pas gratuit car, au bout du compte, comme le montre la phrase tatouée sur la chair même de l'artiste, une plus grande proximité est atteinte. C'est de l'inscription de l'architecture, du sens toujours décalé de cette dernière sur le corps propre dont il est question ici : tout se passe comme si la peau prenait la place de l'œil, une peau comprise comme membrane sur laquelle vibre le sens polysémique de l'architecture. Les deux films seront projetés simultanément, en vis-à-vis, dans une même temporalité. Le point de liaison entre les deux projections ne sera pas assuré par un acteur physique, mais par l'immatérialité d'une ellipse sonore qui bouclera les deux moments dans une seule et même architecture. Ainsi une seule trame sonore pour les deux films, quadriphonie enveloppante où l'on redécouvre les vertus secrètes du montage. Aux deux pôles visuels muets répondent les éléments sonores utilisés dans l'ellipse. Le rotor de l'hélicoptère d'une part, fureur mécanique d'une géante toupie ("dziga") et la petite machine à tatouer d'autre part avec ses aiguilles lancées à travers la chair en singulières rotations ("vertov"). 64 minutes 32 secondes d'une musique concrète mixée dans le souci d'être un élément structurel de l'installation contre l'expressivité naïve de l'illustration. La diffusion du son crée l'espace de rencontre des deux films. Arrachés aux deux dimensions de leurs écrans, ils deviennent l'espace architecturé d'un lieu déconcertant pour qui s'y avance, pour qui s'immerge dans cet environnement à échelles multiples que l'on appréhende de l'œil et de l'oreille. Ici la mémoire convoquée du cinéma-vérité ("kino-pravda" où l'œil produit autant le réel qu'il l'enregistre) questionne à son tour, dans les mouvements giratoires et bruyants, les espaces bâtis dans lesquels nos corps témoignent des contraintes à les habiter.
Emmanuel Decouard & Jérôme Duvigneau
DV
Quelle est l’actualité de « L’homme à la caméra » le célèbre film de Dziga Vertov ? Cette question est au centre de l’exposition de TTrioreau. Initialement réalisé en 1929, le film de Dziga Vertov s’inscrivait dans une dynamique particulière : l’édification de l’union soviétique avec l’idée d’une révolution permanente. En filmant la ville d’Odessa, ses nouvelles industries et surtout l’intrusion de la modernité via le travail des ouvriers et les activités de toutes les forces vives, le cinéaste voulait donner une retranscription cinématographique des bouleversements en cours. Véritable manifeste pour une nouvelle vision ou ville et citoyens deviennent les éléments d’une possibilité d’enregistrer la vérité du monde, vérité bien plus exacte que celle perçue par l’œil humain, « L’homme à la caméra » inaugurait également des principes dynamiques de montage - « L’œil mécanique de la caméra, qui se refuse à utiliser l’œil humain comme pense-bête, recherche à tâtons dans le chaos des événements visuels, (…) le chemin de son propre mouvement ou de sa propre oscillation, et fait des expériences d’étirement du temps, de démembrement du mouvement ou au contraire d’absorption du temps en lui-même. » - Bien qu’absent de l’exposition, le film de Dziga Vertov ne cesse de hanter les deux films de 64 minutes 32 secondes que TTrioreau présente à Bourges. Le premier montre un long travelling aérien tourné de nuit au-dessus d’Odessa dans une tentative de cerner visuellement la ville. Lors de ce parcours, la caméra offre l’étrange image de vastes zones d’ombres sillonnées uniquement par le balai des phares de voiture le long des boulevards. Régulièrement, un bâtiment visiblement important (hôtels, église, mairie) car violemment éclairé vient trouer l’obscurité. Premier constat, la ville hésite. Elle n’est plus la perle soviétique symbole du communisme en marche. Elle n’est pas encore cette ville que l’Ukraine aimerait ouverte aux investissements étrangers. Ces pôles lumineux, sans véritable nécessité si ce n’est de faire signe, sont bien les marques d’une industrie capitaliste colonisatrice et déjà en train d’apposer les marques visuelles du spectacle qui lui est toujours nécessaire. Le film devient même tragique car au lieu du montage disruptif de Dziga Vertov, TTrioreau se contente d’un simple panoramique dépourvue du moindre montage. Impossible de filmer comme Dziga Vertov la monumentalité d’une ville engagée dans la révolution. Ici, l’effet de plongé la transforme en théâtre abstrait ou surgissent des formes, des lueurs, des flux, des mouvements linéaires. Dans les deux films (celui de Dziga Vertov et de TTrioreau) nous sommes bien face à un spectacle, l’un violemment engagé dans une syntaxe nouvelle alors que l’autre joue sur le registre d’une certaine objectivité, qualité qui nous le savons désormais est justement au cœur même de la définition du capitalisme comme représentation d’un ordre économique particulier. Le second film, présenté en vis-à-vis, offre l’image du dos de l’artiste tatoué par un professionnel. Lentement émerge une phrase en russe « Où est l’homme à la caméra ? », phrase par laquelle Dziga Vertov avait annoncé son film dans la Pravda. En inscrivant sur son corps cette injonction, TTrioreau propose une réflexion à double détente. Dans un premier temps, il s’interroge sur la qualité du message transmis. Son film montre évidemment que toute transmission d’information est soumise à l’entropie. Celle-ci paraît dans l’écriture cyrillique - incompréhensible - mais aussi dans le travail de tatouage ici filmé comme une maladie qui se répand et boursoufle un corps humain. L’encre suinte, dégouline comme si l’épiderme ne pouvait l’accepter. L’information s’inscrit ici dans un processus de brouillage qui en même temps devient un processus de subjectivation. La peau n’est plus un support mais le dernier rempart contre l’éparpillement des identités. Et il fallait sans doute en passer par Dziga Vertov, par cette l’illusion d’une utopie pour justement réactiver notre rapport au monde. Voilà la seconde leçon de cette exposition : puisqu’il devient impossible d’explorer le réel dans tout son hétérogénéité, l’activité artistique se doit de nouer un lien entre expérience personnelle et l’histoire collective. « Où est l’homme à la caméra ? », la sentence est une réponse au nihilisme de la célébration des valeurs. Elle les déjoue en offrant la vision simultanée d’un artiste qui se risque à prendre position comme citoyen en demandant à l’image d’être ce qu’elle n’est pas encore tout en offrant le spectacle critique d’un espace - la ville - d’où sont exclue tous les idéaux démocratiques. TTrioreau ne cesse, et ses dernières expositions à Glassbox puis au Frac des Pays de la Loire à Carquefou l’ont démontré, de s’intéresser à la ville et l’architecture comme symptômes d’un brouillage des valeurs de notre société. Ici, c’est la question même du politique qui ne cesse d’affleurer. Mais la gravité d’un tel questionnement ne pouvait qu’emprunter au cinéma sa valeur de séduction artificielle.
Damien Sausset, Art Press, numéro 323, avril 2006
DV – De la ville à la peau, de la peau à l’écriture et de l’écriture à la ville
L’officier montre au voyageur une bien singulière machine. Tripartite, elle se compose d’une dessinatrice, d’un lit et d’une herse. C’est l’implacable et démentiel instrument d’un châtiment. Le condamné s’allonge sur le ventre. Sur sa peau puis jusque dans sa chair va être inscrite sa sentence. Chaque aiguille métallique de la herse mettra douze heures à le transpercer entièrement, faisant de toute écriture une souffrance, une révélation déchiffrée de l’intérieur, une jouissance, une condamnation capitale. Ces douze heures sont à séparer en deux parties d’égale durée où la souffrance du condamné, violente et insensée les six premières heures, fait place peu à peu à une sorte d’extase lorsque celui-ci parvient, au terme d’un lent mouvement, à déchiffrer avec ses plaies ce qu’il ne saurait lire avec ses yeux, la loi harassante qui creuse son corps. Ce savoir là le conduit implacablement à la mort.
DV : deux longs métrages projetés simultanément, l’un consistant en un panoramique aérien et nocturne de la ville d’Odessa, l’autre en un plan séquence documentant la séance de tatouage que subit l’artiste. La salle d’exposition n’est pas éclairée autrement que par la lumière des deux écrans, faible et en hauteur pour la vue d’Odessa, puissante, blanche et proche du sol pour le tatouage. En outre, une composition sonore, musique concrète sous forme d’ellipse, relie les deux films en créant l’espace de leur rencontre. Rappel du rotor de l’hélicoptère survolant la ville et de la machine à tatouer ; vacarme assourdissant écrasant toute perception claire et ronronnement métallophone hachuré et précis. Le mixage annule les différences d’échelles et renforce les intervalles, créant ainsi un espace déroutant où l’on ne reconnaît pas ce que l’on connaît en même temps qu’il est une invitation à se déplacer d’un film à l’autre par le mouvement même du son. Tout se passe comme si l’oreille et l’œil cherchaient constamment à se synchroniser par delà les ruptures, tentant d’interpréter les disparités et les décalages en leurs assignant des sources identifiables sans pourtant jamais y parvenir pleinement. Dans cet environnement, le spectateur devient actif en expérimentant une certaine saisie du réel (espace de l’exposition rendu complexe par la pluralité des dispositifs) au sens où Dziga Vertov veut l’entendre : un dépassement, au moyen de l’analyse, des contradictions que le montage a préalablement renforcées et rendues manifestes, afin de faire apparaître du réel ce que seule la caméra pouvait saisir. Au fond, chez Dziga Vertov, c’est une théorie du montage qui précède le tournage. Suprématie de la caméra qui, comme une machine fascinante, se substitue à l’œil humain et se tient au-dessus du peuple ; processus historique vers le réel où le montage s’impose comme condition d’apparition de la vérité. La durée exacte des images bouclées sur les moniteurs est de 64 minutes et 32 secondes, la même que pour L’Homme à la caméra, source du travail de TTrioreau. Mais ici le montage tend à s’effacer le plus possible des films vidéo pour étendre sa dynamique à tout l’espace de l’exposition. Tout en conservant la problématique de Dziga Vertov, TTrioreau en prend techniquement et point par point le contre-pied afin d’instaurer un rapport dialectique questionnant le travail du cinéaste sur la modalité même qu’il préconise - celle du renforcement des contradictions - pour développer son propre rapport critique au monde contemporain.
En 1923, dans son manifeste, Dziga Vertov déclarait : « Je suis un œil. Un œil mécanique. Moi, c’est-à-dire la machine, je suis la machine qui vous montre le monde comme elle seule peut le voir ». C’est là le fondement du Kino-Pravda, du cinéma vérité : la caméra est un œil plus parfait que l’œil humain ; elle permet de révéler la réalité, elle est un instrument omniscient au service de la vérité. En 1929, L’Homme à la caméra représente pour ainsi dire la concrétisation parfaite des théories de Dziga Vertov. Ce film peut être vu comme une tentative pour mettre à jour l’activité des citoyens au cœur de l’industrialisation croissante de la ville d’Odessa et ce, en juxtaposant des fragments de réalité pris sur le vif que le montage organise en un ensemble représentant une vérité thématique. A l’opposé de son ennemi déclaré, le cinéma bourgeois et son cortège de scénarii, décors et autres acteurs, Dziga Vertov entend révéler le monde tel qu’il est, ou plutôt, tel qu’il ne peut être appréhendé que par l’œil-caméra.
L’officier explique que la machine va inscrire sur le corps du condamné, « respecte ton supérieur ». « Connaît-il son verdict ? » demande alors le voyageur. « Non », répond l’officier. « Il ne connaît pas son propre verdict ? » reprend le voyageur. « Non », répète l’officier. Et puis il ajoute : " Il serait inutile de le lui faire connaître, puisqu’il va l’apprendre dans sa propre chair ».
Lorsque TTrioreau se fait tatouer sur le haut du dos, en alphabet cyrillique, une annonce que Dziga Vertov fît paraître dans la Pravda avant la sortie de son film, il ne semble pas incongru d’envisager ce geste comme un écho du texte de Kafka, A la colonie pénitentiaire. Ce qui compte ici c’est le sens même de la phrase et la façon dont il sera permis de l’entendre : phrase tatouée énigmatique pour tout non russophone, y compris l’artiste lui-même qui ne peut l’appréhender que par le biais de la traduction. Manifestement, à l’aide de petites aiguilles métalliques, quelque chose vient lentement s’inscrire sur la peau de l’artiste, un texte dont la traduction ne sera pas livrée au spectateur dans le temps du film. La proposition ne manque pas d’esthétisme et tout le travail de post-production a été particulièrement soigné, noir et blanc magnifique pour un contraste très fouillé. L’inscription elle-même est stylisée, les formes géométriques du lettrage prenant à mesure que le film avance les volumes et la perspective d’une architecture constructiviste. Mais ce jeu formel introduit à dessein un glissement remarquable et surprenant où les vidéos viennent se rejoindre, se fondre l’une dans l’autre pour jouer le jeu d’une substitution. La lente émergence des lettres dans leur dimension architecturale nous renvoie à la ville même d’Odessa dont la présence, peu à peu, devient plus manifeste sur le corps de l’artiste que dans la prise de vue aérienne où les bâtiments, à la faveur d’une étrange métamorphose organique, disparaissent dans l’épaisse nuit ukrainienne. Les volumes perdent de leur consistance pour ne plus être visibles que comme lignes géométriques et, s’il demeure des îlots de résistance à cet écrasement, c’est avant tout en ce qu’ils sont conditionnés par une lumière particulière. Bâtiments commerciaux ou vitrine culturelle, sauvés arbitrairement d’un patrimoine à l’abandon, ceux-là se dressent crânement, mais la ville bat la mesure d’un cœur essoufflé qui peine à expulser tout ce rouge sang conservé dans ses murs en partie délabrés. Odessa lentement se délite, oubliée de ceux qui ont la charge de la faire vivre et qui ne font au mieux que la brader au bénéfice des profits immédiats. C’est ce que l’œil mécanique de la caméra capture et restitue. C’est la ville organique face au corps architecturé : « Mais où est passé l’homme à la caméra ? », traduction de ce qui se dessine sur le dos de l’artiste, loi scripturale médiatisée par l’écran qui irradie tout l’espace pour en faire un lieu de montage où les films vidéo se mêlent, se substituent puis se défont.
Le refus de la dramatisation et la mise en présence de fragments déconnectés sont des éléments que l’installation DV reprend à Dziga Vertov. Mais TTrioreau semble vouloir pousser cette logique jusque dans ses derniers retranchements : si le panoramique aérien d’Odessa peut bien correspondre à l’idéal vertovien du mouvement perpétuel, il n’en est pas moins une mise à distance (révélatrice) de la ville elle-même. Il constitue une abstraction au sein de laquelle le plan architectural se transforme en un ensemble formel à la géométrie étrangement organique et entraîne ainsi ce que l’on pourrait appréhender comme un devenir peau de la ville. Quant à l’inscription de la phrase parue dans la Pravda sur la peau de l’artiste, n’est-elle pas l’inversion exacte du sens qu’avait voulu lui donner Dziga Vertov ? La phrase tatouée, en effet, ne précède plus le film mais en est au contraire, au moment où elle est entièrement déchiffrable, la conclusion même. Il y a quelque chose de déconcertant dans le travail de TTrioreau, un quelque chose qui se situe dans le fait que, partant des thématiques propres à Dziga Vertov, tout est déplacé, constamment et à chaque endroit, pour venir court-circuiter l’idée initiale. Ce déplacement consiste dans le fait que le montage (ce qui fait tenir les choses ensemble pour Dziga Vertov) n’est plus présent dans les deux films montrés par TTrioreau, mais doit être compris comme l’espace même de l’installation. Ce qui rassemble les fragments de DV, c’est le face-à-face des projections dans lequel le spectateur est inséré et qu’il traverse, tant sur le plan visuel que sur le plan acoustique, grâce à la boucle sonore qui relie l’ensemble. Déambulation au gré de laquelle le visiteur fait l’expérience d’une peau qui devient pellicule, d’une ville qui devient peau et d’une écriture qui devient ville.
Il demeure le sens même de ce qui s’inscrit, incorporé à l’artiste et à sa biographie puisqu’il fait le choix de s’y lier de manière quasi indéfectible pour le reste de son existence. Cela, l’artiste ne saurait le voir et c’est cela même qui nous regarde. Le condamné de Kafka allait apprendre son châtiment dans sa propre chair. TTrioreau, quant à lui, se fait inscrire sur la peau ce verdict qu’il a pressenti : « Mais où est passé l’homme à la caméra ? ». La problématique se situe toute entière dans ce constat : la disparition de la subjectivité derrière le travail de la caméra. Si pour Dziga Vertov la tâche du cinéaste pouvait s’organiser selon la série, « je vois avec la caméra, j’inscris sur la pellicule et j’organise avec le montage », l’objectivité supposée de l’œil-caméra demeurait bien fragile puisqu’elle ne pouvait se passer du point de vue du cinéaste-monteur. Avec DV, c’est le corps lui-même qui devient le lieu de l’inscription, c’est la peau qui prend la place de la pellicule. L’espace de l’installation où se rencontre le corps de l’artiste et les corps des spectateurs produit la dynamique du montage et prononce le verdict de la disparition de l’homme derrière la caméra en produisant un sens qui, au regard de la pièce de TTrioreau, pourrait bien être celui d’une implacable condamnation.
Jérôme Duvigneau & Emmanuel Decouard
PRYSM
Invité par l’association Entre-deux en 2003 à développer un projet d’art public à Nantes, TTrioreau a préparé un double dispositif dans deux espaces nantais. prysm a été conçu durant une résidence l’été dernier au Frac des Pays de la Loire à Carquefou et à l’Ecole régionale des beaux-arts de Nantes. Au centre de ce dispositif, un no man’s land, dénommé le terrain de la Meuse, en contrebas du square Maurice Schwob, dans l’alignement de la Maison Radieuse de Rezé-lès-Nantes conçue par Le Corbusier et du quartier nantais d’habitat social Les Dervallières. Au centre de ce terrain, TTrioreau propose d’installer un large panneau, format cinémascope, composé de prismes réfléchissants. Ces prismes vont réfléchir l’espace, les bâtiments alentours et les voies routières avoisinantes. Ce qui préoccupe TTrioreau ici, ce n’est pas tant la notion d’architecture en elle-même, mais plutôt la question du cadrage. De quelle manière et à quelles conditions voit-on, discerne-t-on quelque chose dans l’espace public, telle est la question posée. L’architecture que forme le panneau à prismes est une architecture-écran qui viendra fragmenter les données urbanistiques au sein desquelles il s’intègre.
A l’heure actuelle, cette proposition reste utopique. Le terrain de la Meuse, en instance d’aménagement urbain, demeure fermé. Dans ce territoire en friche porteur de désirs et générateur de discussions, la proposition de TTrioreau cristallise ce débat. prysm tente de provoquer une rencontre à l’intérieur même de cet espace en devenir…
Du square Maurice Schwob, « plate-forme » d’observation panoptique, le terrain de la Meuse est appréhendé en plongée, et de l’autre côté de la Loire, la Maison radieuse du Corbusier en point de fuite. Une « table d’orientation », présentant l’image de l’implantation du panneau à prismes, suggère une possible réalisation de prysm.
La Maison radieuse à Rezé-lès-Nantes devient miroir et contre-point d’une trajectoire inédite qui mène au quartier les Dervallières à Nantes.
Une maquette - Maison Radieuse « réfléchissante » - prend place dans les locaux de l’association Entre-deux situés aux Dervallières. Le pouvoir de « réflexion » de cette installation superpose un questionnement entre deux types d’habitat collectif.
Éclats de ville
Et si le monde était constitué de prismes à dénouer, à décrisper, à faire pivoter ? Et ce, pour y retrouver la surface miroitante, un réel vif et coupant ? Composée de Marie-Laure Viale et de Jacques Rivet, l’association Entre-deux s’intéresse depuis bientôt dix ans à la place de l’art public dans la ville, à sa production et à sa médiation. Après avoir reçu Bruno Peinado, Pierre Joseph, Pierre Huygue et dernièrement Bruno Serralongue, Entre-deux invitait donc TTrioreau, durant ce mois de décembre, à développer un projet. Ayant pour titre PRYSM, l’œuvre de TTrioreau, réalisée pendant sa résidence l’été dernier à l’Ecole régionale des beaux-arts de Nantes et au Frac des Pays de la Loire, s’articulait sur un double dispositif dans deux espaces nantais différents.
Les propositions de TTrioreau prennent comme support l’architecture, elles mettent notamment à l’œuvre l’entité construite et ne cessent de questionner le territoire urbain. Procédant par repérages préalables, à l’aide de cartes et de parcours, l’artiste remarqua un axe particulier entre la Maison Radieuse à Rezé-lès-Nantes, conçue dans les années 50 par Le Corbusier, et les habitats du quartier nantais des Dervallières, avec le temps devenu un succédané de la première. Cette ligne muta pour TTrioreau en une trajectoire géographique, symbolique et sociale.
Le premier des espaces devait prendre place au centre de cet alignement, le terrain en friche de la Meuse, et consistait en l’installation d’un large panneau reflétant à prismes. Format cinémascope, celui-ci devait agir comme un kaléidoscope renvoyant de l’environnement aux alentours. Organiser un voyage immobile, où rien n’était figé : une séquence, son défilement et sa résonance mentale. Le terrain en instance d’aménagement urbain demeurant fermé, il est devenu par le geste de l’artiste, une fiction. Une utopie matérialisée par une « table d’orientation » en haut du square Marcel Schwob, plate-forme d’observation panoptique pour la circonstance. Surplombant le no man’s land et ayant en point de fuite la Maison Radieuse, elle suggère la possible réalisation à terme du projet.
La maquette - Maison Radieuse « réfléchissante » - présentée dans les locaux d’Entre-deux aux Dervallières représentait le contrepoint, le pendant giratoire à la construction de Le Corbusier. Sur le modèle cinématographique d’un travelling continuel en trois temps, elle dressait les contours toujours mouvants d’une ville, un screen city. « L’œil, ce n’est pas la caméra, c’est l’écran », disait Deleuze. Repeupler un paysage, non pas l’occuper mais le faire tourner à une vitesse régulière avec ses suspensions. Faire ressentir le transit d’un espace. Une trouée, une béance, une zone toute passagère.
Une re-version des formes, une réplique. L’image d’une architecture qui glissait silencieusement et jamais ne se brisait. Ce n’était pas la maquette qui bougeait, c’était tout le reste, avec tout le reste. Cet interstice dans lequel le monde s’interposait. Les œuvres de TTrioreau sont souvent l’endroit des basculements, renversements que l’on translate, de la même manière que l’on change les perspectives. Celles-ci développent régulièrement un jeu sur les rapports extérieur/intérieur, elles tiennent de la transformation, du processus. Ses pièces sont comme des incursions, créant momentanément une perturbation intempestive, une interférence dans l’ordre des choses. La maquette était l’endroit qui résistait et restait effectif pour l’artiste, elle s’actualisait sans cesse.
PRYSM dispensait un transit dans l’espace, sollicitant les traces, les survivances et les devenirs. Mélancolique et neutre, poétique et politique, fractale, elle interrogeait un futur, une histoire, un passé : faire ricocher le regard et sa rotation. Le mouvement à l’intérieur duquel nous nous trouvions, notre façon de nous déplacer, notre mémoire rétinienne. Un segment du temps qui passe et qui faisait reverb. « Entrer marcher pendant que les autres dorment / Voir les couleurs, voir les formes / Les villes sont des villes bordées de nuit […] allumez l’écran merveilleux / Quand le jour s’achève […] découper le monde à coups de rasoir … »
Frédéric Emprou, revue 303
TIMECODE
Trois pièces : HOROQUARTZ, maquette d’une usine dessinée par le peintre Georges Mathieu, TIMECODE, panneau sur lequel défile au 1/24 de seconde une série de dix chiffres et, enfin, PRYSM, structure à prismes verticaux réfléchissants, lumineux et rotatifs. Un lieu : GLASSBOX.
Partant de là, quel est le lien à partir duquel s’organise la circulation entre ces différents éléments ? Dans un premier temps, il est possible de répondre que le projet TIMECODE s’inscrit dans la continuité des travaux réalisés par TTrioreau durant ces dix dernières années et prolonge un corpus de réflexions sur la mobilité des structures architecturales et la redéfinition des frontières spatiales qui sont censées leur être propres. Pour TTrioreau, il s’agit de mettre à jour un entre-deux de l’architecture compris comme un espace intermédiaire et capable de recueillir les modifications visuelles, physiques et sonores consécutives à des séries de transformation sur la thématique de l’urbanisme. Ce qu’une installation doit réussir, dans l’optique de TTrioreau, c’est d’agir sur la structure même de l’espace investi ; elle doit mettre en place des déplacements (par exemple au sein du couple intériorité/extériorité) qui perturbent notre perception normée.
Pour TIMECODE, conformément à sa démarche habituelle, TTrioreau ne se propose pas de simplement intégrer GLASSBOX mais bien plutôt d’occuper cet espace, de le transformer, le fragmenter et le réfléchir pour nous en offrir une nouvelle interprétation.
Le point de départ de ce processus est la maquette de l’usine HOROQUARTZ. Bien que l’architecture même de ce bâtiment soit d’une richesse certaine – structure en étoile à sept branches – ce n’est pas en tant que simple maquette (en tant que représentation d’un objet déjà donné) que HOROQUARTZ fonctionne. Il s’agit avant tout de mettre en place une surface réfléchie/réfléchissante (elle est en effet la réflexion d’un objet architectural en même temps qu’elle réfléchit cet autre objet qu’est GLASSBOX) qui vient comme barrer et fragmenter le lieu de l’exposition.
A ce premier dispositif répond TIMECODE : là où la question du temps n’apparaît pas directement dans la pièce HOROQUARTZ (et pourtant c’est là l’activité de la réelle entreprise, la gestion des temps), TIMECODE semble s’inscrire dans cette perspective. Les chiffres qui défilent sur cette pièce évoquent, ainsi que son nom même, le processus de l’indexation cinématographique. Mais le parallèle s’arrête ici : le défilement produit par TIMECODE est perpétuel ; pas de valeur d’indexation possible mais un temps qui en semblant s’échapper, en sortant de ses gonds, vient briser l’écoulement de l’enregistrement en un faux-semblant de chronométrage. Là où HOROQUARTZ entend barrer et fragmenter l’espace de l’exposition, TIMECODE déplace et parasite le temps consacré à la vision de ce dernier.
PRYSM, enfin, vient comme clore la boucle. L’écran formé par cette pièce est une surface mouvante qui démultiplie indéfiniment le lieu et le regard du spectateur. PRYSM met en mouvement tout en fragmentant à nouveau le dispositif global de l’installation.
Aux trois pièces proposées par TTrioreau correspondraient donc trois moments : premièrement la mise en abysse de l’espace architectural dont HOROQUARTZ forme la dimension réflexive ; deuxièmement, un détournement du temps compris non pas comme nombre du mouvement mais comme structure autonome et indifférenciée ; et, enfin, une image-mouvement qui est à la fois la fragmentation de l’espace global et la répétition même de l’appréhension de ce dernier.
C’est par la mise en circulation de ces différents moments que TIMECODE interroge le lieu même de GLASSBOX, ou ce qui pourrait être son intégrité imaginée, et, plus largement, opère la création d’un lieu atypique à partir duquel peuvent se mettre à vibrer entre elles les dimensions parfois hétéroclites de l’art et de l’architecture.
Emmanuel Decouard
2, RUE GASTON GUILLEMET, 85200 FONTENAY-LE-COMTE, 2004
TTrioreau : logique disloquée et utopie
C’est la ville qui fournit ses contenus aux travaux de TTrioreau. Soit un espace, un réseau urbain : quelles sont les forces en présence, quels principes régissent les assignations, les territorialisations ? Pour TTrioreau, la ville n’est pas une structure figée mais bien au contraire le théâtre d’intensités dont les résolutions ne sont jamais jouées à l’avance. Il y a, bien sûr, comme une fixation, un arrêt sur image qui gèle la ville dans une figure donnée et apprêtée. Cet arrêt, on le nommera politique au sens de la mise en présence de différents acteurs qui organisent les flux (les élus, le marché, la population et les interactions qui se tissent entre eux). L’image figée de la ville est un moment d’équilibre entre ces éléments. Ce point d’équilibre, malgré la solennité de certaines architectures, n’est pas immuable, et c’est précisément cela qu’entend montrer TTrioreau. Le possible de la ville, ses devenirs multiples, sont en quelque sorte cristallisés dans les pièces de l’artiste par des processus de brouillage, d’hybridation et de déterritorialisation de certains éléments du tissu urbain. Il s’agit donc, pour TTrioreau, de « faire dire » à ses installations quelque chose sur le réseau urbain, un « dire » déjà présent dans la configuration de la ville et que l’œuvre d’art, par les déplacements qu’elle opère, est en mesure de mettre à jour, de déceler.
A partir de ces prémisses, notre question sera de cerner comment s’organise ce discours ou, pour le dire plus précisément, comment se distribuent les rôles entre l’objet esthétique, son contenu et les propositions constituées par leur conjonction. Certaines des œuvres récentes de TTrioreau, de par la concrétion des motifs et des thèmes propres à l’artiste qu’elles réalisent, nous ouvrent la possibilité d’une réflexion.
A l’origine, il y a Bourges et une installation réalisée à La Box en 2001 : TTrioreau avait alors totalement réinvesti et ré-agencé le lieu d’exposition. Ce qui était les deux vitrines de la galerie avait été transformé en entrées propulsant le spectateur au sein d’un réseau complexe qui le mettait à proximité, sans en lui garantir l’accès, d’un caisson lumineux sur lequel s’intégraient deux photographies duratransâ représentant un immeuble de la zone péri-urbaine de Bourges, immeuble de logements sociaux désaffecté et promis à une future destruction. Le caisson lumineux, monté sur rails, se déplaçait à son tour et, au travers de la troisième ouverture de la galerie, opérait une translation pour venir quasiment obstruer la rue et gêner la déambulation des passants et le passage des voitures.
2004, Fontenay-Le-Comte : la photographie de l’immeuble est toujours là. Elle est maintenant enchâssée dans une massive structure en inox-miroir évoquant une sucette publicitaire. L’arrière de cette structure est maintenant écorché et laisse voir les rangées de néons qui illuminent la photographie. Place laissée comme vide, le flux lumineux est orienté vers une baie vitrée qui elle-même donne sur la voie publique. De Bourges à Fontenay-Le-Comte, la représentation a bougé : alors que l’image de l’immeuble se déplaçait littéralement dans la rue, ce n’est maintenant que son creux en tant que source lumineuse qui est montré. Pourtant, complétant la première, une autre structure, en inox-miroir elle aussi, vient refléter l’image. Même si l’on se tient à l’extérieur de l’installation, on pourra donc surprendre, en un singulier processus fragmenté, l’image-miroir de l’immeuble. A cette seconde structure revient également une autre fonction : éclairer une « table basse » en inox brossé dans laquelle est intégré un catalogue-prototype , une maquette qui fait signe vers l’exposition de Bourges.
Architecture et urbanisme sont bien convoqués ici, tout comme un certain brouillage des catégories propres à ces champs : qu’est-ce qui perdure et qu’est-ce qui disparaît ? Quelles places recueillent les notions de fixité, de mobilité et de disparition ? Quel est l’intérieur de l’œuvre et quel est son dehors ? Il y a aussi la volonté de TTrioreau de se frotter concrètement au lieu de l’exposition, c’est-à-dire d’utiliser l’espace et ses potentialités comme parties intégrantes de l’œuvre et non pas simplement montrer une pièce dans un environnement neutre (on notera que les titres des œuvres de TTrioreau se confondent avec l’adresse du lieu où elles sont à voir). La question politique et sociale est également présente avec la représentation d’un édifice typique d’une cité défavorisée au cœur de l’hyper-centre (bourgeois) des deux villes (et ce, sous un mode évoquant la publicité : le néon comme réclame).
Les travaux de TTrioreau peuvent donc être envisagés sous un régime d’oppositions multiples dont les couples dehors-dedans, temporaire-permanent et centre-périphérie forment une base significative. Or, cette dynamique oppositionnelle, que nous dit-elle sur l’œuvre d’art ? Ou, plus exactement, comment s’articulent ces oppositions qui proviennent d’une part de la lecture première de l’œuvre et, d’autre part, de la logique interne des pièces ? L’enjeu, ici, est de pouvoir lier conceptuellement le matériau extrait du réel concret et le matériau formel de l’œuvre.
Il y a, premièrement, cet immeuble de la banlieue de Bourges qui réapparaît à ces trois moments distincts que forment les deux installations et, entre les deux, le futur catalogue. A chaque occurrence son mode de représentation a été modifié (caisson lumineux sur rails, impressions sur catalogue et image fixée sur une structure immobile). Par ailleurs, ce vers quoi fait signe cet immeuble, c’est sa propre destruction. Son image, c’est le dernier souffle avant l’éradication. Traversée par des notions oppositionnelles, la permanence du motif de l’immeuble entraîne le travail de TTrioreau sous un régime dialectique. Mais que vient exactement réunir ce régime dialectique ? Autrement dit, la réalité concrète est-elle relevée dans l’œuvre qui elle-même, parcourant les trois moments de sa manifestation, se recueillerait dans un sens élargi ?
La logique même des pièces de TTrioreau tout comme la circulation entre les trois moments de leur monstration interdisent d’apporter une réponse frontale à ces questions. Dans cette optique, c’est le projet-catalogue lui-même, intercalé entre les deux manifestations concrètes du travail de TTrioreau qui recueille un rôle majeur. En effet, ce dernier ne documente pas tant la première exposition qu’il la continue par d’autres moyens. Sa forme déjà, celle d’un parallélogramme irrégulier aux bords tombants, reprend l’allure générale du bâtiment représenté tout comme elle préfigure peut être sa chute programmée et déplace ainsi le thème de l’installation plutôt qu’elle n’en inscrit la trace. Le recours, ensuite, à une typographie dispersée et fuyante constitue, pour les textes qu’elle compose, comme autant de perspectives sur un objet qui ne se trouve donc pas circonscrit mais éclairé par différents points de vue élaborés à partir de différents lieux. En ce sens, le catalogue est un objet autonome comme le prouve son intégration, en tant que partie essentielle, à l’actuelle installation de Fontenay-Le-Comte. De plus, la caractérisation en tant que prototype du catalogue modifie irrémédiablement la circulation entre les pièces. Le lien que paraît tisser le catalogue-maquette entre les deux installations est en fait une nouvelle proposition. Du cœur même de l’œuvre qui a déjà subi une translation géographique entre différents lieux et une transformation de la modalité de la présentation, le catalogue-prototype fait signe vers une autre configuration possible. Il est en quelque sorte le refus de la fixation et constitue un trait intensif qui entraîne l’œuvre à toujours outrepasser ses propres frontières.
Si donc il semble bien y avoir une dialectique à l’œuvre dans le projet de TTrioreau (régime oppositionnel, négativité et relève), il s’agirait ici d’une dialectique qui ne se résoudrait pas dans la figure de l’identique. Une telle dynamique a déjà été pensée par Theodor W. Adorno lorsqu’il écrit : « La dialectique comme procédé signifie la contradiction inhérente à la chose et, contre cette contradiction, s’efforcer de penser en termes contradictoires. Contradiction dans la réalité, elle est la contradiction de cette dernière. […] Son mouvement n’est pas celui de l’identité dans la différence de chaque objet d’avec son concept ; elle est bien plutôt le soupçon face à l’identique. Sa logique est celle de la dislocation : dislocation de la figure apprêtée et objectivée des concepts que, tout d’abord, le sujet connaissant a immédiatement face à lui. » La question est ici de maintenir une pensée conceptuelle de type dialectique, c’est-à-dire qui puise sa dynamique au plus près du réel et de ses contradictions, tout en ne cédant pas aux figures de l’identité et de l’unité qui viendraient comme figer le flux du réel concret. Cette dialectique est à comprendre, nous dit Adorno, comme une logique de la dislocation. C’est là que se tient, à notre sens, le point de rencontre entre les travaux de TTrioreau et ce qu’a pensé Adorno sous le mode de la dialectique négative (cette rencontre est à comprendre comme une pointe, comme un trait. Ni totalement fortuite, ni radicalement arbitraire, elle ne subsume pas pour autant, elle ne circonscrit pas. Elle est bien plutôt comme une intercession, un point de vue qui découvre l’heureux moment d’une coïncidence).
« Dislocation » est la traduction de l’allemand Zerfall. Cette traduction n’est pas parfaite, elle ne correspond pas point à point : là où le terme allemand intègre la notion de chute (Fall), le terme français renvoie à ceux de lieu (le locus latin) et à la séparation, la différence. Et pourtant d’une langue à l’autre viennent se tisser des liens de complémentarité : la dislocation française peut également devenir une chute, celle d’un empire par exemple, et le Zerfall allemand peut aussi être une désagrégation, c’est-à-dire une séparation de parties localisées. Cette rencontre que nous évoquions en devient concrète : l’immeuble qui traverse les trois moments du projet de TTrioreau est en état de Zerfall - il va bientôt se désagréger, il va bientôt chuter - et la logique de sa présentation suit celle de la dislocation : une partie de la périphérie de Bourges est violemment déplacée et extraite de sa place normale. Mais, plus encore que son motif, c’est l’œuvre elle-même, de par sa dynamique propre, qui se tient tout entière sous le mode de la dislocation. Elle disloque le lieu de son exposition, non seulement dans un sens temporel et géographique, mais aussi dans un sens très concret : elle ouvre, elle écorche littéralement les bâtiments qu’elle investit.
Ainsi se trouvent « liés » les divers éléments du travail de TTrioreau : la destruction comme cœur négatif de la représentation, la reprise en différents lieux et sous différentes formes des motifs et la coexistence de contradictions, voire l’impossible simultanéité de différents traits. Il y a là un souci du réel et de sa manifestation sous une forme violente et contradictoire en même temps que la volonté de ne pas renoncer à penser ce dernier sous un mode lui-même contradictoire et oppositionnel. Les travaux de TTrioreau, bien sûr, ne peuvent être simplement reconduits à une philosophie préexistante, en l’occurrence celle de la dialectique négative. Néanmoins, le soupçon de l’identique tout comme la logique de la dislocation et son orientation sur l’immédiatement réel sont autant d’éléments qui permettent d’entrevoir l’œuvre d’art sous un jour des plus féconds. Dans cette optique, les juxtapositions, les déplacements et les oppositions qui traversent les pièces de TTrioreau ne se reconduisent pas à une unité illusoire mais s’organisent en une constellation. A partir de là émerge la notion du possible, dans la pensée comme dans l’art.
Notre question initiale était d’éclairer le flux composé par les pièces de TTrioreau et leur contenu, le tissu urbain. Autrement dit, il s’agissait de préciser la relation existante entre un objet esthétique et une réalité concrète. Or, cette logique de la dislocation entrevue dans les travaux de TTrioreau fait maintenant signe vers la notion d’utopie. En effet, si les moments oppositionnels de l’œuvre ne peuvent être lus sous l’angle d’un régime dialectique visant la figure de l’identique et une résolution ultime, il n’en reste pas moins qu’une articulation entre le réel, sa pensée et le possible reste éminemment de mise. Cette articulation est envisagée par Adorno de la manière suivante : « La connaissance qui veut le contenu veut l’utopie. Celle-ci, la conscience de la possibilité, s’attache au concret en tant que non-défiguré. C’est le possible, jamais l’immédiatement réel, qui fait obstacle à l’utopie ; c’est pourquoi le possible, au sein de l’existant apparaît comme abstrait. » Tout l’enjeu, ici, est de vouloir le possible à partir même de l’immédiatement réel. Comprise ainsi, l’utopie n’est pas ce lieu qui n’existe nulle part, elle ne constitue pas une sortie abstraite du réel, mais elle est bien plutôt, comme le dit Adorno, la « conscience du possible ». Or, n’est-ce pas justement à cette conscience du possible, à cette utopie que nous convient les travaux de TTrioreau. En effet, en disloquant le réel (en l’occurrence l’espace urbain), il nous semble que TTrioreau nous donne accès au concret en tant que « non-défiguré », un concret certes tendu par les oppositions et les séparations, mais un concret qui, en revanche, n’est plus recouvert par une figure apprêtée de la représentation. Les œuvres de TTrioreau ne sont pas la dénégation des forces contradictoires qui constituent le réel, mais elles constituent au contraire un écart, un interstice à partir desquels peut émerger le possible.
C’est là ce qui nous apparaît comme un point capital dans le travail de TTrioreau : les œuvres de l’artiste ne consistent pas, en partant du réel donné de l’espace urbain, à tendre un miroir à ce dernier et à provoquer ainsi une opposition simple comprise sous le régime d’une critique sociale élémentaire. Il nous semble bien plutôt qu’il s’agit d’une expérience : l’œuvre d’art, en décelant un immédiatement réel non défiguré, entraîne le spectateur dans cet écart, cette fissure où l’utopie finit par trouver son lieu.
Pure expérience du spectateur qui se tient au centre de l’installation de Fontenay-Le-Comte et qui, plongé dans la double réflexion de la structure métallique, est amené à sentir cette dislocation à partir de laquelle advient, non pas la figure de l’identique, mais bien plutôt celle du possible sous l’angle du devenir.
Emmanuel Decouard
Art Présence, n°52, octobre-novembre-décembre 2004
BLUE EXTENSIBLE MEZZANINE, convertible, 2003
La pratique de TTrioreau est diverse: son travail artistique se complète d'une réflexion portant sur l'architecture, l'urbanisme, voire l'aménagement intérieur, et ce à travers différents médiums: installations, vidéos, projets architecturaux. L'artiste travaille sur les limites des espaces architecturaux ou territoriaux, et crée dans cette optique des espaces aux frontières mouvantes. Le jeu entre intérieur et extérieur s'en trouve amplifié, grâce à la mobilité rendue aux espaces immobiliers. TTrioreau questionne donc directement la politique de l'aménagement urbain, de ses carcans normalisés et normalisants. L'architecture prend ses aises à travers son œuvre, s'étale dans l'espace urbain, sort de ses limites pour devenir extra-ordinaire et originale.
Dans blue extensible mezzanine, œuvre produite spécifiquement pour l'exposition, l'espace s'agence au fur et à mesure du temps et selon l'espace d'accueil mis à disposition. Cette mezzanine, également source lumineuse, peut devenir paroi ou support. Elle peut diviser l'espace ou en créer un supplémentaire, s'abaisser un peu ou complètement. L'espace de l'exposition devient ainsi modulable, mobile, malgré son statut d'œuvre d'art liée directement à l'architecture, c'est-à-dire à l'immobile.
Blue extensible mezzanine : faire sens dans le dialogue avec le présent et le passé
Dans le cadre de la programmation d’une exposition en partenariat avec le département d’histoire de l’art de l’Université François Rabelais de Tours et le Centre de Création Contemporaine de Tours, le Bureau Des Etudiants a invité TTrioreau à réaliser une production spécifique pour l’exposition Convertible. L’ensemble des oeuvres présentées a été agencé pour un dialogue avec le Pavillon de l’Esprit Nouveau de Le Corbusier. D’un début de siècle à l’autre, l’histoire de l’art et de l’architecture ont produit des oeuvres originales qui instruisent toujours un dialogue vivant avec le passé. L’œuvre de TTrioreau s’inscrit donc dans une double dimension de l’échange : il dialogue avec ses contemporains et, avec eux, il conjugue et propose un point de vue dans l’entretien avec l’œuvre de Le Corbusier. A partir d’une réflexion sur l’espace intérieur du Pavillon de l’Esprit Nouveau, blue extensible mezzanine, rideau métallique (porte de garage) orné de néons bleus, choisit d’évoquer sur un mode à la fois personnel et didactique le second niveau du Pavillon, précisément l’étage du bâtiment et le système de cloison mobile que son auteur a conçu. Le parti pris d’une mezzanine repose sur une lecture de l’œuvre de Le Corbusier qui privilégie deux points essentiels à l’habitation : l’extension et l’aménagement. L’aménagement d’abord parce que les autres oeuvres présentées dans Convertible nécessitaient une unité de sens de la même manière que Le Corbusier avait conçu l’unité de l’aménagement intérieur de son Pavillon. Tous les visiteurs de l’exposition ont pu remarquer que blue extensible mezzanine structurait l’ensemble des propos artistiques dans une sorte d’allégorie intemporelle. L’extension ensuite parce que l’idée de Le Corbusier comptait certes sur un caractère modulable du cloisonnement de l’espace mais soulignait déjà l’enjeu vertical d’une telle mobilité. TTrioreau a choisi d’évoquer ces deux dimensions en installant un rideau métallique qui se soulève depuis le sol jusqu’à recréer un plafond lumineux. Cette oeuvre renvoie en même temps à l’espace intérieur du Centre de Création Contemporaine puisqu’il répète ironiquement la porte de garage mobile déjà existante au même endroit. Intentionnellement et concrètement, l’espace est ainsi totalement circonscrit et en même temps totalement ouvert. Tout contre et par-dessus les autres œuvres, blue extensible mezzanine reproduit une logique que des architectes contemporains questionnent de façon récurrente : l’habitat nomade et la construction modulable.
Un principe d’état et l’être-en-transit : blue extensible mezzanine, une oeuvre in situ convertible
Et c’est bien de cela dont il s’agit depuis de début des recherches de TTrioreau sur l’architecture ; en dix ans, les projets et réalisations qui se sont succédés explorent de façon critique la logique politique et économique de l’habitation moderne. Toutefois, à la déconstruction brutale de l’urbanisme qui sévissait dans un premier temps s’est développée une conception d’architectures utopiques plus positive. Dans celle-ci se joue toujours une forte dimension critique et activiste mais avec ceci de singulier que l’ensemble des contraintes psychosociales mise à jour donnent naissance à des alternatives possibles ainsi que le montre le projet New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. L’œuvre réalisée et présentée au Centre de Création Contemporaine, blue extensible mezzanine, se trouve à la croisée de deux autres opérations dont l’une s’est produite à l’Ecole supérieure des beaux-arts de Tours en 1998 et l’autre doit être actualisée à Hong Kong durant l’année 2004 dans le cadre d’une bourse de recherche accordée par l’AFAA - Villa Médicis hors-les-murs. Lors d’une première résidence à Hong Kong, le constat fut immédiat : l’architecture doit sortir du réflexe des constructions immobiles fortement soumises à la figure du monument qui sacralise le logement comme sphère exclusivement privée. Contre cette tendance, des initiatives spontanées et anarchiques s’affirment : les extensions sauvages d’appartements à Hong Kong en révèlent la violente nécessité. En réaction à la concentration et aux contraintes politico-économiques, les habitants ont pris l’initiative d’occuper l’espace aérien qui entoure les immeubles de la mégapole en construisant, sur le vide, des prolongements d’habitats. En 1998, Vincent Protat et Hervé Trioreau, protaTTrioreau, ont réalisé une maquette à l’échelle 1 de ce type d’extension sauvage. Présentée dans l’espace d’exposition de l’Ecole supérieure des beaux-arts de Tours, elle mettait en scène une sorte de dialectique entre le dedans et le dehors, l’espace privé et l’espace public, la construction de bâtiments et le parasitage architectural. Avec blue extensible mezzanine, une étape préalable au futur projet de Hong Kong a été marquée : d’une part il s’agissait d’acquérir une compétence technique efficace en matière d’utilisation sur mesures d’éléments de construction métallique industrielle et, d’autre part, d’inscrire plus radicalement encore l’idée d’architecture nomade à la fois dans l’espace et dans le temps. Si blue extensible mezzanine a été produite sur mesure pour le projet Convertible au Centre de Création Contemporaine, reste que cette oeuvre est totalement ré-activable dans tous les lieux d’exposition. Le nomadisme consiste en l’occurence à produire de l’in situ modulable. C’est le principe même de toute la démarche artistique et architecturale de TTrioreau. Et derechef, la mobilité concernant le temps relève d’une même démarche et d’une même opérativité : le dialogue avec Le Corbusier prouve que l’architecture comme tous les autres arts, peinture, sculpture, danse, musique, littérature, …, est en permanence reprise, transformée et converti[e]. Convertible est un titre mais aussi une certaine logique interne. blue extensible mezzanine n’est autre que le nom d’une opération actualisée à un moment de l’espace et du temps qui déploie un mouvement d’extension en transit dans l’espace et le temps.
BP 297 – 9, RUE EDOUARD BRANLY, 18006 BOURGES CEDEX
Les propositions de TTrioreau s’inscrivent dans une réflexion liée à la nature du réseau urbain. Leurs installations agissent sur la structure même de l’espace construit et produisent des déplacements qui perturbent notre perception. Elles désignent de façon politique le caractère normatif de l’architecture, la soumission des villes aux lois du marché.
Son travail se concentre sur un examen des intervalles urbains, des articulations entre intériorité et extériorité, espaces privés et espaces publics, ou encore, entre art et architecture.
Sensibles à l’histoire des utopies urbaines et sociales, TTrioreau crée « in situ » et principalement hors des lieux d’exposition.
Alice Laguarda, philosophe et architecte, éditions Jean-Michel Place
CONTRE-ARCHITECTURE UTOPIQUE
« Les expositions d’art auront à l’avenir pour mission de montrer la peinture et la sculpture dans le contexte de l’architecture, de redonner vie au sens initial des arts plastiques qui est d’avoir une fonction dans la construction ».
Réponse au questionnaire de l’Arbeitsraf für Kunst, Walter Gropius
L’architecture, dans son idéal, est une tentative d’expliquer la société par sa construction même, c’est l’ultime forme qui pousse tous les arts à s’affirmer aux yeux de tous. Elle place l’humanité au centre de son logis où s’abrite ses convictions et ses motivations premières. L’architecture représente la première des grandes utopies sociales : elle déplace le sujet sur le giron de sa communauté. Toute maison est une topo-utopie, une île posée sur l’erg du monde, comme le furent en leurs temps la cité et le temple. Maison communautaire ou non, c’est la première des utopies réussies ou ratées. C’est un refuge et c’est un centre : un lieu d’abandon, de réflexion, de mémoire, de retranchement actif qui va s’associer à l’enfance, à la famille, au groupe… Sa construction, son orientation, ses matériaux, valident l’histoire culturelle d’un peuple, d’un pays, d’une époque .
L’histoire jeune de protaTTrioreau commence en 1995 lorsque deux tourangeaux passionnés d’architecture, Vincent Protat et Hervé Trioreau, se retrouvent dans un hangar voué à la destruction où ils élaborent ensemble leurs premières réflexions et expérimentations sur l’architecture urbaine et son rapport aux arts plastiques. De l’aventure architecturale à l’aventure du voyage, les voilà déjà partis vérifier leurs concepts en examinant des appartements proliférant dans une grande métropole asiatique en mutation accélérée. Observant les gens qui y vivent, constatant l’organisation architecturale et spatiale des bidon-villes et la construction spontanée justifiée par la paupérisation, ainsi qu’ils l’ont entrepris à Hong-kong, ils en reviennent pour s’investir et l’appliquer dans le décalage de leur région. C’est à Tours, dans une maison abandonnée près du Centre de Création Contemporaine, qu’ils montent un projet en apparence burlesque permettant aux visiteurs de découper chirurgicalement le corps du bâtiment au scalpel visuel. L'intervalle, le passage, l’hybridation, le métissage, la prothèse architecturale, la géopolitique, l’interface sont autant de données qui fondent l’analyse entreprise dans leurs recherches : une architecture modulaire qui procède par agrégats, raccordements, entassements, juxtapositions et qui trouvent ses applications artistiques dans une dimension humaine.
Contre-architecture mobile / contre-architecture labile
Pour les futuristes italiens et russes, que ce soit Marinetti, Lioubov Popova ou Alexandre Vesnine, l’architecture en aucun cas ne devait être statique ou rigide, mais se devait, au contraire, d’être constamment en mouvement comme l’eau de la mer, mouvements de la machine reprenant la gestuelle moderne, ou encore composée de matériaux vaporeux ou nuageux. L’immense structure transparente de Tatline pour le siège de la Troisième Internationale de 1919, dont la maquette fut promenée dans toutes les rues, était composée d’une spirale d’acier sur un axe asymétrique, des corps de verre à révolution interne, et munie d’un système de projection de textes dans le ciel par temps couvert, un projet qui marque encore des artistes contemporains ainsi que Michel Aubry l’a récemment démontré au Centre d’art contemporain de Vassivière en Limousin. En 1919 encore, l'expressionniste Bruno Tant sort un portfolio intitulé Architecture alpine dans lequel il imagine un monumental ensemble de cathédrales de verre resplendissant au milieu de chaînes de montagne, tandis que l’architecte russe Georges Kroutikov dessine lui, en 1928, un bâtiment flottant dans l’espace. Aujourd’hui, et pour aller hâtivement, l’artiste polonais contemporain Krzysztof Wodiczko, connu pour ses « projections publiques », dénonce pour sa part « la principale occupation du monument » qui se doit de rester immobile, d’être enraciné en permanence dans le sol et s’abstenir de tout mouvement visible, afin d’annexer par là même son idéologie sur le temps et le territoire. L’architecture valide ou dénonce donc aussi une forme de stratégie, une stratégie dans ce cas qui n’est pas nouvelle quand, pour reprendre la fameuse phrase de Mirabeau prononcée aux députés des communes : « il leur suffit de rester immobiles pour se rendre formidables à leurs ennemis ».
Un dispositif faisant irruption aux flux de circulation : l’obstruction comme invitation
La Box , à Bourges, est un lieu d’exposition juxtaposant l’Ecole nationale des beaux-arts de la Ville. C’est un lieu de dimension modeste, séparé en deux salles inégales en surface : la première ayant une entrée sous un porche et la seconde percée de trois porte-fenêtres vitrées (1500 mm x 3800 mm chacune) donnant sur une rue extérieure. Le binôme protaTTrioreau est intervenu, dans le cadre de leur résidence, du 25 janvier au 2 mars 2001, et a pris connaissance du lieu et de son environnement. Sachant l’analyser, ils ont investi l’espace dans le but d’en faire une architecture en rupture, sculpturale et spatiale, dialogique, fixe et labile, ouverte et fermée, mouvante et agissante à la fois sur elle-même et sur le monde extérieur. A cet effet, les baies vitrées ont été déposées, les passages, ainsi ouverts, permettant alors aux passants de pénétrer l’architecture à condition de lever le pied, et de parcourir la salle dans sa largeur sur un parcours obligé, guidé par des cloisons vitrées. Les espaces de la galerie et de l’œuvre se font le piège d’un processus bifide et composé où les statuts basculent dans un rapport physique et visuel. Le piéton, entre inclusion et exclusion, dans ce double mouvement, se fait par là même autant visiteur que sujet à voir, et qui troque sa position de sujet regardant de son aquarium et de sujet regardé par derrière la vitrine, la première salle demeurant ouverte au public où était présentée une maquette du projet. L’entrée par le porche offrait ainsi un point de perspective unique entre le « modello » et son extension visible, tandis qu’au centre des ouvertures extérieures, un dispositif coulissant présentait un double cibachrome sur caisson lumineux de dimension humaine (2500 mm x 1650 mm). Il représentait un immeuble année cinquante de treize étages au chiffre interdit : une tour emblématique / ithyphallique, symbole de la reconstruction hâtive mais qui figure et déplace au mieux le passé architectural de la Ville de Bourges et le terrain social de proximité.Contre-architecture érotique
« Le public ne tient compte que d’une chose, affirmait Donald Judd, il faut que l’art qu’il voit ressemble aux reproductions qu’il peut voir dans les livres d’art » . En reprenant l’outillage publicitaire, protaTTrioreau s’approprient le langage artistique le plus répandu et le plus lisible, un langage intermédiaire entre l’art contemporain et le public qui vient ici se caler de force avec le déplacement du caisson lumineux sur le trottoir. Un caisson qui apostrophe inopinément le passant au coin de la rue ainsi qu’un visage charmant, mais non innocent. Ce dispositif fait irruption sur l’extérieur, dévie la dynamique urbaine, le flux piétonniers et la circulation des véhicules motorisés. Il occasionne, par obstruction, un effet de signalisation efficace. Il réitère ses invitations. Véritable machine dynamique/ergonomique, et qui n’en demeure pas moins pure architecture expérimentale, espace de décloisonnement utopique, laboratoire architectural. C’est encore dans les gestuelles répétées et gainées de verre, dans l’aller-retour du visiteur, dans le va-et-vient du caisson lumineux qui se loge et se déloge de son corps de bâtiment, que le dispositif se décharge de son poids de gravité conceptuel et se charge d’une dynamique érotique réelle.
La réalité sert de modèle à la réalisation d’une contre-fictionLe modèle de la société se fait dans l’architecture, et la société n’est qu’une histoire en transformation. L’altération actuelle, par la globalisation, par la mondialisation, par la normalisation est si rapide et si violente, si engageante et si moralisante, autant pour les pays entraînants que pour les pays entraînés, qu’elle encourage par ces frictions irritantes des modèles de résistance et de contre-société. C’est dans « la mécanique effrénée des passions » chère à Fourier que se construisent naturellement les réflexions isolées qui se font en marge des cadres en question. Les problématiques soulevées par protaTTrioreau montrent qu’il s’agit moins de résoudre que de trouver à quoi ressemblent les solutions sur un terrain aussi mouvant, elles déterminent par des expériences mesurées la naissance balbutiante et jouissante d’une offensive artistique dans l’enceinte privée de l’architecture publique. C’est en combinant les déplacements et les agissements de l’individu moderne, dans les flux d’une cité, que se reconstruisent les passerelles tombées entre les îlots de création. Si l’utopie est une fiction sociale qui se veut le modèle de la réalité, c’est ici la réalité qui sert de modèle à la réalisation d’une contre-fiction.
Frédéric Bouglé, directeur du centre d’art, Le Creux de l’Enfer, Thiers, France
Parpaings, numéro 24, p. 20-21, 2001Voir aussi le texte du catalogue de Brane Kovic, critique d’art et commissaire de l’exposition Premestitev v Maribor / Déplacement à Maribor (2001) organisée par la Galerie Le Sous-sol, Paris et Umetnostna Galerija Maribor, SI 2000 Maribor, Strossmayerjeva 6, Slovenia du 24 avril au 26 mai 2001 en collaboration avec l’AFAA, l’Institut Français Charles Nodier, Renault revoz d.d., Aquasystem d.o.o. et Nova KBM d.d.
« … protaTTrioreau se concentrent sur l’analyse des structures du tissu urbain. Leurs interventions dans l’état des choses en architecture sont souvent très radicales et contraires aux idées établies sur le rôle et le sens du domaine de construction. Dans leur système des transformations, le dedans et le dehors ne représentent que deux notions relatives, ainsi que le rapport entre le tout et le détail, entre l’espace réel et l’espace imaginaire. Là où l’on construit, on démolit également ; la ville et les bâtiments sont des variables soumises à la logique du marché. Les édifices perdent leurs caractère prestigieux de création architecturale pour devenir juste une bonne occasion pour l’investissement du capital qui, au moment où il ne rapportera plus, se déplacera ailleurs en laissant ces maisons se dégrader. Seuls les documents et les maquettes résistent à ces manipulations du marché… ».
Catalogue : projet : BP 297 - 9, RUE EDOUARD BRANLY, 18006 BOURGES CEDEX, textes de F. Bouglé, E. Decouard, J. Duvigneau, A. Laguarda, R. Rémond, C. Ruby, conception graphique de D. Perrier, Editions Archibooks / Le Gac + Sautereau éditeurs (http://www.archibooks.com), La Box, Ecole nationale supérieure d’art de Bourges (http://www.ensa-bourges.fr), avec le concours de la DRAC Centre.
Dislocation
Préface
Emmanuel Decouard
D'un bord à l'autre deux textes qui, pour tenter de parler, se doivent de se placer hors-champ. Une postface, d'abord, qui est « comme un supplément, un reste, s'ajoutant sans former une continuité, manquant à toute progression et à toute nécessité. » Et une préface, ici-même, venant se placer encore à la suite de l'après-coup de la postface et qui pourtant se doit d'inaugurer, de lancer ce par rapport à quoi elle est irrémédiablement différé : le travail de TTrioreau. Tout est donc passé. L'installation n'est plus visible et l'immeuble représenté sur le caisson lumineux, centre mobile de l'exposition de La Box à Bourges, cet immeuble alors voué à la destruction est aujourd'hui, selon toute vraisemblance, définitivement rasé.
Reste donc ce catalogue. Constituerait-il une négation ramassée (la destruction ayant déjà eu lieu) puis relevé en un nouvel objet, positif maintenant, dont la pensée pourrait suivre le cours figé et dont les différents auteurs ici présents ont déjà éclairé une perspective ? Ce serait là un hégélianisme sans réserve que la forme même du catalogue que nous avons entre les mains vient minorer. Car ce livre - objet ne documente pas tant ce qui a eu lieu qu'il continue, par d'autres moyens, l'élan originel de l'œuvre. De même que les topographies sont toujours brouillées chez TTrioreau (comme le remarque bien Alice Laguarda, « Les projets de TTrioreau se présentent comme des tentatives de dépassement des oppositions strictes attribuées à l'architecture : immobile - mobile, permanent -temporaire, dedans – dehors… »), l'iconographie du catalogue est perturbée : un parallélogramme irrégulier dont les bords, tombants, sont peut-être la préfiguration annoncée / retardée de la chute de l'immeuble concerné, des polices fuyantes et dispersées, … Tout se passe comme s'il y avait bien une dialectique à l'œuvre (destruction, négatif, relève), mais il s'agirait ici d'une dialectique qui ne se résoudrait pas dans la figure de l'identité.
Ce refus de la résolution identitaire fait écho à la pensée de Adorno qui écrit : « La dialectique comme procédé signifie d'accepter la contradiction inhérente à la chose et, contre cette contradiction, s'efforcer de penser en termes contradictoires. Contradiction dans la réalité, elle est la contradiction de cette dernière. […] Son mouvement n'est pas celui de l'identité dans la différence de chaque objet d'avec son concept ; elle est bien plutôt le soupçon face à l'identique. Sa logique est celle de la dislocation : dislocation de la figure apprêtée et objectivée des concepts que, tout d'abord, le sujet connaissant a immédiatement face à lui. »
Cette pensée de la contradiction, selon un mode lui-même contradictoire, Renaud Rémond, l'a bien repéré dans l'œuvre de TTrioreau : « L'installation tente d'articuler ainsi un évènement où plusieurs temporalités jouent contradictoirement à travers l'immobilité de l'architecture et de l'image photographique. » Mais, partant de là, Renaud Rémond opte pour une résolution ontologique de la contradiction : « L'image est creusée par une profondeur sans fond, un centre toujours ex-centré, qui décèle seul, loin des objets et du réel, ce qu'il est en est de l'être, un effondrement de l'ici, son désastre. » Or, quelles en seraient les conséquences si, sous l'impulsion de Adorno, nous quittions la logique de la destruction pour celle de la dislocation ?
L'enjeu, ici, serait de ne pas sortir des choses, de l'immédiatement réel, c'est-à-dire encore de l'installation même de TTrioreau, de cet immeuble de la périphérie de Bourges et de ce catalogue - objet pour prendre la juste mesure de leur négativité (de leur caractère non-identitaire), tout comme de leur logique interne disloquée. Comme le dit Adorno : « C'est la chose, et non pas la tendance de la pensée à l'organisation qui provoque la dialectique. » Cet enjeu se décline au moins en deux temps.
Premièrement, c'est la position du sujet - spectateur qu'il faut réévaluer. Puisque suivant la logique de la dislocation « Le sujet doit donner au non-identique réparation de la violence qu'il lui a faite », et que c'est par là-même « qu'il se libère de l'apparence de son être-pour-soi absolu », le spectateur de l'exposition se voit contraint d'opérer un déplacement de perspective. Comme le dit Christian Ruby : « Il lui est demandé d'apprendre à se reconnaître comme spectateur en le devenant, de mettre en jeu des agencements, par rapport aux autres spectateurs, agencements dans lesquels il doit se choisir comme spectateur ou non et comme tel spectateur ou non. »
Deuxièmement, il s'agit de recueillir le processus socio-historique de l'œuvre de TTrioreau. La pièce envisagée ici comme image dialectique au sens de Benjamin, se comprend alors comme une cristallisation qui permet à la dimension sociale de se représenter elle-même. C'est ce que souligne parfaitement Jérôme Duvigneau lorsqu'il écrit : « Saturated by signs and symbols, it is also the space where goods (merchandise, objects of production) coincide with their own performance and advertising. In this respect, the light box signals like a neon advertising sign, in an attempt to break up the coherence of the surrounding urban space. It is by decentralising one space into another, literally dislocating, that the light box produces a different reality, one that is inappropriate for normal urban use. » Adorno avait déjà souligné la force incomparable qu'avait Benjamin d'allier « une capacité spéculative avec une approche micrologique des contenus chosaux. » Peut-être est-ce là justement ce que nous donne à voir TTrioreau : une pensée conceptuelle qui ne craint pas d'affronter la scission inévitable du concept en rendant justice à l'immédiatement réel, aux contenus chosaux et en les préservant dans leur dislocation.
Il n'est évidemment pas question de subsumer le travail de TTrioreau à une philosophie préexistante, en l'occurrence celle de la Dialectique Négative. Néanmoins, le soupçon de l'identique, la notion de dislocation, l'orientation sur l'immédiatement réel sont autant d'éléments qui permettent d'entrevoir l'œuvre d'art sous un jour des plus fécond. Dans cette optique, les juxtapositions, les déplacements, les contradictions, voire les impossibilités qui traversent la pièce de TTrioreau ne se reconduisent pas à une unité illusoire mais s'organisent en une constellation. Partant de là, émerge la notion du possible, dans la pensée comme dans l'art.
Frédéric Bouglé conclut son article sur cette proposition : « Si l'utopie est une fiction sociale qui se veut le modèle de la réalité, c'est ici la réalité qui sert de modèle à la réalisation d'une contre-fiction. » Et en effet, c'est bien là un point central chez TTrioreau : l'ancrage de l'œuvre dans l'urbanisme et l'architecture fait directement signe à l'utopie. Or, comment penser le rapport du réel et de l'utopie ?
Adorno, encore une fois, nous aiguille sur cette voie : « La connaissance qui veut le contenu veut l'utopie. Celle-ci, la conscience de la possibilité, s'attache au concret en tant que non-défiguré. C'est le possible, jamais l'immédiatement réel qui fait obstacle à l'utopie; c'est pourquoi le possible, au sein de l'existant, apparaît comme abstrait. » Ce passage, d'une extrême difficulté, nous montre néanmoins, d'une part, les relations entre le contenu, l'utopie, le possible et le réel et, d'autre part, le concret et l'abstrait, tout comme il nous indique le chemin ardu de la pensée : ouvrir la possibilité même de la réflexion comme utopie, non pas en s'éloignant de l'existant, mais en restant au contraire fidèle à l'immédiatement réel, fut-ce au prix de la dislocation et de la négativité.
Reste maintenant au sujet - spectateur - lecteur à affronter cette négativité pour réaliser son propre projet de l'utopie.
Emmanuel Decouard
BP 297 - 9, rue Edouard Branly, 18006 Bourges cedex
Frédéric Bouglé
« Les expositions d’art auront à l’avenir pour mission de montrer la peinture et la sculpture dans le contexte de l’architecture, de redonner vie au sens initial des arts plastiques qui est d’avoir une fonction dans la construction ».
Contre-architecture utopique / contre-architecture érotique
L’architecture, dans son idéal, est une tentative d’expliquer la société par sa construction même, c’est l’ultime forme qui pousse tous les arts à s’affirmer aux yeux de tous. Elle place l’humanité au centre de son logis où s’abrite ses convictions et ses motivations premières. L’architecture représente la première des grandes utopies sociales car elle déplace le sujet sur le giron de sa famille, de sa communauté, davantage que sur un public. Toute maison est une topo-utopie, une île posée sur l’erg du monde, comme le furent en leurs temps la cité et le temple. Maison communautaire ou non, c’est la première des grandes utopies réussies ou ratées. C’est un refuge et c’est un centre, un lieu d’abandon, de réflexion, de mémoire, de retranchement actif qui va s’associer à l’enfance, à la famille, au groupe. Sa construction, son orientation, ses matériaux, son concept, valident l’histoire culturelle d’un peuple, d’un pays, d’une époque .
L’histoire jeune de TTrioreau commence quand deux tourangeaux passionnés d’architecture, Vincent Protat et Hervé Trioreau, se retrouvent dans un hangar voué à la destruction où ils élaborèrent ensemble leurs premières réflexions et expérimentations sur l’architecture urbaine et son rapport aux arts plastiques. De l’aventure architecturale à l’aventure du voyage, les voila déjà partis vérifier leurs concepts en examinant des appartements proliférants dans une grande métropole asiatique en mutation accélérée. Observant les gens qui y vivent, constatant l’organisation architecturale et spatiale des bidon-villes et la construction spontanée justifiée par la paupérisation, ainsi qu’ils l’ont entrepris à Hong Kong, ils en reviennent pour s’investir et l’appliquer dans le décalage de leur région. C’est à Tours dans une maison abandonnée près du Centre de Création Contemporaine qu’il monte un projet en apparence burlesque et qui permettait aux visiteurs de découper chirurgicalement le corps du bâtiment au scalpel visuel. L'intervalle, le passage, l’hybridation, le métissage, la prothèse architecturale, la géopolitique, l’interface sont autant de données qui fondent l’analyse entreprise dans leurs recherches. Une architecture modulaire qui procède par agrégats, raccordements, entassement, juxtapositions et qui trouvent ses applications artistiques dans une dimension humaine.
Contre-architecture mobile / contre-architecture labile
Pour les futuristes italiens et russes, que ce soit Marinetti, Lioubov Popova ou Alexandre Vesnine, l’architecture en aucun cas ne devait être statique ou rigide, mais se devait au contraire d’être constamment en mouvement comme l’eau de la mer, mouvements de la machine reprenant la gestuelle moderne, ou encore composée de matériaux vaporeux ou nuageux. L’immense structure transparente de Tatline pour le siège de la Troisième Internationale de 1919, dont la maquette fut promenée dans toutes les rues, était composée d’une spirale d’acier sur un axe asymétrique, des corps de verre à révolution interne, et munie d’un système de projection de textes dans le ciel par temps couvert, un projet qui marque encore des artistes contemporains ainsi que Michel Aubry l’a récemment démontré au Centre d’art contemporain de Vassivière en Limousin. En 1919 encore, l'expressionniste Bruno Tant sort un portfolio intitulé « Architecture Alpine » dans lequel il imagina un monumental ensemble de cathédrales de verre resplendissant au milieu de chaînes de montagne, tandis que l’architecte russe Georges Kroutikov dessina lui, en 1928, un bâtiment flottant dans l’espace. Aujourd’hui, et pour aller hâtivement, l’artiste polonais contemporain Krzysztof Wodiczko connu pour ses « projections publiques » dénonce pour sa part « la principale occupation du monument » qui voudrait rester immobile, être enraciné en permanence dans le sol et s’abstenir de tout mouvement visible, afin d’annexer par là même son idéologie sur le temps et le territoire. L’architecture valide ou dénonce donc aussi une forme de stratégie, une stratégie dans ce cas qui n’est pas nouvelle quand, pour reprendre la fameuse phrase de Mirabeau prononcée aux députés des communes : « il leur suffit de rester immobiles pour se rendre formidable à leurs ennemis ».
Un dispositif faisant irruption aux flux de circulation : l’obstruction comme invitation
La Box, à Bourges, est un lieu d’exposition juxtaposant l’Ecole nationale des beaux-arts de cette même ville. C’est un lieu de dimension modeste, séparé en deux salles inégales en surface : la première ayant une entrée sous un porche et la seconde percée de trois fenêtres vitrées donnant sur une rue extérieure. TTrioreau est intervenu du 25 janvier au 2 mars 2001, et a pris connaissance du lieu et de son environnement. Sachant l’analyser il a investi l’espace dans le but d’en faire une architecture en rupture, sculpturale et spatiale, dialogique, fixe et labile, ouverte et fermée, mouvante et agissante à la fois sur elle-même et sur le monde extérieur. A cet effet les vitres ont été déposées, les passages ainsi ouverts permettant alors aux passants de pénétrer l’architecture à condition de lever le pied, et de parcourir la salle dans sa largeur sur un parcours obligé, guidé par des cloisons vitrées. Les espaces de la galerie et de l’œuvre se font le piège d’un processus bifide et composé où les statuts basculent dans un rapport physique et visuel. Le piéton entre inclusion et exclusion, dans ce double mouvement, se fait par là même autant visiteur que sujet à voir, et qui troque sa position de sujet regardant de son aquarium et de sujet regardé par derrière la vitrine, la première salle demeurant ouverte au public où était présentée une maquette du projet. L’entrée offrait ainsi un point de perspective unique entre le « modello » et son extension visible, tandis qu’au centre des ouvertures extérieures un dispositif coulissant présentait une double photographie Duratrans® sur caisson lumineux de dimension humaine (2500 mm x 1650 mm). Il représentait un immeuble année cinquante de treize étages au chiffre interdit : une tour emblématique / ithyphallique, symbole de la reconstruction hâtive mais qui figure et déplace au mieux le passé architectural de la Ville de Bourges et le terrain social de proximité.Le public ne tient compte que d’une chose, affirmait Donald Judd, il faut que l’art qu’il voit ressemble aux reproductions qu’il peut voir dans les livres d’art . En reprenant l’outillage publicitaire, TTrioreau s’approprie le langage artistique le plus répandu et le plus lisible, un langage intermédiaire entre l’art contemporain et le public qui vient ici se caler de force avec le déplacement du caisson sur le trottoir. Un caisson qui apostrophe inopinément le passant au coin de la rue ainsi qu’un visage charmant, mais non innocent. Ce dispositif fait irruption sur l’extérieur, dévie la dynamique urbaine, le flux piétonniers et la circulation des véhicules motorisés. Il occasionne par obstruction un effet de signalisation efficace. Il réitère ses invitations. Véritable machine dynamique / ergonomique, et qui n’en demeure pas moins pure architecture expérimentale, espace de décloisonnement utopique, laboratoire architectural. C’est encore dans les gestuelles répétées et gainées de verre, dans l’aller-retour du visiteur, dans le va-et-vient du caisson lumineux qui se loge et se déloge de son corps de bâtiment, que le dispositif se décharge de son poids de gravité conceptuel et se charge d’une dynamique érotique réelle.
L’architecture comme « topocratie », l’architecture et le chaos, l’architecture l'emporte sur les conflits : une utopie-pixel sans torsion sociale
De la Saline d’Arc-et-Senans construite par Nicolas Ledoux au Familistère de Guise , dont l’existence fut sommaire mais suffisamment parlante, les utopies architecturales du début de l’ère industrielle, et de la première moitié du XXème siècle, affirment une pensée utilitaire tout en essayant de préserver l’individu de la misère économique et sexuelle. Enthousiasmants et libertaires parfois dans le contenu, mais trop souvent centralisés, planificateurs, autoritaires, ces abris utopiques aspirent à mieux gérer la société afin que l’ordre domine comme finalité première. Si on compare aujourd’hui les viatiques virtuelles du réseau Internet, c’est paradoxalement ces craintes qui vont aujourd’hui s’inverser. La pensée hédoniste impose son système économique là où le terrain est vierge, et c’est l’ordre social qui s’effraie du désordre ontologique et éthique que la nouvelle technologie génère. En d’autres termes, ce ne sont plus aujourd'hui les acteurs de la pensée qui anticipent les utopies, mais ce sont bien les courroies technologiques, les instruments de la communication même, qui, par des courts-circuits ouverts sur un flux sans frontières, par des espaces circulatoires, déambulatoires et codés, aspirent et concentrent toutes les volontés sur une « topocratie » sans but, et sans autre finalité, que sa propre poursuite effrénée. Hakim Bey, dans L’art du chaos, Stratégie du plaisir subversif, aspire a concilier le monde sauvage et le cyberespace en créant une « Zone Autonome Temporaire ». Il s’agirait de s’inventer une sorte d’île utopique virtuelle, un espace kaléidoscopique conceptuel, anti-autoritaire, libre et festif en tout, sans frein et sans barrière, et qui serait selon l’auteur: « le seul lieu (hormis l’imagination subjective) où l’on puisse expérimenter une véritable sensation de vie sans oppression ». Nous atteignons ici les flans d’un projet utopie-pixel sans torsion sociale, où le réel temporel se retire dans un autre visuel, quand l’individu corporel se satisferait des avantages d’un monde plat, tandis que son imaginaire palpiterait des effets vortex d’un autre plus circulaire. Une sorte de « Mont Analogue » à la René Daumal où l’architecture ne serait plus que la base numérique d’une idéologie mentale, une vision esthétique confidentielle / exponentielle, et aux dess(e)ins d’autant plus libres qu’ils échappent à toutes fonctions, et à toutes prises sur le réel.
Créer un conflit pour fédérer des aspiration nouvelles
« La structure sociale est influencée, sinon dirigée, par la structure matérielle qui l’héberge » écrivait l’architecte d’origine italienne Paolo Soleri. L’architecture, comme la sociologie, doit rendre, pour reprendre les propos de Raymond Aron, explicite ce qui est implicite, et faire apparaître au grand jour ce qui est caché . Pour Alain Touraine, la fonction du sociologue est de faire émerger des rapports, des crises et des conflits, il observe la réalité ainsi qu’une scène qui se joue sous ses yeux, et dont il doit écrire dans un même temps lui-même le scénario. Quand l’utopie est une « topocratie » en passe de refroidir, comme ses îles surgies brutalement des éruptions de volcans sous les mers, l’architecture, en tant que volition d’une modernité à se construire, stimule des visions d’avenir sur sa communauté. C’est le « lieu » qui, par essence même, vient soit dépasser les conflits variés dans une société donnée, soit créer elle-même un conflit mais pour fédérer des aspiration nouvelles.
Une psychogéographie du terrain
L’architecture, en tant que lieu défini, qui se construit et s’élève dans un espace conflictuel, dans cette jungle moderne, ordonnée et hiérarchisée, participe à dominer, selon ses moyens, l’existence d’une psychogéographie profonde du terrain. C’est pourtant en prenant sens dans son environnement entier, en le perturbant parfois, qu’elle va véritablement en saisir son enjeu.
Les expériences de TTrioreau qui nous concernent, poussent, comme exemples, ces réflexions dans le retournement que leurs opérations opèrent. Elles ne cherchent pas directement à faire le procès de l’architecture mais n’en demeurent pas moins critique à part entière. Le comportement humain, le public, en tant que vecteur territorial à l’implantation de l’architecture, demeure un des points essentiels de la question. L’artiste, dans sa démarche tout terrain, interpelle la conduite et l’attitude des regardeurs, proposant et provoquant des zones d’attente, d’arrêt, de questionnement, alors que l’architecture en tant que symbole, symbole de créativité d’une société, est non pas refoulée du propos mais mis pour un moment à l’index.
Le comportement humain exerce sur l’architecture des pressions. Il génère dans un espace donné, dans un environnement précis, une atmosphère singulière et parfois sortilège, une atmosphère de jour, et une atmosphère de nuit, comme celles que l’on retrouve dans Capdevielle. C’est l’aura humaine chargée de désirs variés qui se construit elle-même dans un monde réduit et surveillé. Pourtant, au sein d’une cité nocturne, l’architecture vient apaiser par sa présence les marques spatiales qui manquent à ceux qui observent le soleil s’enfoncer. Reprenant le flambeau idéaliste et situationniste de Constant Nieuwenbuys, qui affirmait, « une autre ville pour une autre vie » . Le projet réalisé par TTrioreau à Bourges reprenait l’idée d’un espace fractionnel, modifiable et modulable, et qui interroge parfois le visiteur passant, libérant notoirement des espaces réflexifs dans un spasme bâti pour d’autres fonctions. D’un lieu expositions artistiques, les artistes en font un laboratoire architectural imprévisible et communicationnel dans une temporalité transitoire mais bien réel. Pour Constant, ainsi qu’il était dit dans son Ode à l’Odéon, les espaces urbanistiques correspondent aux attentes de « l’homo ludens », et ce seront la concrétisation spatiale des désirs de l’individu qui viendront accréditer l’émergence d’une architecture. Ce sont, notait-il, « nos besoins qui nous poussent à la découverte de nos désirs ». L’attention émise par TTrioreau envers les visiteurs participe, comme celle de l’artiste français Saâdane Afif dans son intervention au centre d’art contemporain Le Creux de l’enfer à Thiers (exposition « Mise à flot », octobre 2001), non pas à créer du désir, mais à utiliser ce désir comme d’un levier pour revoir les besoins de sa position.La fonction vivante du bâtiment
TTrioreau reprend, à l’instar de Constant, les problématiques de l’architecture par d’autres sentiers. Un bâtiment finalement n’est qu’un corps vivant, avec une cause initiale qui l’a fait naître, et qui court immanquablement vers son ultime destin. C’est en anticipant virtuellement sa phase de destruction, comme les artistes l’ont entrepris précédemment à Tours, que va se vérifier, par béance fictionnelle, la fonction vivante et bien réelle d’un bâtiment. Chaque destruction d’immeuble ou d’habitation engage la libération d’un espace, laissant resurgir la lumière , un espace sauvage, un champ d’autonomie et de disponibilité à prendre.
Le « modus operendi » de l’architecte
L’ensemble des démarches artistiques entreprises par TTrioreau dans l’architecture participe d’une expérience sur le « modus operendi » de l’architecte. Elle pousse encore à s'interroger sur les raisons profondes qui l’incite à construire, et même à répondre ou non à des commanditaires. Une démarche qui implique de se remémorer l’histoire qui est la sienne, et de la faire avancer hors de ses nécessités premières. Il s’agit moins de classer par lignes de pensé, que d’échapper à un excès de règles cartésiennes, il s’agit moins de faire des découvertes, que de deviner les véritables motivations de l’architecte. Une des tâches des mathématiques consiste à prédire les phénomènes, une des tâches de l’architecte consiste à faire de même. C’est de cette fonction que dépend la part vitale de la construction sur son environnement, pour faire d’un procédé une chose visible, et des contraintes présentes une méthode invisible. Si toute architecture est inerte, une structure de donnée, c’est pourtant par ces moyens qu’elle atteint son mouvement dans un temps d’existence sans durée. A l’ère de la communication à tous crins, l’architecture tant à devenir l’armure d’un symbole politique sur-recherché et tout-puissant. Dans le roman d’Italo Calvino, Le chevalier inexistant, l’armure blanche d’Agilulfe Bertrandinet des Guildivernes, ne protège personne.
La réalité : modèle à la réalisation d’une contre fiction
Le modèle de la société se fait dans l’architecture, et la société n’est qu’une histoire en transformation. L’altération actuelle, par la globalisation, par la mondialisation, par la normalisation est si rapide et si violente, si engageante et si moralisante, autant pour les pays entraînants que pour les pays entraînés, qu’elle encourage par ces frictions irritantes des modèles de résistance et de contre société. C’est dans « la mécanique effrénée des passions » chère à Fourier que se construisent naturellement les réflexions isolées qui se font en marge des cadres en question. Les problématiques soulevées par TTrioreau montrent qu’il s’agit moins de résoudre que de trouver à quoi ressemblent les solutions sur un terrain aussi mouvant, elles déterminent par des expériences mesurées la naissance balbutiante et jouissante d’une offensive artistique dans l’enceinte privée de l’architecture publique. C’est en combinant les déplacements et les agissements de l’individu moderne dans les flux d’une cité que se reconstruisent les passerelles tombées entre les îlots de création. Si l’utopie est une fiction sociale qui se veut le modèle de la réalité, c’est ici la réalité qui sert de modèle à la réalisation d’une contre-fiction.
Frédéric Bouglé
Architectures - transferts
Alice Laguarda
Les discours sur la fin de la ville, l’apologie d’un chaos spatial qu’on dit « spontané », d’une civilisation du « fun » et de la flexibilité questionnent la condition habitante contemporaine. L’espace de la ville n’est plus un réseau statique mais un palimpseste d’objets autonomes qui entretiennent avec le territoire des relations temporaires, dont les usages et les fonctions fluctuent. C’est presque l’espace d’une équivocité pure.
Le travail de TTrioreau vient se loger dans ce contexte, et cherche à proposer l’image d’une architecture qui rompt avec l’idée de permanence, remet en cause l’idée même d’architecture comme simple construction ou forme.
Les projets de TTrioreau se présentent comme des tentatives de dépassement des oppositions strictes attribuées à l’architecture : immobile-mobile, permanent-temporaire, dedans-dehors… Le statut de l’architecture est réexaminé par rapport à celui du monument, dont l’expression contemporaine est notamment celle du logement sacralisé, signe de la victoire de la sphère privée sur la sphère publique. A ce statut fixe, TTrioreau veut substituer un statut mobile : celui de la dimension futile et périssable des constructions humaines qui les ont amenés à intervenir dans des mégapoles (Hong Kong), des espaces délaissés (une maison abandonnée à Tours), ou encore dans l’étonnant bâtiment de l’école d’architecture de Nantes. Ce statut mobile implique également que l’architecture ne peut se réduire à une construction, à une forme figées, pour à tout moment devenir une image, une projection. Chaque espace objet d’intervention est ainsi éprouvé dans sa capacité à se transformer, pris dans des séquences, des récits qui mêlent films vidéo, photographie, maquettes ou élaboration de prototypes.
Ainsi de l’intervention de protaTTrioreau, 35, rue Marcel Tribut, 37000 Tours : pour la première phase, une caméra vidéo, posée sur un vérin hydraulique télescopique, « traverse le plafond d’une maison pour détruire à l’étage supérieur la maquette de cette même maison. Le film vidéo de la destruction est simultanément retransmis à l’extérieur, au-dessus du seuil ». Puis l’installation se transpose dans le cadre d’une galerie, où les archives de cette destruction sont exposées : « le moniteur diffusant le film vidéo est couché sur une photocopieuse couleur qui en reproduit les images. La stratification des copies (feuilles de papier transparentes) reproduit ainsi l’image inversée du bâtiment détruit et forme elle-même, par entassement, une architecture-palimpseste ». On transpose, on inverse, on altère, on superpose les informations, les supports. On monte, on colle, on mixe, comme s’il s’agissait de reconquérir du pouvoir sur son environnement, de se l’approprier en le détruisant, de l’altérer pour le reconstruire ailleurs, autrement.
D’où l’intérêt de l’artiste pour les constructions anarchiques, l’architecture des non-architectes dans les villes, comme jeux sur leurs limites physiques : pour le projet à Hong Kong, il s’agit d’étudier des terrasses « pirates », extensions de l’architecture existante construites par les habitants pour augmenter leurs surfaces d’habitation. Ce principe de greffe, d’excroissance, d’architecture - parasite, décliné notamment par le groupe Archigram dans les années soixante, est largement repris aujourd’hui par une nouvelle génération d’architectes dans des projets d’habitats « nomades », de cabanes ou de maisons mobiles (Philippe Grégoire et Claire Pétetin, Didier Fuiza Faustino, Archi Media, …). On retrouve chez TTrioreau la fascination pour la mobilité urbaine, l’idée d’architecture - dispositif, le principe de flexibilité des éléments assemblés, où l’architecture cherche à communiquer, en temps réel, avec les faits et les usages de son époque.
Cet intérêt rejoint la question de l’envahissement de la sphère publique par la sphère privée, posée par Hannah Arendt et Jürgen Habermas. A l’origine, la sphère privée concerne l’entretien de la vie (subsister, manger, se reproduire). Espace du foyer, elle est le siège de la plus rigoureuse inégalité, le lieu de la subjectivité radicale. Elle a fonction d’abri sûr, de protection. Pour les Grecs, un abîme sépare le public du privé : le public est le domaine de la parole et de l’action. L’homme y réalise son humanité parce qu’il le fait devant les autres et que ce qu’il fait est dégagé des soucis du privé, de la vie biologique. Dans privé, il y a privation : être privé de la réalité qui provient de ce que l’on est vu et entendu par autrui. Seul le domaine des affaires publiques instaure un réel rapport au monde et aux autres. Aujourd’hui, l’économie – le « Shopping », dirait Rem Koolhaas - a tout envahi et amenuise cette distinction entre sphères privée et publique. Elle s’accompagne d’une tendance au conformisme : « de chacun de ses membres, la société exige un certain comportement, imposant d’innombrables règles qui, toutes, tendent à normaliser ses membres, à les faire marcher droit » . Chez TTrioreau, la disparition de cette distinction se traduit par la critique d’un espace urbain devenu paysage de la consommation, envahi d’infrastructures géantes qui relient les centres commerciaux aux quartiers résidentiels, d’enseignes publicitaires qui s’ordonnent en autant de séquences spatiales répétitives. Il s’agit d’investir le paysage ou l’environnement habités (ce qui est commun, ce qui relie les hommes) et de déconstruire l’espace privé, sacralisé, de la maison ou de la demeure.
La critique est visible dans l’intervention BP 297 – 9, rue Edouard Branly, 18006 Bourges cedex : deux photographies fixées sur la structure d’un caisson lumineux visible à l’extérieur de la galerie, investissant la rue, représentent le plus ancien immeuble de logements sociaux construit à Bourges, faisant la jonction entre espace résidentiel et zones industrielles, également siège de l’agence d’office public d’H.L.M. de la ville. Le déplacement des signes, l’immersion de cette image dans l’espace public, hors du champ de la galerie d’exposition, est une manière de mettre en cause la fonction de l’architecture : habitat, observation et surveillance, standardisation ? Même questionnement pour l’espace de la maison : « il s’agit que la maison – et avec elle ses symboles : institutions, pouvoir, économie – soit défaite, que son habitabilité soit incertaine, comme en suspens » . On rejoint là le travail de l’artiste Bernard Calet, dans son rapport à l’architecture et sa manière de s’installer dans des lieux d’exposition, avec la mise en place d’une « esthétique des transferts » : « pas ici de point focal, pas ici de séduction, la proposition continuellement repositionne l’attention, la fait glisser d’un univers à un autre, d’un système de références à son contraire, sans répit. Invitation à penser dans une langue plastique qui n’est assurément pas encore notre bien, ourlée non de syntagmes construits et ordonnés mais d’énoncés en constante reconfiguration » .
Pour résister à l’envahissement du social, pour éviter la disparition totale de l’espace public, ce principe de « transfert » s’affirme comme une nécessité : il faut trafiquer les symboles, les « bricoler », les détruire, aussi. Il faut créer des passages, des transpositions d’un espace à l’autre : des intervalles, des débordements qui répondent aux fonctions urbaines d’information (espace de la rue, événementiel) et de « jeu » (rencontre, hasard, mouvement). Les titres des œuvres eux-mêmes trahissent un effet palimpseste : chaque adresse postale subit un traitement complexe, dans la mesure où elle devient elle-même le lieu d’une superposition sémantique : « elle désigne tout à la fois un site urbain strictement localisé et une installation plastique provisoire venue en brouiller l’identité » . L’utilisation de prototypes, de maquettes, dont la destruction ou l’altération vont par exemple être filmées en vidéo, puis montées, rend compte de ces transferts. Le dispositif peut être démontable et donc réactualisable dans un autre espace. On passe d’un mode d’appréhension à l’autre : de la galerie à l’espace de la rue, d’un mouvement horizontal à un mouvement vertical, de l’original à la copie, etc.
La condition de l’architecture est double : permanente et temporaire . La permanence en semble sans cesse altérée, ce qui lui confère un statut erratique. Mais alors, rien n’empêche cette condition de nous faire évoluer vers un relativisme absolu, légitimé par la fascination pour le palimpseste. C’est le travail de manipulation plastique mais aussi idéologique qui permet de dépasser l’attitude esthétique et d’élaborer une œuvre qui ne travaille pas uniquement sur la forme, mais surtout sur les usages.
Alice Laguarda
Le chemineur de chemins qui mènent quelque part
Christian Ruby
Des dispositions esthétiques s’inscrivent progressivement dans les corps des spectateurs, et renforcent une éducation reçue qui aime peu à se remettre en question. La force de ces acquis, de ces incorporations, est partout visible, qui pousse un certain type d’ivresse ou d’émotion à gagner les spectateurs devant les œuvres. Mais songe-t-on, vraiment, à leur barrer la route ? Du moins à les interroger ? C’est pourtant bien ce en quoi l’art contemporain contribue à définir une série de propositions nouvelles, directement liées à ces dispositions sensibles, à la scansion du temps, à l’ordre spatial et à l’interaction moins avec l’œuvre qu’entre les spectateurs. Nous savons, d’ailleurs, que nos corps n’y répondent pas toujours sans réticence. Au droit de l’œuvre artistique, chacun voit, en soi-même, en quel sens il a été dompté esthétiquement, mais aussi combien l’œuvre nouvelle est plus puissante encore puisqu’elle vient perturber ses aises et ouvrir à des aventures qui ne sont pas toujours virtuelles.
Les propositions artistiques d’art contemporain exigent, en effet, une mutation du spectateur, et surtout une mutation critique, telle qu’elle vise, si possible, à faire renoncer le spectateur d’art au spectacle de l’art, en particulier là où le spectacle est passé maître. Certes, toute œuvre d’art, en général, propose des règles à chacun, parce que les actes artistiques n’ont guère de raisons de constituer ni des massages émotifs ni des bains de santé. Mais, les propositions contemporaines, spécifiquement, ne cultivent plus l’immobilité du voyeur ou les pesanteurs enchaînées. Elles négligent même les ornements, qui ont toujours eu l’avantage de ramener en un centre les pensées errantes des spectateurs. Elles ne se contentent pas non plus d’un clin d’œil adressé au spectateur. Elles l’appellent à autre chose, à une autre existence.
Au surplus, les œuvres classiques ou modernes nous ont laissé des objets qui, inscrits désormais dans des jeux d’identification de la société avec elle-même, ont servi à dresser une quantité de spectateurs à ne savoir voir (ou entendre) autre chose que ce dont on prétend qu’elles nous en représentent les traits. Et surtout, à déployer, dans l’immédiateté du voir, un sens du commun qui avoisine un sens commun. Elles sont invitées à participer à un jeu social ancré d’office dans la question : « qui sommes-nous ? ». Question à laquelle on sait par avance ce qu’il convient de répondre. S’agissant d’architecture, puisqu’il va en être à nouveau question plus loin, le service qu’elles avaient à rendre consistait à s’attacher à élever les générations à des confrontations, mais de face à face, face par face, avec le bâti, en faisant sentir assez durement que les éléments, sans doute les plus importants, sont les plus inaccessibles. On croyait donc pouvoir s’en servir – ce fut le sort des architectures-monuments - pour asseoir des symboles qui référaient à des vertus et des valeurs nobles. Le spectateur était voué, devant elles, au spectacle et au spectaculaire.
Toute une scénographie - revenons-y - concerne ainsi l’architecture, agencée en général à l’art public. Cette scénographie - et Raymond Hains, lui aussi, en a remis les traits en perspective - présente un double aspect. Elle donne, d’abord, à l’architecture un statut autonome dans la pensée (opération historique). Elle donne, ensuite, un statut esthétique au spectateur (opération pédagogique).
Dans le premier cas, qui n’est pas inédit dans son projet mais dans la perspective défendue, l’architecture est pensée comme enveloppe (des dieux ou des pouvoirs), abri de la famille (et d’une vie en vase clos, comme en dessine une, par exemple, Friedrich Von Schiller), mettant ainsi la famille à l’abri des écarts et des tentations. Conception étroite, au demeurant, et dans laquelle l’architecture a toujours l’air de fonctionner sans la ville ou la ville de n’être qu’une somme d’œuvres en provenance de l’architecture.
Dans le second cas, l’architecture est donnée pour favoriser l’apprentissage du point de vue à prendre en esthétique, la formation du type d’expérience visuelle, dans laquelle se forge, simultanément, le spectateur classique généraliste : posant sur les bâtiments (comme sur toutes autres choses) un regard panoramique et esthétique . Le dispositif ainsi mis en place trouve ses conditions dans une philosophie du sujet monologique, être sensible, qui a eu son importance historique. Encore - si on ne veut pas en faire le fondement d’un dispositif prétendument naturel - ne doit-on pas négliger, lorsqu’on parle de cette philosophie du sujet, les obstacles qu’elle a rencontrés durant son propre établissement. Obstacles parfois difficiles à surmonter, dont les rendus littéraires témoignent, notamment à l’égard d’un spectateur qui n’est pas encore formé. Consultons Baudelaire sur ce plan, qui sait relever avec pertinence les résultats de cette formation, par excès parfois, par défaut souvent, au regard de la complexité des gestes que chacun doit apprendre pour s’y soumettre, et qui peuvent prêter à un humour froid : « Tous les imbéciles de la Bourgeoisie qui prononcent sans cesse les mots : « immoral, immoralité, moralité dans l’art » et autres bêtises, me font penser à Louise Villedieu, putain à cinq francs, qui m’accompagnant une fois au Louvre, où elle n’était jamais allée, se mit à rougir, à se couvrir le visage, et me tirant à chaque instant par la manche, me demandait, devant les statues et les tableaux immortels, comment on pouvait établir publiquement de pareilles indécences ».
Mais, désormais, dans l’œuvre contemporaine, il s’agit de bien autre chose. Et c’est cette autre chose qu’il convient d’appréhender au plus près, pour sa manière, premièrement, de reposer le problème du temps, de l’espace, de l’espace-temps et de la sensibilité, mais, deuxièmement, d’en inventer un nouveau, le problème des interférences entre spectateurs. Notre position de spectateur n’a pas changé de degré d’implication. Elle a changé de nature. Au point de modifier, presque entièrement, notre rapport à notre propre corps et au corps social en son entier. Cette position - qui, à certains égards, n’en est plus une -, ne consiste évidemment plus ni à recevoir les œuvres ni à les saisir et à nous y faire en nous laissant faire en et par elles. Elle contribue à nous obliger à nous saisir, par elles, en relance vers les autres.
Considérons ces nouvelles opérations
La première tient aux formes des œuvres elles-mêmes, ici, par exemple, chez Hervé Trioreau , des installations, des vidéos, des exercices virtuels, dont nous écrivons ici quelques mots sans conséquences, parce que nous préférons insister sur le sort qui y est fait au spectateur. Posons juste un profil d’œuvres, par conséquent ; chacun les retrouvera dans les catalogues ou sur Internet. Ce que tissent les œuvres contemporaines, et ces œuvres contemporaines, souvent sans le donner à voir, ce sont des « faires », agencés, mis en dialogue de l’intérieur, expérimentant leurs interactions. Ainsi, chaque pratique artistique pousse-t-elle en soi, au maximum, des potentiels qui la lient à d’autres pratiques, y faisant irruption. Non plus le clos et l’ouvert, mais le clos passant à l’ouvert. Non plus l’espace produisant du temps, ou l’inverse, mais l’espace-temps de l’œuvre. Non plus l’image ou le film, mais une séquence d’expériences imageantes. Non plus l’architecture et l’art urbain, mais l’habiter autrement. On peut décliner ces usages nouveaux abondamment. Ils obligent surtout à imaginer désormais des jonctions autrement délicates avec le spectateur. D’autant que, et nous revenons à notre perspective, le spectateur est appelé à devenir « spectateur - lecteur - auditeur », à devenir autre chose que spectateur d’un seul sens, qu’une sensibilité monopolisée par un seul sens, juste avant de passer à l’interférence.
Au premier chef, le spectateur doit retrouver sa plasticité, par rapport à sa formation esthétique. Tant mieux. Retrouver une capacité à ne pas tomber sous des lois uniques et immuables, à ne pas s’enfermer dans un rapport voyant - vu, regardant-regardé, presque idolâtre, à l’œuvre (dont le paradigme est bien décrit, pour ses conséquences, dans la Gradiva de Jensen), ce qui ne signifie pas qu’aucune règle n’intervienne. L’art contemporain le met plutôt en situation d’incomplétude essentielle du point de vue de ses sens et de sa perception, le déplaçant simultanément vers l’autre spectateur. Non seulement les anciennes règles ne sont plus les bonnes pour les nouvelles œuvres, mais il faut découvrir ou élaborer les nouvelles règles, trouver à se refaire en elles et comment le faire. Les identités n’y sont pas incertaines, elles retrouvent le mouvement.
La seconde opération tient donc au spectateur lui-même. Regardez le spectateur contemporain de l’œuvre contemporaine, il ne se dispose ni ne participe. La « pulsion de voir » l’œuvre est muée en « pulsion d’échange » ou d’audition à l’égard des autres. Le spectateur est essayé et se fait essai, de lui-même et des autres, dans l’œuvre d’un autre. Il est essayé dans son devenir spectateur, dont il doit quitter les habitudes, et il se fait essai d’un rapport aux autres, dont il n’a pas l’habitude. Il doit, par conséquent, tout à une formation en cours, dans laquelle il n’a ni à jouer à l’île déserte ni à s’inclure singulièrement dans l’œuvre pour la faire fonctionner pour lui-même. Il a à faire l’essai de quelque chose de nouveau qui le met directement (et met directement son corps) à l’épreuve des autres spectateurs. Il lui est demandé d’apprendre à se reconnaître comme spectateur en le devenant, de mettre en jeu des agencements par rapport aux autres spectateurs, agencements dans lesquels il doit se choisir comme spectateur ou non et comme « tel » spectateur ou non.
Avec beaucoup de force, l’œuvre lui propose d’affronter ce qu’il n’a jamais été, ou rarement, un spectateur qui se sait tel, et ne se sait tel que s’il entre dans un jeu d’incertitude avec les autres. Un spectateur qui interroge la collectivité esthétique. Il est pris dans un traitement et un entraînement qui, en lui interdisant de savoir tout de suite de quoi il s’agit, lui ouvre la voie d’une production de soi dans la production d’un sens qui se dégage de l’interaction avec les autres spectateurs. Toutes ses sensations, tous ses sentiments, toutes ses réticences conceptuelles l’engagent dans ce qui n’est pas encore, mais naît dans le mouvement de se livrer à l’œuvre.
Par ces deux opérations, l’art contemporain redistribue les conduites spectatrices et les vigueurs de la collectivité esthétique. Il propose de refaire de la circulation entre les spectateurs. La question n’est plus de ferveur. Comment l’est-elle devenue d’ailleurs ? En tout cas, la ferveur n’est plus du ressort de l’art en tant que tel. Ce n’est plus non plus un problème de présence intérieure dans l’intimité d’une sensation, avec ses résultats. Mais l’échelle est devenue celle de l’objectivité d’une interaction, qui abolit l’unilatéralité d’une relation entre spectateur et œuvre, afin de produire une multiplicité de rapports. On est loin de la contemplation abstraite qui implique une contiguïté des spectateurs ou l’énoncé d’une communauté transcendantale (entraînant tant de discours sur la « perte » de cette communauté ou son « impossibilité radicale »).
Sans doute, n’est-ce point sous les espèces de la figure ou de la réflexivité que l’art nous appelle désormais. À peine le rencontrons-nous qu’il menace le préjugé de notre unité de spectateur. Il exige autre chose. Il est impitoyable dans sa manière d’abreuver les polémiques. Mais enfin, le temps est aussi venu de penser la logique de ses opérations. Il nous en fait moins captif, qu’il ne se montre en faisant sauter la ligne de partage séparant les spectateurs, en leur permettant de se prémunir de tomber sous le coup du face à face. Il se peut alors que nous « passions », de vivants illusoires que nous sommes souvent, à quelque chose qui, enfin, a lieu. Non parce que le spectateur prend activement part à l’événement qui, sans lui, n’aurait pas lieu d’être, car cela est finalement vrai de toute œuvre. Non parce que l’œuvre fabrique de la transitivité avec elle-même ou un référent. Mais, parce que l’art contemporain produit de la transitivité entre spectateurs.
Peut-on longtemps demeurer indifférent à ce déplacement de l’accentuation du travail artistique vers les spectateurs ? Peut-on ignorer longtemps ses implications quant à la communauté esthétique et à la question de la signification des œuvres. Établir des connexions, des entre-deux, des conflits de commentaires, c’est imposer à la signification de naître de ces interactions. L’objet même de l’art – qui n’hésite pas à revisiter le corps au moment même où nous nous demandons « que faire de nos corps ? » - est devenu une interrogation : que faisons-nous ensemble ? Nous ? C’est-à-dire l’œuvre et le spectateur bien sûr, mais surtout les spectateurs entre eux. Si vraiment nous vivons une époque dans laquelle « tout vaut », alors l’œuvre d’art a raison de demander « valoir quoi ? » et « pour qui ? »
Christian Ruby
Pour une réflexion sur l’urbanisme : produire la ville comme œuvre d’art
Jérôme Duvigneau
« Quel est le rôle de l’architecte ? Quel est le rôle de l’urbaniste ? Ce sont des producteurs d’espaces. Je ne parle pas de « production architecturale. » Je veux dire qu’ils ne sont pas seulement des fournisseurs sur le marché et pour le marché de la construction. Bien entendu ils ne sont pas les seuls à produire de l’espace, il y a toute sorte d’agents de cette production, depuis les planificateurs, les banquiers, les promoteurs jusqu’aux autorités politiques et administratives, jusqu’aux travailleurs du bâtiment et aux usagers. Architectes et urbanistes opèrent dans le cadre du mode de production existant, mais ils y ont un rôle essentiel, sur eux repose l’avenir du principe d’après lequel l’espace à une valeur d’usage et non seulement une valeur d’échange. »
Henri Lefebvre, « La bourgeoisie et l’espace », Espace et politique, p.269.
BP 297 - 9, rue Edouard Branly, 18006 Bourges cedex
L’espace n’est pas un milieu géographique passif ou un milieu géométrique vide. Géographes et mathématiciens travaillent avec des constructions abstraites à des degrés divers. L’espace est instrumental, c’est-à-dire qu’il est espace vécu en même temps qu’il est espace où se déploient et s’affrontent des stratégies. Et c’est à ce titre qu’il se laisse produire selon un certain code, toujours partiel, car il n’existe pas, ou peut-être il n’existe plus, de code général, métalinguistique, rendant une société transparente à elle-même, code partiel donc et ici tout simplement code postal (mais il en est d’autres bien sûr). Simultanément, l’adresse, déjà lieu même de l’exposition, est le titre ou le nom propre de l’installation et cela sans pour autant cesser de fonctionner comme code partiel (postal). La polysémie devient une stratégie de résistance qui tente de mettre à jour la logique concrète des lieux occupés. Plus encore, le décrochage du signifiant par rapport au signifié enraye le code en le débordant.
C’est ce décalage pratiqué par TTrioreau qui produit l’espace nécessaire du questionnement en pointant la plurivocité. Découpage et fragmentation d’un territoire en réseau systématisé de symboles, l’adresse postale représente une information et transmet cette information. Mais aussi dans l’arbitraire de sa désignation, dans sa volonté de dominer l’espace en le rendant lisible, de l’instrumentaliser par une planification aussi effective qu’autoritaire, elle émane d’une stratégie à questionner. Cette homogénéisation des fragments dispersés comme politique de l’aménagement du territoire tend à dissoudre l’autonomie et la qualité des lieux. Cette stratégie d’occupation des sols vise elle-même à se dissimuler en dépassant les oppositions classiques : ville/campagne, dedans/dehors, centre/périphérie, pour ne citer que les plus marquantes, se donnant pour cela l’apparence du mouvement dialectique (ne cherchant de fait qu’à substituer ces oppositions sans les conserver ni les réfléchir) qui produirait les dimensions d’itinéraires, de réseaux de relations d’unités d’habitation et de liaisons (et qui de fait les produit mais comme stratégie de domination de l’espace). Procéder à une critique de l’espace en dégageant les stratégies qui le produisent nécessite l’analyse critique de cette activité productrice. La fausse dialectique du pouvoir ne doit pas occulter la véritable idéologie qui préside à son exercice, pas plus que la substitution « purement » architecturale de l’habitat à l’habiter ne doit nous faire oublier les oppositions contenues dans le mouvement toujours plus « sauvage », au sens où le capitalisme peut être sauvage, de l’éclatement de la ville comme forme. La question pourrait se poser, dévastatrice dans sa naïveté et pourtant souvent tenue à distance, elle pourrait être la suivante : tout espace est-il signifiant, et si oui, de quoi ? La critique urbanistique ne devra donc pas faire l’économie d’une sémiologie de l’espace et des discours sur l’espace. Cette étude des signes, partie d’une sémiotique générale, se confronte aux multiples codes de l’espace social. Les réseaux dominent et sont tous en mesure de produire leurs propres codes, submergés par la communication, par les signaux et les signes, c’est-à-dire intégrés dans quelque chose qu’ils ne maîtrisent pas, comment l’individu ne serait-il pas déconcerté ?
Le caisson lumineux, sur lequel sont fixées les deux photographies Duratrans®, coulisse du (BP 297 -) 9, rue Edouard Branly, 18006 Bourges cedex vers la rue et inversement. La centralité se déplace, mais en quoi consiste ce mouvement ? Soit que le centre s’entende comme un foyer, le mouvement se comprenant alors comme l’explosion des énergies accumulées (forces en lutte pour l’occupation de l’espace) comme souhait ou désir de leur dépense. Soit que la centralité, se voulant totale (centralisation) expulse avec violence, au nom d’une rationalité supérieure, politique, étatique, des éléments périphériques : chaque époque engendrant sa centralité, religieuse, politique, culturelle, commerciale, industrielle, … En décentrant l’installation, en s’incorporant l’espace public urbain comme nouveau centre possible, TTrioreau nous invite à la déroute.
L’extension de la ville produisit la banlieue mais dans le mouvement d’une expansion irrépressible, la banlieue avec tous ses réseaux a fini par engloutir le noyau urbain. D’autres centres virent le jours, les centres commerciaux, constitués en réseaux avec toute la cohorte de dispositifs dont ils s’entourent, ouvrant l’ère d’une nouvelle conception et pratique de l’espace. Ces centres commerciaux éclatent la morphologie traditionnelle de la ville (semblant ne même plus appartenir à la logique qui présida à la formation de la ville historique), mais à la fois masquent ce qui perdure d’une stratégie antécédente du centre, le raffermissement d’une centralité particulière, celle du pouvoir dans ses décisions.
En expulsant le caisson de l’intérieur vers l’extérieur, l’installation entière se décentre, c’est la périphérie qui interpénètre et interprète le centre (historique, de la vieille ville). Le centre (de l’installation) éclate en bouleversant la vie urbaine. La dislocation de la centralité est un danger, et de fait, on se heurte physiquement au caisson, mais la recomposition de centres selon des logiques aliénantes en est un plus grand encore.
La rue est caractéristique de notre rapport à la ville moderne, comme lieu de passage ou de rencontre, elle est une médiation qui a pris une plus grande importance que ce qu’elle relie. La rue est donc ce lieu de passage, d’interférences, ce lieu de circulation et de communication comme une sorte de microcosme de la vie moderne, elle rend public mais en déformant, en insérant dans le texte social ce qui se passe ailleurs, dans le secret (dans la configuration des itinéraires bourgeois, dans le décors aliénant du monde pavillonnaire, dans la misère de l’habitat soumis à l’organisation autoritaire des grands ensembles). La rue représente la quotidienneté de notre vie sociale.
Saturée de signes et de symboles, elle est également l’espace où les biens (marchandises, objets de la production) coïncident avec leur spectacle et leur publicité. A ce titre, le caisson lumineux fait signe, il fonctionne comme une enseigne publicitaire mais qui viendrait émietter la cohérence de cet espace urbain. Décentralisation d’un espace dans un autre, déroutant au sens propre du terme, le caisson lumineux produit une autre réalité, celle-ci inadaptée au flux de circulation de la rue. C’est cette inadaptation qui brouille les codes, qui trahit les comportements automatiques d’une utilisation aveugle de l’espace et de la consommation inconsciente des signes de la marchandise. L’habitat collectif dont le caisson se propose de nous faire la publicité est un bâtiment promis à la destruction. La logique architecturale de ce bâtiment indique également la destruction comme volonté à l’œuvre. Maintenir éclatées les couches de la population qui l’habitent (prolétariat et sous-prolétariat), c’est-à-dire en détruire les conditions profondes de rassemblement en produisant des individus isolés ensembles. L’irruption de la destruction au cœur de l’identification publicitaire nous indique ici la violence de la stratégie qui est à l’œuvre. La publicité ne fait pas autre chose que nous intimer l’ordre de consommer, présentant chacun comme un consommateur idéal consommant à profusion des objets de libre choix. Sans ce discours publicitaire ces objets ne seraient que ce qu’ils sont : des « choses » et non des « biens. » Mais ceci nécessite l’impérieuse obsolescence des marchandises afin de renouveler cette injonction : soyez heureux en consommant ! Un objet pousse l’autre, avec au cœur de ce système la destruction essentielle des objets de consommation. La violence de cet espace de la communication n’est pas symbolique, elle engage de fait l’espace social tel qu’il est vécu. La consommation et l’architecture répondent aux stratégies capitalistes les plus agressives où centres commerciaux et grands ensembles participent d’une même logique.
Jérôme Duvigneau
DétruirePostface
Renaud Rémond
Retard _ Cinq points, donc, pour une postface. Cinq points inégaux, mal équarris, dont il n’est pas certain qu’ils parlent d’une même voix, ni qu’ils partent d’un même point. Certains, plus lents, retardent sur les autres. Une postface, placée sous le signe du retard, est un texte déplacé ou inopportun, « tombant mal » ou au mauvais moment. Sa place toujours déplacée : derrière les autres, sans pour autant se résoudre à conclure ou à offrir une forme récapitulative et rassemblée. Ne sachant comment (en) finir, la postface dit l’atermoiement, différant le dernier mot. Loin du centre, le texte postface demeure excentrique à lui-même, à sa propre position : il ne referme rien et n’offre de parole qu’avant-dernière, pénultième, ni finale ni inaugurale, « entre ». Maurice Blanchot, lecteur de Samuel Beckett et de Franz Kafka, dit cette impossibilité de se taire dans l’impossibilité de parler. La postface, comme parole d’après-coup, laissant la parole à son état inachevé, s’agence donc différemment : comme un supplément, un reste, s’ajoutant sans former une continuité, manquant à toute progression et à toute nécessité. Et de fait, cette postface débutait mal, à contre-temps : l’écriture du texte a manqué de ponctualité et s’est précipitée dans l’urgence. Mais placé sous le signe involontaire du retard, le texte devait finalement rencontrer son objet : l’installation BP 297 - 9, rue Edouard Branly, 18006 Bourges cedex, de TTrioreau, dont la temporalité relevait elle-même des paradoxes du retard. Cinq points dispersés, autour d’une installation.
Promesse _ Dans un très beau texte en lambeaux , Luigi Magri analysait l’ambivalence des titres des installations de TTrioreau. Chaque installation prend pour nom l’adresse postale du lieu investi, institutionnel ou non. Le carton d’invitation, annonçant l’exposition, renvoie à une dénomination équivoque : à la fois titre et adresse. Luigi Magri reconnaît que ce dispositif onomastique rend, pour le spectateur, toute rencontre avec le travail de TTrioreau impossible, et que cette impossibilité devient l’objet même de l’exposition. Par son titre même, BP 297 - 9, rue Edouard Branly, 18006 Bourges cedex installe les conditions d’impossibilité de l’exposition. L’adresse, indiquée sur le carton et précédent l’exposition, « a un effet de programmation, de prescription ». Mais simultanément, l’adresse est le titre même de l’installation, indiquant que toute l’exposition tient là, dispersée dans sa propre imminence. On n’ira donc pas plus loin, d’une certaine manière. Luigi Magri écrit ainsi que les installations de TTrioreau sont toutes entières leur propre promesse : « la promesse ne sera jamais accomplie (…) : l’infinie répétition de la promesse reste sa continuité à promettre ». Le carton d’invitation, précédant chronologiquement l’exposition, promet l’exposition. Mais l’adresse, nom propre de l’exposition, ne donne ainsi rien à attendre d’autre qu’une promesse non tenue. Ne pas tenir promesse pour maintenir la promesse. Construire les conditions d’impossibilité de l’exposition, pour TTrioreau, relève de cette u-chronie, rencontre toujours différée, ajournée, retardée, entre le spectateur et l’installation. Se déplaçant à l’adresse indiquée, le spectateur fait l’expérience d’une installation dont il ne sera pas, paradoxalement, le contemporain. Cette non-coïncidence s’exprime également par le dispositif spatial de couloirs et de cloisonnement, permettant à TTrioreau d’inviter et d’exclure à la fois le spectateur : de ne l’inviter que sur le mode de la séparation. Mais le problème, avant d’être celui de l’espace urbain (comme les titres semblent spontanément l’indiquer), est bien celui d’une temporalité équivoque, promettant et ajournant l’exposition. Promesse demeurée promesse, l’installation échappe, dans son mode singulier de présence, à tout présent – au présent de la coïncidence ou de la rencontre, kairos esquivé ou manqué. Ce procès de décalage temporel n’affecte pas seulement le spectateur, mais l’installation même, qui a pour objet d’interroger l’architecture depuis un point encore à venir : sa destruction.
Miroir _ Monté sur un rail coulissant, un caisson lumineux permet la mobilité de deux photographies Duratrans® de l’intérieur du site d’exposition proprement dit, vers l’extérieur, l’espace public urbain. Elément constitutif du dispositif, le caisson lumineux permet d’interroger ce partage intérieur / extérieur, prothèse greffée sur le corps du bâtiment. Le caisson mobile fonctionne comme une enseigne lumineuse, s’adressant aux passants et rendant public l’objet d’exposition. Pourtant, ce miroir est en lui-même problématique. De quelle architecture les photographies présentent-elles, au juste, l’image ? Le caisson lumineux, par son volume, est un agencement, et non une surface : il construit un rapport entre deux images, qu’il faudra interroger. Mais remarquons, pour l’instant, que ce miroir propose, en regard d’un bâtiment, un autre bâtiment. Ce bâtiment n’est pas seulement une construction située à l’extérieur du site d’exposition, mais une construction promise à la destruction. Le dispositif spéculaire autorise à parler d’installation ex situ. Le dispositif du caisson lumineux permet en effet à TTrioreau d’interroger le site investi, BP 297 - 9, rue Edouard Branly, 18006 Bourges cedex, depuis son propre dehors, depuis une extériorité radicale, non pas un autre bâtiment, mais l’autre de toute architecture : son point d’effondrement.
Symptôme _ Regardant l’architecture depuis sa destruction (événement encore à venir), l’installation de TTrioreau lui porte un regard déjà posthume. L’équivoque du temps est donc double : promesse (la destruction aura lieu), l’image se présente également comme l’archive ou la mémoire anticipée d’un événement. Comment nommer cette seconde figure de la non-contemporanéité à soi de l’architecture ? La promesse dit l’imminence, le « pas encore », auquel doit être lié, sur un mode paradoxal, un « déjà là », qu’inscrit par avance le travail de TTrioreau . L’image du bâtiment est symptôme de sa propre destruction. La forme de la temporalité permettant à l’événement de retarder sur lui-même, ou de rester en attente de lui-même, est la formation du symptôme . Les deux photographies Duratrans® enregistrent cette attente, dont la destruction effective du bâtiment ne sera que l’expression posthume mais encore active, comme un impact longtemps retardé, venant de derrière, en amont. L’image proposée par TTrioreau reproduit la destruction sur le mode du contre-temps, propre au symptôme. Il s’agit de désorienter les relations de l’avant et de l’après, la destruction de l’architecture ne survenant que décalée, sans que nous puissions en décrire l’exacte contemporanéité. L’installation tente d’articuler ainsi un événement où plusieurs temporalités jouent contradictoirement à travers l’immobilité de l’architecture et de l’image photographique. Le présent de l’installation est composite : à la fois constitué par l’imminence de la promesse et par la survivance du symptôme.
Image _ Le caisson lumineux est la mise en rapport de deux images, photographies Duratrans®. Que signifie ce rapport ? S’agençant comme les deux faces du même dispositif, les deux images ne sont pas dans un simple rapport de juxtaposition. TTrioreau ne nous propose pas tant deux images distinctes, visibles successivement, mais, regardant le caisson comme rapport ou dispositif, l’expérience singulière de toute image. Qu’est-ce qu’une image ? Une image, c’est toujours deux images. Dont l’une, envers de l’autre, est bien, selon l’expression de Jean-Luc Godard, « a picture shot in the back » , une image prise de derrière. L’image apparaît depuis un point qui, sans être extérieur à l’image, est comme le dos de l’image, image derrière l’image. « Juste une image » : l’immanence de l’image ne renvoie pas à ce qui déborde son cadre (le hors-champ), mais à un contre-champ radical. La regarder serait alors pouvoir en regarder l’autre face ou l’envers. Mais TTrioreau en montre l’impossibilité : physiquement engagé dans un couloir, le spectateur de BP 297 - 9, rue Edouard Branly, 18006 Bourges cedex ne peut accéder visuellement à l’envers du caisson lumineux. Cette autre face, l’image prise de derrière, est l’autre de toute image, son étrangeté radicale, qui en forme pourtant l’immanence. L’image derrière l’image, sans réversibilité possible, décrit l’expérience singulière du voir. Maurice Blanchot dit : au fond des images, à partir duquel elles apparaissent, gît la nuit. Quel est ce « fond » d’invisibilité, cette duplicité de l’image artistique ? Dans un texte décisif , Maurice Blanchot désigne ce « derrière l’image », qui est l’image même, comme « fond d’impuissance où tout retombe ». L’image a le statut ontologique, comme pour Martin Heidegger, de mise à jour de l’étant en totalité. Mais pour Maurice Blanchot, l’être, à partir duquel apparaît l’image, n’est pas à proprement un « fond », c’est-à-dire un sol, une assise, mais : effondrement. L’œuvre d’art ne fait pas venir (herstellen) la terre en érigeant (aufstellen) un monde, tel qu’il est dit dans L’Origine de l’œuvre d’art, tension à partir de laquelle l’étant surgit et s’installe dans la présence de façon inaugurale. Si l’œuvre fait advenir la vérité, selon Martin Heidegger, c’est en ce sens : l’œuvre est la langue même de l’être, par laquelle tout ce qui est vient pour la première fois au paraître, fût-ce au prix d’une « secrète réserve », d’une dissimulation. Le mouvement, pour Maurice Blanchot, est inverse. Ce que nous entendons ordinairement par image doit être abandonné : un cadavre, comme étant singulier, est par excellence image. Etre livré au pouvoir des images, c’est en effet, de l’être, percevoir le désastre. Intimité sans intimité. L’image de l’architecture, chez TTrioreau, consiste bien en « l’apparition de l’original, jusque là ignoré » : non pas une image du bâtir, mais le rappel du bâtir comme image, c’est-à-dire comme effondrement. Dessous, derrière ou au fond des images : le terme sera ici nécessairement inexact. L’image est creusée par une « profondeur sans fond », un centre toujours ex-centré, qui décèle seul, loin des « objets » et du « réel », ce qu’il en est de l’être, un effondrement de l’ici, son désastre. Le contre-champ radical de l’image, proposé par TTrioreau, sous la forme d’une image derrière l’image, dit à son tour ce qu’il en est de l’architecture : détruire.
Renaud Rémond
Repérages #2
Atopie
« L’Ile qu’il voyait devant lui n’était pas l’Ile d’aujourd’hui mais celle d’hier. Au-delà du méridien, il y avait encore le jour d’avant ! »
Umberto Eco, L’Ile du jour d’avant, éd. Grasset, coll. Le Livre de Poche, 1994.
Déterritorialisation, nomadisme urbain et trans-urbain, virtualisation des territoires à l’ère des (télé)communications, phénomène de conurbation… Autant d’états-limites qui stigmatisent la nécessité d’une ré-appropriation du réel, d’une réinvention de nos modes d’habitat au réel.
Mais d’abord : où habitons-nous ? Du pavillon témoin au simulacre de ville, les artistes dénoncent les effets de massification qui accompagnent l’architecture et l’urbanisme comme les télé-technologies et le multimédia.
Plus de centre ni de périphérie, la ville enfle, s’étale, prolifère, vagabonde. Même dans les coins les plus reculés, l’entropie urbaine nous poursuit : conserves rouillées, sacs plastiques, piles, bouteilles, matelas défoncés, cartons, papiers gras, machines à laver, moteurs, déchets divers… Car avant d’être un espace construit, la ville est un espace habité ! La ville ne se crée pas seulement sur du bâti, mais aussi de liens invisibles, de substrats socioculturels, de réseaux humains, et, à l’heure des télécommunications, d’ondes hertziennes et satellitaires, de télévision, de radio et d’Internet. Et ce sont les artistes qui questionnent cette dimension virtuelle, ou disons invisible, de l’espace urbain.
Dans ce sens élargi, la ville recouvre tout le territoire et ne laisse aucune latitude pour la découverte d’un site. Le site, l’endroit idéal, se définit à travers l’harmonie entre le lieu, l’espace et l’échelle (1). C’est ce concept que les artistes du Land Art ont réinvesti dans le champ de l’art avec l’in-situ… Entre restauration du site et tribalisme, ces artistes ont ouvert la voie à plusieurs niveaux et parfois mystiques à certaines questions liées à la véhiculation ; l’œuvre de Michael Heizer, Circular Planar Displacement Drawing (1972), sorte de dessin dans l’espace avec ces traces de roues sur le sable, peut à ce titre être considérée comme emblématique.
Flux migratoires, précarité sociale, modes de vie transversaux, le nomadisme se trouve réactualisé dans une société d’hyper-urbanisation. Loin des systèmes traditionnels, il s’agit d’un nomadisme trans-urbain : le terme de transcience désigne le mieux cette itinérance désenchantée, qui tient de la dérive urbaine.Pavillon témoin et ville virtuelle
« La maison n’est plus qu’un décor tendu dans l’espace public, une enveloppe dénuée de tout contenu. La maison n’est plus qu’une scénographie architecturale désuète ou obsolète, sans espace intérieur à investir, réduite à son propre simulacre, dénué d’intériorité. »
Marie-Ange Brayer, La Maison : un modèle en quête de fondation in La Maison, Exposé n°3, éd. HYX, Orléans, 1999.
La maison, c’est la culture ramenée à l’échelle individuelle. Avant l’urbanisation et même la rurbanisation la maison se conquiert sur une nature sauvage ; elle est alors l’artefact principal du conflit entre culture et nature, conflit qui situe l’homme au monde.
Mais, c’est la ville tout entière qui abrite aujourd’hui la subjectivité, une subjectivité générique et communicative, toute en théâtralité et mise en scène de l’homme par et pour lui-même !
La maison est avant tout le lieu d’ancrage du domestique et de l’intime. Elle est ce Ç seuil affecté entre soi et le monde, (…) mais par la prescription de l’affect, du singulier et du propre (2).Enfermement et névrose domestique, Absalon multiplie des Propositions d’habitation (1991 et 1992), qui poussent à leur limites les recettes de l’architecture normative. Ses cellules prennent la forme de systèmes modulaires uniformes, espaces géométriques individuels quasi-cliniques ou carcéraux. Ses environnements hyper-clean, très minimalistes, réalisent une sorte d’anti-utopie comme métaphore d’une lutte individuelle contre les effets de masse et d’uniformisation. Dans une version hyperréaliste, la maison pavillonnaire, type Bouygues, incarne cette rationalité de masse où l’architecture est synonyme de formatage social : une affiche de Claude Lévêque, représentant un pavillon témoin, entouré de son carré de pelouse jalousement grillagé, lance une injonction sous forme interrogative : Prêts à crever ? (1998). Déjà, Gordon Matta Clark stigmatisait avec Splitting House (1974) cette violence du domestique comme lieu d’enfermement et de consensus aveugle. Il s’attaque à l’enveloppe d’une maison de banlieue qui, sectionnée en deux jusqu’à ses fondations, s’ouvre sur l’espace public, révélant une béance, un simulacre d’habitat.
Décor de façades, encorbellements, balcons et terrasses, la ville ne peut pourtant pas se concevoir comme une image fixe : La ville est d’abord une circulation, elle est un transport, une course, une mobilité, un branle, une vibration. (3).
Démultiplication des points de vue, altération de la perspective euclidienne, simultanéité kaléidoscopique, les artistes ont toujours cherché à manifester le dynamisme de la ville (citons seulement les études très futuristes pour une Citta Nuova d’Antonio Sant’Elia, les photomontages de la série Métropolis (1919-23) de Paul Citroën, ou plus tard, les dessins et esquisses de Constant, notamment son inquiétante Ode à l’Odéon (1969), …).
La ville s’incarne avant tout dans le mouvement et la vitesse, dans la circulation des flux humains et des télécommunications…
Tandis que l’architecture se fait sculpture, pur agencement d’espaces et de volumes, ce sont les artistes qui plongent dans les préoccupations de la vie quotidienne. Et ils réinvestissent en particulier l’univers de la communication, cette dimension invisible de l’espace urbain.
La série Projection, réalisée par Bernard Calet en 1999, se focalise sur des notions d’intimité et de voyeurisme. Il s’agit d’un Ç dispositif réunissant système de surveillance vidéo et vues d’intérieurs privés sur des écrans de latex ayant pour qualité ambigu de dématérialiser l’image (4). En juxtaposant l’univers intime et celui des télé-technologies, Bernard Calet souligne l’importance de l’image électronique dans notre appréhension de l’espace public. Autre exemple, ses Maisons/TV (1998) sont de petites maquettes en calque, qui portent sur leurs parois des téléviseurs de taille réelle, tels de monstrueuses excroissances ; des caméras de vidéosurveillance sont placées dans l’espace d’exposition, tandis que les téléviseurs, tournés vers l’intérieur des maquettes, ne donnent à voir qu’une aura lumineuse et colorée. Bernard Calet se situe toujours dans une opposition entre intérieur et extérieur, laissant entrevoir une porosité, une perméabilité des parois construites aux flux des télécommunications. Ses œuvres pointent le paradoxe de la maison comme lieu de repli, mais aussi comme lieu de projection vers un espace public idéalisé, à travers la télévision, les jeux vidéo, ou Internet…
Les préoccupations du binôme protaTTrioreau s’orientent également vers une prise en charge des outils de communication dans l’espace habité. Lors de l’intervention du 35, rue Marcel Tribut, 37000 Tours (BruitSecrets, CCC, Tours, octobre 1998), réactualisée rue Massenet, 44300 Nantes (Ecole d’architecture de Nantes, novembre 1999), une caméra de surveillance posée sur un vérin pneumatique télescopique, traverse le faux-plafond d’une pièce pour détruire la maquette du lieu, posée au sol à l’étage supérieur ; le film vidéo de la destruction est retransmis au-dessus de l’entrée.
Plus tard, l’exposition des archives de la destruction, au 9, rue de Charonne, 75011 Paris (galerie Le Sous-sol, Paris, mars 2000), donne lieu à une reconstitution architecturale à partir des images enregistrées : les vidéos sont alors retranscrites à travers une photocopieuse, image par image, sur des feuilles de rhodoïd qui s’amalgament à la sortie, recomposant un volume architectural tout en transparence et flux visuels. En démultipliant les points de vue et les supports, les deux artistes parviennent à dématérialiser les structures architectoniques, tout en formalisant les structures invisibles des télécommunications.
L’image publique que ces technologies contribuent à mettre en œuvre, avec les effets de repli, de cocooning qui leur sont liés, serait en train de supplanter l’espace public de l’ancienne cité… Pourtant, l’espace urbain, non-site de la subjectivité humaine, est de tout temps le giratoire des échanges inter-humains… Les réseaux n’ont pas attendu le web pour recouvrir les territoires! Théâtre de l’homme, la ville est déjà virtuelle.
Elle déborde de loin la cité grecque orthonormée dès lors qu’elle se fait l’image d’un homme qui est l’incessante altération des formes de l’humanité : ce qui reste de la ville, une fois passées la cité et la citadelle, une fois passés le bourg et le faubourg, la capitale et la métropole, c’est précisément encore, au-delà de ses formes, l’expansion et la prolifération, c’est la contagion des lointains, la communication disséminée, l’énergie fragile d’un sens inédit, rebelle à toute résidence. (5).
Et, on rejoint ici, mais dans une conception radicalement positive, ce que Paul Virilio nomme, dans un autre contexte, l’atopie domiciliaire.
Désert américain et véhicules
« Si l’on accepte de définir un site comme l’harmonie du lieu, de l’espace et de l’échelle, alors il faut reconnaître que la très peu héroïque histoire de la sculpture moderne part de ce constat navrant : il n’y a plus de sites. »
Thierry De Duve, Ex Situ in Cahiers du Musée d’Art Moderne, 1987.
Nomadisme urbain ou trans-urbain, itinérance ou déplacement désenchanté d’une ville à une autre, autant de nouvelles formes d’habitat qui se développent alors même que nous vivons la fermeture de la carte (6). Entre atopie urbaine et absence de Terra Incognita, il est possible d’affirmer définitivement qu’il n’y a plus de site, c’est-à-dire d’endroit idéal à concevoir pour y vivre.
Les artistes du Land Art sont partis dans le désert américain pour restaurer la notion de site, en renouant avec une nature sauvage… (7). Leurs œuvres s’inspiraient des sites mégalithiques ou des spirales des Nazca qu’ils croisaient dans leurs périples : Une ligne en Ecosse (1981) de Richard Long, les nombreux labyrinthes de Robert Morris, la fameuse Spiral Jetty (1970) de Robert Smithson… Richard Nonas nous explique que leurs attitudes se déterminaient en regard d’une sorte de lieu absolu : La sculpture en Europe est en effet pratiquement toujours mesurée en terme d’échelle domestique (…) ; tandis qu’en Amérique, une partie de la sculpture est construite à une échelle de lieu absolu (…) ; ainsi, lorsque nous sommes confrontés à Double Negative de Michael Heizer, par exemple, nous ne réagissons pas par rapport à l’objet lui-même comme on le ferait face à une sculpture européenne. On n’analyse pas non plus immédiatement la grammaire de cette double entaille. Au contraire, on expérimente d’abord la tension, le conflit de ce lieu ambigu et entier. (…) Ce qu’on y expérimente, en fait, est une sorte de lieu absolu, un lieu fait par l’homme et construit à l’échelle de la nature non construite. (8). Ces sculptures sont en fait le déni de la nature comme celle de la culture, car elle n’ont trait qu’à la relation et au conflit, entre nature et culture. (9). Ce lieu absolu, lieu du conflit et non de l’harmonie, renvoie à la définition du non-site ; en fait, toute la sculpture du Land Art est une tentative de reconstitution de la notion de site à même le constat de sa disparition. En ce sens, le site de tout l’in situ est un non-site comme Robert Smithson l’avait perçu sans illusions. (10).
D’ailleurs, ces sculptures portent très souvent, et sans ambiguïté, les stigmates de l’entropie : en particulier, Double Negative (1969) de Michael Heizer, avec ses 40.000 tonnes de terre déplacée, et le film étrange de la construction de la Spiral Jetty, témoignent d’un type de sculpture réalisée à coup de bulldozers, relevant d’une certaine esthétique de chantier.
Du site au non-site, les artistes du Land Art achoppent sur une radicale atopie, et ouvrent une problématique liée à la véhiculation.
De nombreux artistes entretiennent aujourd’hui un rapport à l’espace qui se construit sur des notions de déplacement et de mobilité. Ces pratiques artistiques, liées à la structure même de la ville, entament une réflexion sur d’autres modes de vie, communautaires voire tribaux.
L’opposition sédentarité/nomadisme trouve une réponse, un paradoxe sans surprise, avec la maison mobile ou mobil-home.
Réalisations concrètes, évocations, suggestions ou symboles, les artistes sont nombreux à imaginer des habitats mobiles. Comme Paul Ardenne le souligne (à propos du Mobil-home (1996) de Bernard Calet), ces véhicules marquent une infixation factuelle, une impossibilité d’adhérer en tous points à la vie sédentaire, appareils, structures et représentations confondues (11).
Pour son Mobil-home, Bernard Calet opacifie les fenêtres d’une baraque américaine, en utilisant de la peinture blanche qui sert à la signalétique des revêtements routiers. Dans le même esprit, la caravane de Franck Scurti, Mobilis in Mobili (1996), adopte le design d’une brique de lait, éminent symbole de domesticité pour les anglo-saxons. Eric Hattan immobilise une caravane en la transperçant avec un lampadaire en fonte ; l’artiste souligne ainsi les limites d’une forme d’autarcie nomade, qui resterait dépendante de certains aménagements collectifs… L’Espace-vehicle (1996) d’Andrea Zittel est lui absolument inhabitable, inutilisable ; mobil-home miniaturisé, il transporte seulement son propre concept d’une intimité en transit. Vito Acconci construit lui aussi des véhicules dont le plus connu est le Mobile Linear City (1991) : six unités d’habitation télescopiques sont déplacées par un tracteur de camion semi-remorque. Quand le camion est garé, la remorque s’étend en une ville linéaire, une ville en stockage qui propose un espace d’habitat précaire, réalisant une sorte d’anti-utopie.
Certains artistes réfléchissent pourtant à des formes d’utopies appliquées. Philippe Grégoire & Claire Petetin conçoivent La Maison portable/individual-global-home (1996-2000). Cette structure dépliable dans l’espace urbain, telle un accordéon, s’approche au plus près d’une adaptabilité organique au tissu existant. Très concrètement, les véhicules de Krzysztof Wodiczko sont autant des moyens de locomotion que de communication. En particulier, le Poliscar (1991) est conçu pour offrir et disséminer au sein des groupes de sans-abri, des stratégies et des techniques de communication, à travers le développement d’un réseau mobile de radio terrestre. Dans une veine plus singulière, les ateliers de Joep Van Lieshout aménagent des espaces domestiques mobiles, dans le but de concevoir et de pratiquer de nouveaux modes de vie, communautaires et autarciques : le Red Bathroom Unit (1993) comprend tous les accessoires d’une cabine de lavage utilitaire, tandis que le Baise-ô-drôme (1995) semble idéal pour faire l’amour même la table du mini-bar est recouverte d’une moumoute chatoyante…
L’art conçu comme un véhicule pour la pensée peut générer des modèles d’investissement du réel, qui varient entre utopie et utopie appliquée… L’opposition sédentarité/nomadisme se révèle au cœur de nombreuses préoccupations. Et encore, au-delà de l’objet qui permet le déplacement, au-delà du véhicule, certains artistes développent une esthétique de la transcience, c’est-à-dire de la dérive urbaine et du voyage, fut-il imaginaire… Joe Sola habite Los Angeles, la ville des villes, et fait partie de ces nomades trans-urbains. Ses vidéos manifestent des préoccupations communes, entre site médiatisé et dilatation du temps. Pullouts (1999) collectionne les têtes de lits d’hôtels, qui, filmées en zoom avant sur une musique Top kitsch, arborent toutes un dessus-de-lit fleuri et la reproduction d’un lointain paysage, un vrai site cette fois, jardin d’Eden ou rêve de jeune fille… La série Annotation (1998) est une suite d’images fixes, des intérieurs et des vues urbaines, où un homme pose, immobile, en tension, tandis que le reste du monde s’absorbe dans la fuite du temps.
« Aller ailleurs sans aller nulle part à la manière de ce héros de Samuel Beckett qui rêve d’un parcours par un espace sans ici ni ailleurs où jamais n’approcheront ni n’éloigneront de rien tous les pas de la terre. »
Pour finir encore, éd. de Minuit, p. 14.
Les diverses pratiques artistiques, tout juste effleurées au fil de ce texte-parcours, traitent de manière transversale de la ville, de l’espace urbain, des nouvelles technologies de la communication, du rapport site/non-site, et du véhicule… bref, du déplacement et de la vitesse. Ce repérage, qui fonctionne sur la juxtaposition et le collage, tente de mettre en parallèle certains champs réflexifs et artistiques, autour de la notion d’atopie…
Et, la transcience peut se concevoir comme une conséquence entropique d’une radicale atopie, mais aussi, comme une contre-culture fière et autarcique ! Libres à l’intérieur d’un magma urbain sous haute surveillance, nucléaire et chaotique, de nombreux jeunes artistes rejettent la notion de site comme trop uniforme, trop clean, pour défendre certains modes d’habitat archaïsants et anarchisants.
Atopie et itinérance désenchantée d’une ville à une autre, il semble que le voyage se situe dès lors avant tout dans une dimension temporelle, et peut-être pourrait-on dire que certains conflits idéologiques qui animent les polémiques d’aujourd’hui se déroulent entre les pieux descendants du temps et les habitants acharnés de l’espace. (12).
En évoquant Purity Test (1982), cette peinture de Mark Tansey qui représente des indiens à cheval scrutant au loin la Spiral Jetty (1970), une conception non-linéaire de l’histoire et du temps se pose là : de quoi porte mémoire la parfaite géométrie de Spiral Jetty avec sa complexe formation cristalline destinée à disparaître dans un paysage post-apocalyptique ? Est-ce la mémoire d’un scénario futur qui se dissout dans un passé préhistorique, désertique ? (13).
Anne-Laure Even, Atopie, Repérages #2, Documents sur l'art, Les presses du réel, 1999 (non paru)
Notes :
(1) Thierry de Duve, Ex Situ in Cahiers du Musée d’art moderne, 1987(2) Marie-Ange Brayer, ibid
(3) Jean-Luc Nancy, La ville au loin, coll. La ville entière, éd. Mille et une nuits, 1999, p. 42
(4) Paul Ardenne in cat. Bernard Calet, Centre d’art contemporain de Vassivière en Limousin, 1999
(5) Jean-Luc Nancy, La ville au loin, ibid. p. 61
(6) Hakim Bey, La psychotopologie du quotidien in TAZ (Zone Autonome Temporaire) : la dernière parcelle de terre n’appartenant à aucun Etat-Nation fut absorbée en 1899. Notre siècle est le premier sans terra incognita. http://ourworld.compuserve.com/homepages/mumbly/taz.htm
(7) Lire aussi Climats de site, conversation entre Steve Di Benedetto, Peter Halley et Robert Nickas (1988) in cat. Compilation-Le Consortium, une expérience de l’exposition, éd. Les presses du réel, 1998
(8) Richard Nonas, La maison loin de la maison - la sculpture et l’extension de la maison in La Maison, Exposé n°3, ibid
(9) Richard Nonas, ibid
(10) Thierry de Duve, ibid
(11) Paul Ardenne, ibid
(12) Michel Foucault cité par Damien Sausset, New territories, extensible apartment, Hong Kong project, in cat. protaTTrioreau, éd. Ecole supérieure des beaux-arts de Tours, janvier 2000
(13) Alessandra Ponte, La maison de la lumière et de l’entropie - habiter dans le désert (américain) in Exposé n°3, ibid
46, RUE GUSTAVE EIFFEL, 18000 BOURGES, FRANCE
Images d'Agence
Une exposition de l'Agence d'artistes du Centre de Création Contemporaine
Portés par l'audience très positive de cette exposition, le CCC et la Scène Nationale ont décidé de poursuivre l'expérience à chaud avec une deuxième mouture intitulée Images d'agence. Sur un principe identique - présenter des projets produits par l'Agence d'artistes - il s'agit cette fois, comme le titre ne l'indique pas, d'oeuvres qui s'articulent notamment autour de l'objet, de l'installation, de la vidéo. A nouveau, on notera la présence très forte d'une génération montante d'artistes, dont certains sont issus de la région où le CCC est implanté.
Parmi ces artistes figurent Philippe Ramette avec son "Piercing" (1998) géant, Stéphane Calais dans une composition picturale sobrement nommée "Couleurs" (1998), Kristina Solomoukha qui avec "Sans titre" (1998), propose une vision de la ville abstraite dans une maquette-installation en plexiglas. Alec de Busschere, Franck Scurti, Boris Achour, Saâdane Afif, Mathieu Mercier y présentent également des pièces qui prennent possession de l'espace et développent un parcours en deux et trois dimensions au sein des volumes généreux du théâtre.
Premier bilan. Après six ans d'activités, le Centre de Création Contemporaine de Tours a choisi d'exposer une quinzaine de projets produits dans le cadre de l'Agence d'artistes. Dispositif original, l'Agence d'artistes est une des activités les plus récentes du centre d'art, tournée vers la production de projets et d'œuvres, sans lien imposé avec la programmation d'expositions. Le CCC accompagne la réalisation d'une pièce, de sa conception à sa production, sur les plans artistique et technique mais également sur le plan financier. Ce qui permet l'émergence de projets parfois délicats à concrétiser en raison du coût de leur développement. L'Agence se veut également un interlocuteur pour les partenaires publics, les associations qui souhaitent développer des projets par exemple de commande publique. Depuis ses débuts, l'Agence d'artistes a produit une cinquantaine de pièces, montrées soit dans l'espace urbain, soit dans le cadre de manifestations en France et à l'étranger ou encore au CCC.
“Images d'Agence” - titre de l'exposition que le CCC présente au Carré St Vincent - Scène Nationale d'Orléans, regroupe une dizaine d'artistes ayant bénéficié du concours de l'Agence : Ryuta Amae, Alec de Buschère, Pierre Joseph, Guillaume Janot, Nicolas Moulin, TTrioreau, Sam Samore, Anne-Marie Schneider, Allan Sekula et Bruno Serralongue. La quinzaine d'œuvres exposées s'articule autour de la thématique de l'image dans le travail des plasticiens, qu'elle soit abordée sous l'angle du portrait, du documentaire, de la représentation de l'architecture et de l'urbanisme ou de la fiction.
Il faut retenir surtout de l'exposition la confrontation d'œuvres qui, réunies, dégagent une ligne de force faite de multiples passerelles. Chaque production de l'Agence étant sa propre fin, les pièces n'ont pas de rapport a priori et restent des projets singuliers. C'est bien l'ambition de l'Agence : produire des projets qui gardent leur cohérence, quelque soit leur exploitation ultérieure (exposition, publication, intervention dans la ville, extension, ...). Il s'agit donc d'œuvres, et c'est en tous cas le pari de l'Agence, qu'il est possible de réactualiser ou recontextualiser à loisir.
A cet égard, certaines posent la question de façon beaucoup plus simple que d'autres. Les photographies sur le concert de Johnny Halliday à Las Vegas de Bruno Serralongue, grands tirages couleurs de portraits de fans, où les images numériques du japonais Ryuta Amae sur des architectures improbables, oniriques et finalement angoissantes, constituent des travaux dont la monstration est somme toute classique. De même pour les photographies de Guillaume Janot sur le quotidien et sa dimension fictionnelle, où les personnages semblent raconter une histoire en " jouant " leur vie. Il en va différemment des projets de Pierre Joseph ou de TTrioreau.
Dans le premier cas, " Little democracy " de Pierre Joseph, est un projet de 1997 qui a suivi un processus de création tout à fait particulier. L'artiste a créé une sorte de galerie de personnages qui fait partie de son univers et qui constitue pour tout un chacun une sorte de mythologie contemporaine. On y retrouve les figures de Blanche-neige, du CRS, du plongeur, de Superman, au total une vingtaine de personnages. Pierre Joseph a d'abord réuni ces figures sous la forme d'une exposition au CCC, où des personnes " en costume de " attendaient les visiteurs et jalonnaient les espaces du centre d'art. De cette sorte de performance, Pierre Joseph, avec la complicité du photographe de mode Philippe Munda, a réalisé un ensemble de photographies, objet de la production de l'Agence. Deux séries ont été produites ; 20 sérigraphies au format affiche qui peuvent être présentées dans l'espace urbain, et 20 autres montrées dans le cadre d'expositions.
A la Scène Nationale, lieu de création et de diffusion consacré entre autres au spectacle vivant, les photographies de Pierre Joseph ont été installées comme des jalons du parcours du visiteur. On les retrouve dans le hall, à l'entrée des salles de spectacles, dans la coursive des escaliers, un peu comme si l'œuvre accompagnait le spectateur en l'emmenant à travers des histoires imag(in)ées.
46, rue Gustave Eiffel, 18000 Bourges, projet de TTrioreau - ndlr Hervé Trioreau, pose la question de la réactualisation avec encore plus d'acuité. La pièce présentée à Orléans est un caisson lumineux de 2,5m sur 1,6m où sur chaque face est installée une photographie cibachrome. Réalisée initialement pour La Box, galerie de l'Ecole nationale supérieure d’art de Bourges, l'œuvre a été produite par l'Agence d'artistes avec la conviction qu'elle pourrait s'adapter ailleurs. Sa présentation dans cette exposition est en quelque sorte une vérification de ce postulat. En effet, à Bourges le projet était spécifique au lieu. Les trois baies vitrées donnant sur la rue avaient été déposées, le caisson lumineux était installé sur un rail pouvant le faire sortir de la galerie pour "entrer" dans l'espace public. Les baies externes constituaient les entrées, où deux passerelles construites rendaient La Box ouverte de jour comme de nuit. L'installation jouait sur le rapport intérieur/extérieur, espace privé/espace public. Les deux photographies représentant le premier immeuble de logements sociaux d'un quartier du nord de Bourges, confrontaient la réalité du centre urbain historique avec la périphérie et ses espaces intermédiaires.
Au Carré St Vincent, il s'agissait de donner son autonomie au caisson lumineux. Placé au niveau de la mezzanine et dominant l'espace du hall, le caisson se transforme en une enseigne lumineuse, symbole de la ville à l'extérieur, que le visiteur vient de quitter en pénétrant dans le théâtre. Il fait signe et renvoie l'observateur au dehors, avec d'autant plus de force que sa présence physique, visuelle est quasiment incontournable. Enfin, il annonce de façon synthétique et efficace les enjeux de l'exposition du CCC dans l'exploration des images par les artistes. Un approfondissement supplémentaire pour TTrioreau, dont la démarche artistique se concentre sur les rapports entretenus entre la ville, l'architecture, les habitants, l'interaction de ces phénomènes urbains entre eux et la perception que l'on peut en avoir.
L'ensemble des pièces constitue un parcours que le CCC a choisi de construire en osmose avec le lieu qui l'accueille. Plus que d'une présence affirmée, on peut parler d'une subtile diffusion. Ainsi du projet de Sam Samore " The Magic Bed ", qui pour impressionnant qu'il soit, a été installé dans l'espace galerie qui devient une monumentale alcôve plongée dans l'ombre. " The Magic Bed " se présente en un lit de taille démesurée, muni de coussins à la disposition des visiteurs. Au dessus du lit, quatre moniteurs en suspension diffusent des contes lus par des acteurs, dont les visages alternent avec des plans sur des espaces naturels.
Métaphore d'un espace où les sens se confondent avec la psychologie de chacun, " The Magic Bed " donne à expérimenter la distance entre notre perception des éléments extérieurs qui nous stimulent et la réalité. Plongé dans l'univers qui lui est offert, le spectateur se laisse aller sur un itinéraire à mi-chemin entre rêve individuel et données fictionnelles visuelles et sonores.
Le Centre d'art, au regard de cette expérience plutôt réussie, s'interroge aujourd'hui sur l'avenir de l'Agence et sa possible autonomisation fonctionnelle et de lisibilité. L'heure est à une réflexion au cadre assez large, puisqu'un certain nombre d'aventures similaires, bien que peu nombreuses, existent tant dans la sphère privée - fondations, galeries - que du fait d'initiatives d'artistes tel Fabrice Hybert qui a créé UR, une structure chargée de l'accompagnement et du financement de projets. Nous sommes sûrement à un moment charnière, où ces projets vont aller en se multipliant. Car dans un contexte où les artistes interviennent en des lieux de plus en plus hétérogènes, où les coûts de production augmentent, où les actions relèvent autant du projet que de la production d'une œuvre, une structure comme l'Agence d'artistes répond aux besoins de démarches désormais multiformes.
Greg Larsson
http://www.p-o-s.org, http://www.p-o-s.fr.st
Initié par Bernard Calet, Sammy Engramer, TTrioreau et Frédéric Tétart, « Plan d’Occupation des Sites » est un laboratoire artistique permanent sur l’espace urbain de la ville de Tours et de son agglomération. Son objectif : instaurer et développer une recherche sur l’appréhension de ce territoire du quotidien au-delà de son identité matérielle et statique. Déterritorialisée sur la toile, la dimension physique de la ville disparaît ici au profit d’espaces critiques et utopiques, de sites alternatifs. Trame, texture, carte, image, texte, son, la ville est traitée comme un matériau à la fois vivant et inerte, noble et dénaturé. Imaginer l’ailleurs dans l’ici, ouvrir l’ici à son ailleurs, cette démarche émet des hypothèses sur une autre lecture du réel et de ses composantes. Conçus à partir des modèles déambulatoires propres à l’hypertexte, les projets de chaque artiste se découvrent à travers des parcours disséminés et fragmentaires. La mutation rhizomatique de l’urbain contemporain trouve une transposition possible dans les nœuds, liens, déplacements et renvois du net. L’urbanisme du « Plan d’Occupation des Sites » se déploie ainsi grâce à la liberté des choix, des comportements et des désirs. Comme un champ de pensée et d’action qui nécessite et intègre la pensée et l’action de l’autre, des autres. Parce que faire, refaire, défaire la ville à travers des processus virtuels est une façon de la retrouver, de la comprendre, de la revendiquer.
Lieu prospectif, espace de projection, laboratoire de recherche, le site http://www.p-o-s.org, http://www.p-o-s.fr.st est pensé comme évolutif, susceptible d’accueillir d’autres interventions d’artistes, autour de l’architecture, de la cité, de l’espace, de la perception et des N.T.I.C. Le site Internet trouve alors sa dimension de véritable espace critique.
http://www.p-o-s.org, http://www.p-o-s.fr.st propose donc d’installer sur le réseau Internet une collectivité réelle, qui se définit à la fois à travers son inscription locale et tourangelle, mais aussi son ubiquité et son indépendance. Des enjeux plus larges se dessinent ici : faire valoir une autre culture du local, basée sur la participation plus que sur la consommation, et, en parallèle, garder une tension entre le réel et le virtuel. Investissant l’outil Internet sans aucune complaisance technologique, les artistes (Bernard Calet, Ewen Chardronnet, Sammy Engramer, Thierry Joseph, Frédéric Tétart, Hervé Trioreau, …) proposent une sorte de parcours multiple, une déambulation aléatoire dans la ville de Tours, envisagée comme un site générique à travers sa virtualisation. Internet offre la possibilité de déplacer des éléments réels de la ville et de les mixer, de les mélanger avec d’autres dont les origines sont variées, pour redéfinir un autre espace, infiniment démultipliable et souple.
Le projet artistique du collectif http://www.p-o-s.org, http://www.p-o-s.fr.st transforme le plan d’occupation des sols en plan d’occupation des sites ! Un lieu d’échanges et de recherche, sur Internet, autour des questions de l’espace urbain et de l’utopie.
Le site http://www.p-o-s.org, http://www.p-o-s.fr.st propose un parcours multiple dans la ville de Tours, ponctué d’interventions artistiques qui portent un autres regard sur cet espace du quotidien. La configuration urbaine, comme l’usage et les fonctions des sites, cristallise les strates des évolutions sociales, politiques et économiques spécifiques à chaque ville. A Tours, dans le cadre du réaménagement de la ville, qui prévoit la création d’une ligne de tramway, Bernard Calet observe que les pavements des trottoirs de l’artère la plus commerçante dessinent des motifs identiques à ceux que l’on trouve dans les tapis. Il s’agit d’un rappel historique choisi par les habitants : Tours est une ville carrefour entre l’axe Nord / Sud et l’axe Nantes / Lyon. Pendant la Renaissance, ces axes constituaient la route de la soie. Déplacement, tressage, maillage, ces termes ne sont pas sans rappeler les notions de circulation et de passages propres à l’architecture d’Internet.
C’est à partir de ce motif que http://www.p-o-s.org, http://www.p-o-s.fr.st est conçu, comme une extension de ce système microscopique du pavé tourangeau mais à une échelle planétaire de circulation macroscopique : celle d’Internet. L’armature du site reproduit ce système de maillage, reliant entre elles les interventions de chaque artiste tout en laissant ce système ouvert aux interventions futures. En déplaçant la trame du tapis vers des espaces périphériques de la ville, Bernard Calet introduit des décalages qui font sens dans le langage symbolique de l’urbanisme. Ces installations fragilisent les frontières entre espace public et espace privé, attribuant à ce cadre statique et décoratif la qualité du signe d’un espace de réception, d’un lieu d’accueil. Sammy Engramer s’intéresse également aux marges de la cité et imagine des stations vertes au sein des lotissements en expansion. Il repère des terrain à bâtir qu’il propose d’utilise comme des espaces de convivialité : aménagements de places, esplanades, lieux de vie collective…
TTrioreau intervient sur le mode du parasitage, par intrusion de panneaux publicitaires à l’intérieur d’autres propositions. Relevant d’une certaine esthétique du chantier, ces panneaux affichent des photographies prises pendant les travaux de la Rue Nationale. Il s’immiscent également dans l’espace sonore public en squattant, virtuellement, les haut-parleurs qui diffusent musique commerciale et slogans publicitaires les jours de grande braderie et d’émulation consumériste. Frédéric Tétart utilise des stratégies d’infraction dans les projets des autres artistes qui lui offrent des fragments de matière pour construire des architectures de fortune. Il joue ainsi sur les notions de propriété et de pouvoir qui régissent la morphologie de la ville comme l’espace d’Internet.
Du privé au collectif, http://www.p-o-s.org, http://www.p-o-s.fr.st établit les conditions d’échange et de mobilité, de rencontre et de fragilité qui fondent la notion d’espace public. Le projet se situe ainsi au confluent de plusieurs problématiques actuelles, liées d’une part à l’aménagement urbain, et d’autre part au développement des nouvelles technologies. Il est possible de penser des utopies au présent, des utopies appliquées, avec une conception décomplexée de l’espace-temps, sans caution de l’ancien ni dictature du nouveau…
9, RUE DE CHARONNE, 75011 PARIS
Une première phase a été réalisée deux fois : la première, dans une maison désaffectée, 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS en octobre 1998 et la deuxième, en novembre 1999, à l'Ecole d'architecture de Nantes, RUE MASSENET, 44300 NANTES. Une caméra de surveillance couleur, posée sur un vérin hydraulique télescopique, traversa le plafond d'une salle pour détruire à l'étage supérieur l'intérieur de la maquette de ce même espace architectural en opérant un travelling vertical. Le film vidéo de la destruction, procédant à la mise en abîme du lieu, a été retransmis à l'entrée, au-dessus du seuil de cet espace que l'on découvrait d'un point de vue peu habituel, traversé du sol au plafond.
La seconde phase a pour cadre la galerie Le Sous-sol, 9, RUE DE CHARONNE, 75011 PARIS où sont exposées les archives de la destruction : un moniteur diffuse le film vidéo dans la première salle et dans la deuxième salle, un moniteur diffusant le même film vidéo est couché sur une photocopieuse couleur qui en reproduit les images. La stratification des copies (feuilles de plastique transparentes) reconstitue ainsi l'image inversée du bâtiment détruit et forme elle-même, par entassement, une architecture-palimpseste.
Investissant ces espaces, protaTTrioreau exhibent la production de structures anomales, ou irrégulières, immanente au champ de normalisation urbaine. L'architecture n'est statique que par l'identité contrôlée que celle-ci assigne. En proposant une perspective alternative, l'installation l'inscrit comme processus polémique. Elle interroge notre confiance en la solidité structurelle du bâtiment, en son immobilité et sa permanence, pour le décrire comme intervalle, passage ou transition.
Le travail de protaTTrioreau, issu de la réunion de deux jeunes artistes, Vincent Protat et Hervé Trioreau, s'inscrit dans une réflexion liée à la nature du réseau urbain. Leurs propositions, installations spatiales et visuelles, agissent sur les structures même de l'espace construit. Elles mettent en place des déplacements qui perturbent et désignent, de façon politique, le caractère normatif de l'architecture. La forme architecturale ne s'érige plus d'un sol mais à l'intérieur d'une expérience critique. Elle ne prend consistance et n'acquiert une réelle existence qu'au moment où elle met en jeu un dialogue au sein duquel l'image assume le rôle de vecteur communicationnel apte à déterritorialiser notre perception. En jouant sur les modes de représentation de l'espace architectural, son échelle, ses limites, jusque sa réalité, protaTTrioreau entend révéler la pluralité et la mobilité des points de vue. Central et prescriptif dans la perspective classique, l’œil est devenu mobile face à une nature désormais fragmentaire et contingente : passage de la tavoletta, le prototype par lequel l'espace moderne de visibilité s'est trouvé institué (à l'origine de la perspective), à la quadratura, une respiration spatiale ouvrant un infini dans l'architecture, la dissolvant dans la lumière, où l'espace feint se confond avec l'espace réel.
Destruction en duo
Vincent Protat et Hervé Trioreau sont encore inconnus du grand public. Pourtant ces deux jeunes artistes, plus connus sous le nom de protaTTrioreau, ont réalisé ces trois dernières années plusieurs œuvres stupéfiantes de lucidité et de maturité. Leurs propositions s’attachent à analyser notre contexte urbain, à révéler combien la structure économique et sociale des villes dépend désormais de processus de normalisation sans aucune autre logique que celle du profit. Pour leur première exposition à Paris, ils ont choisi de présenter un projet dont une première version était déjà visible l’an dernier au C.C.C. de Tours. Dans une maison abandonnée, vouée à la destruction, ils avaient placé une caméra au rez-de-chaussée, qui grâce à un vérin hydraulique transperçait le plafond pour aboutir dans l’intérieur d’une maquette de la même maison. Sur un moniteur, le spectateur pouvait suivre l’évolution de cette destruction. Aujourd’hui, la Galerie Le Sous-sol présente les archives de cette intervention. L’installation se compose d’un photocopieur couleur couplé au moniteur où est diffusée la vidéo de la destruction. Chaque image est reproduite en direct sur un papier transparent. Lentement, la pile de photocopies reconstitue en trois dimensions le déroulement de la destruction. En jouant sur notre fascination naturelle face à toute image violente, en anticipant la destruction réelle de cette maison, protaTTrioreau racontent sur un mode dramatique combien nos habitations, nos maisons et immeubles ne sont plus que des éléments sans importance dans le monde aujourd’hui.
Damien Sausset, critique d’art, Art Press, Connaissance des Arts, …, Paris, France
L’oeil, numéro mars, p. 86, 2000
RUE MASSENET, 44300 NANTES
La galerie de l'Ecole d'Architecture de Nantes, ouverte depuis une année et initialement dédiée à une programmation liée à l'enseignement de l'école, inaugure, avec l'intervention de protaTTrioreau, un autre type d'exposition orientée vers des champs créatifs voisins, en particulier celui de l'art contemporain.
Le travail de protaTTrioreau, issu de la réunion de deux jeunes artistes, Vincent Protat et Hervé Trioreau, s'inscrit dans une réflexion liée à la nature du réseau urbain.
Leurs propositions, installations spatiales et visuelles, agissent sur les structures même de l'espace construit. Elles mettent en place des déplacements qui perturbent et désignent, de façon politique, le caractère normatif de l'architecture.
La forme architecturale ne s'érige plus d'un sol mais à l'intérieur d'une expérience critique. Elle ne prend consistance et n'acquiert une réelle existence qu'au moment où elle met en jeu un dialogue au sein duquel l'image assume le rôle de vecteur communicationnel apte à déterritorialiser notre perception.
En jouant sur les modes de représentation de l'espace architectural, son échelle, ses limites, jusque sa réalité, protaTTrioreau entend révéler la pluralité et la mobilité des points de vue.
Central et prescriptif dans la perspective classique, l’œil est devenu mobile face à une nature désormais fragmentaire et contingente : passage de la tavoletta, le prototype par lequel l'espace moderne de visibilité s'est trouvé institué (à l'origine de la perspective), à la quadratura, une respiration spatiale ouvrant un infini dans l'architecture, la dissolvant dans la lumière, où l'espace feint se confond avec l'espace réel.
RUE MASSENET, 44300 NANTES, l'installation présentée à l'Ecole d'architecture de Nantes, réutilise le principe de 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, autre installation réalisée à Tours en 1998, dans une ancienne maison abandonnée. Elle est ici réactualisée en s'adaptant au nouveau contexte.
Dans cette lignée conçue à travers l'établissement de relations spatiales entre l'objet et l'architecture, RUE MASSENET, 44300 NANTES s'ordonne comme le récit, l'archive d'un événement qui n'a pas (encore) eu lieu : la destruction du bâtiment de l'Ecole d'architecture de Nantes, site donnant son titre à l'intervention.
Première phase du récit : une caméra de surveillance couleur, posée sur un vérin pneumatique télescopique, traverse le faux-plafond d'une salle pour détruire à l'étage supérieur l'intérieur de la maquette de ce même espace architectural ( l'Ecole d'architecture de Nantes ), en opérant un travelling vertical. Le film vidéo de la destruction, procédant à la mise en abîme du lieu, est retransmis à l'entrée, au-dessus du seuil de cet espace, que l'on découvre d'un point de vue peu habituel, traversé du sol au plafond.
La seconde phase de l'installation-récit aura pour cadre une galerie (Le Sous-sol, 9, RUE DE CHARONNE, 75011 PARIS) où seront exposées les archives de la destruction : le moniteur diffusant le film vidéo sera couché sur une photocopieuse couleur qui en reproduira les images. La stratification des copies (feuilles de plastique transparentes) reconstituera ainsi l'image inversée du bâtiment détruit et formera elle-même, par entassement, une architecture-palimpseste.
Investissant ces espaces, protaTTrioreau exhibent la production de structures anomales, ou irrégulières, immanente au champ de normalisation urbaine. L'architecture n'est statique que par l'identité contrôlée que celle-ci assigne. En proposant une perspective alternative, l'installation l'inscrit comme processus polémique. Elle interroge notre confiance en la solidité structurelle du bâtiment, en son immobilité et sa permanence, pour le décrire comme intervalle, passage ou transition.
Isabelle Le Doussal, chanteuse pop, artiste et architecte, Nantes-Paris, France
1999
protaTTrioreau, RUE MASSENET, 44300 NANTES
L'installation de protaTTrioreau que l'Ecole d'architecture de Nantes a accueillie dans son lieu d'exposition « La Galerie » à l'initiative d'Isabelle Le Doussal est une intervention directement liée aux préoccupations artistiques contemporaines s'agissant des rapports entre l'architecture et la vidéo. Comment rendre compte des interactions entre l'image et la construction ? Par quels procédés peut être mise à jour cette question sans proposer d'autres types de constructions mais essentiellement une réflexion sur la construction et son rapport à l'image documentaire et de fiction ?La confrontation des figures de l'architecture moderne avec les possibilités de l'image vidéo, notamment à partir de la vidéo surveillance, présente une voie décisive pour mettre en avant les dimensions sociales, culturelles et économiques qui interagissent dans tout projet de construction et d'habitation. Le film vidéo sert d'outil de recherche pour extraire ce qui semble essentiel dans l'architecture à savoir son lieu plastique de fragilité. Lent travelling vertical au coeur du bâtiment : la succession des images se poursuit jusqu'à l'irruption, à l'étage supérieur, dans une maquette-reproduction de ce même bâtiment. Le vérin pneumatique sur lequel est fixé la caméra vidéo s'élève jusqu'à traverser le plafond puis détruire, au centre de la maquette, la reproduction de ce même plafond. Les spectateurs assistent, à quelques mètres de là, à cette éventration depuis un moniteur placé au-dessus d'eux. Toute cette installation vidéo tend à renverser les perspectives normées et les repères habituels en vue de fragiliser l'édifice par la dissolution des sens de lisibilité. La destruction filmée s'interprète comme une réflexion sur l'architecture dont l'ancrage conceptuel s'appuie sur un procédé littéraire : le palimpseste.
Dans le processus de « l'architecture-palimpseste », la destruction constitue la première étape, c'est-à-dire le moment de l'enregistrement sur bande vidéo. Il convient alors de reconstruire en ajoutant le signe explicite de cette fragilité. Ce second moment, évoqué oralement par protaTTrioreau lors du vernissage, consiste à recomposer image par image, en impression sur des feuilles rhodoïds transparentes, le film de la perforation à l'aide d'une photocopieuse couleur sur laquelle le moniteur vidéo projettera le film au ralenti. En strate, les feuilles rhodoïds reconstitueront alors l'image négative de l'intérieur du bâtiment puis de la maquette à mesure que le vérin s'élève, ou l'image positive de la destruction.
A l'Ecole d'architecture, les étudiants et le public venus constater le travail de protaTTrioreau se donnaient La possibilité d'assister à une réflexion sur l'architecture menée par deux artistes dont l'essence du travail peut être entendu invariablement dans l'horizon des préoccupations concernant l'image médiatique, le droit à l'image, la vidéo surveillance, les conditions normées de représentation sociale de la propriété privée, des lieux publics, des institutions, les documentaires sur l'architecture...
A l'effacement produit par « l'architecture-palimpseste », effacement des repères spatiaux et de l'image normée de la construction, correspond aussi le titre de l'exposition qui n'est en aucun cas « l'architecture-palimpseste », lequel reste uniquement le concept, mais simplement l'adresse postale du lieu détruit : RUE MASSENET, 44300 NANTES. Doivent alors demeurer exclusivement l'image et l'adresse afin que persiste l'idée par laquelle l'art entre toujours par effraction, ne laissant comme trace que l'empreinte intentionnelle du passage dans le lieu, avec ici, cela paraît évident, le singulier plaisir d'être intervenu dans une école où l'on apprend à construire durablement.
Jérôme Diacre, philosophe et critique d’art, Tours, France
Zéro Deux, numéro 12, p. 4
35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS
Le projet ici proposé s’inscrit dans la continuité d’un travail entamé depuis trois années dont le propos est axé sur une redéfinition du champ architectural. Aujourd’hui, nous souhaitons poursuivre notre expérimentation à travers l’investissement d’une habitation privée : une installation met en œuvre un dispositif comprenant une maquette, exacte reproduction du 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, dont les parties internes, c’est-à-dire les différentes pièces cloisonnées, sont détruites par une caméra de surveillance couleur montée sur un vérin hydraulique télescopique.A l’opposé du premier temps de cet événement architectural suivra la mise en place d’une structure mobile (un moniteur posé sur une photocopieuse couleur) permettant la reconstitution par strates transparentes photocopiées de l’intérieur du bâtiment déconstruit.
35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS
35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS s’ordonne comme le récit, l’archive, d’un événement qui n’a pas (encore) eu lieu : la destruction prochaine du bâtiment, site donnant son titre à l’intervention.
Première phase du récit : une caméra vidéo, posée sur un vérin hydraulique télescopique, traverse le plafond d’une maison, pour détruire à l’étage supérieur la maquette de cette même maison. Le film vidéo de la destruction est simultanément retransmis à l’extérieur, au-dessus du seuil. La seconde phase de l’installation-récit, a pour cadre l’espace d’une galerie, où sont exposées les archives de la destruction : le moniteur diffusant le film vidéo est couché sur une photocopieuse couleur qui en reproduit les images. La stratification des copies (feuilles de plastique transparentes) reproduit ainsi l’image inversée du bâtiment détruit, et forme elle-même, par entassement, une architecture-palimpseste. D’un bâtiment l’autre, la circularité du processus décrit un « devenir-image » de l’architecture, dans l’entrecroisement construction / dégradation.
L’enjeu d’une forme architecturale vouée à la destruction réside dans son caractère intermédiaire. L’intervalle entre sa disparition et l’échéance d’un immeuble à venir, à la faveur d’un réinvestissement normatif, en fait provisoirement un territoire au statut social indécis, une marge d’indétermination. Le bâtiment ne s’inscrit plus dans le réseau politique que comme vestige. Investissant cet espace, protaTTrioreau exhibent la production de structures anomales, ou irrégulières, immanente au champ de normalisation urbaine. L’architecture n’est statique que par l’identité contrôlée que celle-ci assigne. En proposant une perception alternative, l’installation l’inscrit comme processus polémique. Elle interroge notre confiance en la solidité structurelle du bâtiment, en son immobilité et sa permanence, pour la décrire comme intervalle, passage ou transition.
BATIR, PHOTOCOPIER, FILMER- La fin comme début, le début comme fin et ainsi de suite. Fin de l’installation de protaTTrioreau. Des photocopies plastiques transparentes s’amoncellent, reconstituant par strates successives le récit documenté d’une destruction et la forme d’une nouveau bloc architectural. Ces plastiques sont des reproductions : ils témoignent pour les images d’un film vidéo diffusé par un moniteur dont l’écran est placé sur la photocopieuse. Transparents, leur superposition confère à l’architecture, progressivement reconstituée, une matérialité fantomatique et provisoire. Au terme du processus, un nouveau bâtiment s’élève peu à peu dont la matière même serait la visibilité (les copies), la transparence, le récit d’une destruction.
D’UNE ARCHITECTURE, L’AUTRE- L’installation de protaTTrioreau nous projète dans la question du récit, comme processus, donc durée et narration. Première phase du récit. Une maison, 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, vouée à la destruction. C’est ici que s’opère la première temporalité de l’installation. Une caméra vidéo, posée sur un vérin hydraulique, monte à travers une pièce jusqu’à traverser le plafond percé d’une ouverture, au-dessus de laquelle, à l’étage supérieur, est posée la maquette de la maison elle-même. La caméra, par sa percée, détruit l’intérieur de la maquette, avant de redescendre. Au même moment, à l’extérieur de la maison, au-dessus du seuil, un moniteur retransmet les images filmées (travelling ascendant, destruction, travelling descendant), d’abord en temps réel, puis de façon répétée, en boucles. Première reconstitution d’un événement qui n’a pas (encore) eu lieu. Seconde phase du récit. Le film vidéo est diffusé, extrêmement ralenti, par un moniteur couché sur une photocopieuse qui en reproduit les images, selon un intervalle déterminé, sur des feuilles de plastique transparentes. Les photocopies comme autant de détails de la destruction de la maquette, s’entassent jusqu’à reconstituer l’image inversée du bâtiment détruit. Leur stratification forme une nouvelle architecture. Seconde reconstitution d’un événement qui n’a pas (encore) eu lieu. Récit, c’est-à-dire parcours, d’une architecture, l’autre.
SUPPORTS- Qu’est-ce qu’une transformation, une mutation, une dégradation ? De l’architecture urbaine à cette architecture-palimpseste, protaTTrioreau mettent en œuvre un dispositif d’entrecroisement des supports formant un réseau caractérisé par sa transversalité. La maquette, copie de la maison et représentation première dans l’installation, donne lieu à une représentation seconde : le film de sa destruction. La continuité de l’enregistrement vidéo devient ensuite elle-même la matière d’une stratification, selon un découpage photographique et, à terme, d’une reconstitution architecturale. Chaque support est ainsi successivement éprouvé, comme agressé de l’extérieur, par le jeu d’autres supports, déplaçant respectivement leurs propres frontières. Déplacer le support comme territoire stable et assignable de la représentation, c’est, d’un même geste, confronter les matérialités multiples (maquette, vidéo, photocopies plastiques …) à leur propre épuisement, à leur propre extériorité. Au lieu d’un territoire ou d’une carte, un trajet et un mouvement. De l’architecture à l’architecture, la répétition est la fin d’un réseau de déformations multiples. Pour protaTTrioreau, les supports de la représentation ne s’inscrivent plus que comme moments provisoires et dynamiques d’un processus opératoire, chacun na valant plus que relativement au traitement dégradé dont il est capable. Il va sans dire que, dans cette stratégie d’agressions des différents supports, le processus est polémique, dont la matière même fonctionne comme conflits, destructions, différences. Toute représentation est à ce titre violence, déformation. Remettant radicalement en cause l’espace urbain comme réseau statique, il s’agit, 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, de déplacer notre confiance en la solidité structurelle de l’architecture. La matérialité même du site est rendue, ductile, à une multiplicité qui est aussi fragilité et épuisement. L’installation déploie ainsi un processus polémique de volatilisation des supports. D’une part, volatilisation dans l’acception de « fragilisation » matérielle : d’une structure « lourde » et immobile (la maison) vers une architecture-fantôme, dont la seule matérialité serait légèreté, transition, transition et visibilité. D’une clôture privative et opaque à une transparence ténue, décrivant un devenir-image de l’architecture et de la matière. Au terme : un bâtiment transitoire et qui ne renvoie plus qu’à ce qui le hante ; une construction qui ne se constituerait que comme regard. Mais il faut aussi entendre cette volatilisation matérielle comme épuisement : l’échéance d’une disparition. Le dispositif opératoire de protaTTrioreau s’ordonne comme récit d’une destruction à venir. De même qu’il interroge la pesanteur statique de l’architecture urbaine, il déplace la question de sa permanence, de sa durée. Cette architecture n’est que provisoire : elle est passage et transition.
VITESSES- A cet entrecroisement des supports répond la multiplicité des vitesses de l’installation-récit. La durée qu’elle déploie est composée de péripéties, de micro-récits (l’aventure des différents supports), inscrivant dans le procès de la représentation des intensités successives : ralentissements, accélérations. La vitesse propre à l’installation, celle qui confère sa temporalité générale, se manifeste comme stratégie de lenteur (et ce dès le début de l’installation : lenteur du travelling). Pourtant, sous cette impression initiale, se noue une superposition de rythmes plus complexes. Chaque représentation a sa durée, sa vitesse singulière. L’immobilité initiale de la maquette répond ainsi à ce dont elle est la copie. Le processus de mobilité est introduit dans le dispositif par une représentation seconde : l’enregistrement vidéo, lequel, malgré sa lenteur relative, consiste déjà en une accélération. Mais l’événement représenté spécifiquement par la vidéo est la destruction de la maquette : laquelle, en terme de temporalité et comparativement à sa représentation dans la durée de l’enregistrement, se donne comme brièveté, rapidité. Aussi le film vidéo, bien qu’introduisant la mobilité, consiste essentiellement en une décélération. Si toute représentation est déformation, la violence est ici tant matérielle que temporelle : le rapport de l’événement à l’instance qui le décrit est espacement, étirement d’une durée. Suit une seconde décélération : la vidéo est elle-même ralentie, l’installation atteignant tout à la fois son seuil minimal de vitesse et l’inflexion critique maximale du récit. Il s’agit d’affecter la mobilité d’une pathologie d’inertie, d’étirement. Quel seuil d’épuisement la durée narrative peut-elle tolérer (comme on expérimenterait de quels affects un corps est capable) ? La continuité du processus, par ce ralentissement, subit donc un premier traitement agressif : elle semble comme empêchée. Le va-et-vient rythmique de la photocopieuse forme ensuite une nouvelle courbe ascendante d’accélération. Mais l’installation connaît là, au sein du réseau des représentations, une nouvelle déformation critique de la vitesse : fragmentation répétitive du continuum filmique. Ainsi, c’est l’ensemble du dispositif qui se constitue comme hétérogénéité conflictuelle de durées. La temporalité générale est une ligne brisée faîte de ruptures intensives. Est-ce encore un récit, dans cette stratégie conflictuelle d’hétérogénéités multiples ? Certes, ces déformations fonctionnent comme autant d’agressions extérieures à la durée initiale, mais ces vitesses singulières se modifient réciproquement et, partant, se traversent et se recomposent entre elles. Aussi ne faut-il parler, à propos de 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, que d’unité et de continuité problématiques. Le récit n’est plus une totalité, mais une composition d’hétérogénéités dont les ruptures sont offertes à la béance de la visibilité. L’installation de protaTTrioreau refuse toute préséance tant au point de vue « unité / continuité » qu’à celui « fragmentation / discontinuité ». L’un et l’autre s’affectent intimement : la fragmentation est une composition, de même que le découpage est un montage (au sens cinématographique du terme). Singuliers, les micro-récits tout à la fois construisent et dégradent le processus en son entier, et jouent comme autant de perturbations constitutives. L’unité du processus est laissée béante, ou problématique : ainsi la seconde partie de l’installation (la photocopieuse) peut légitimement être vue indépendamment du site 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, quoique n’étant qu’un détail de 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS. De l’architecture à l’architecture, le dispositif fonctionne simultanément comme composition et possible décomposition, unité et séparation, au sein d’un réseau polyphonique et relationnel de vitesses multiples.
LES 24 VERITES DECOUPEES- De la vidéo-surveillance au champ cinématographique, de la photocopie à la photographie, du découpage au montage : digression à propos du groupe Dziga Vertov. Le film de 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS voit sa continuité fragmentée image par image, décomposition qui est simultanément, reconstitution d’une forme, d’une architecture de visibilité. Dans PRAVDA, il est dit : « Mettre un son juste sur une image fausse, pour retrouver une image juste », phrase ensuite corrigée par VENT D’EST : « Non pas une image juste, mais juste une image ». Tout montage (collure) est découpage (rupture). Faire du montage-enchaînement de deux images, une technique stratégique du conflit, comme les connections disjonctives d’un son et d’une image pour JLG. Opposer au récit comme totalité la juxtaposition découpée d’éléments hétérogènes, comme autant de particules locales et rivales. « Vingt-quatre fois la vérité par seconde », c’est alors cette décomposition de la continuité filmique en ses éléments photographiques. L’image n’est plus juste, mais le détail d’une multiplicité découpée.
ESPACE INTERMEDIAIRE- Le traitement des supports et les vitesses distinctes au sein d’un même dispositif, permet à celui-ci, outre de se constituer comme récit, de penser la transition. On l’a dit, le site de l’installation, 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, est voué à la destruction. Il s’agit pour protaTTrioreau d’accompagner cette transformation, d’en inscrire la mémoire. L’enjeu de la forme architecturale urbaine, la maison dont la clôture privative est de part en part réglée par les normes sociales et juridiques, réside dans son caractère intermédiaire. L’intervalle entre sa destruction et l’échéance d’un immeuble à venir, à la faveur d’un réinvestissement normatif, en fait provisoirement un territoire sans réel statut social et qui ne s’inscrit plus dans le réseau urbain et politique que comme vestige. Un tel espace est alors offert à la possibilité d’un détournement. L’installation met en œuvre, à l’intérieur du champ de normalité qu’est par excellence l’espace urbain, des propositions alternatives en investissant les marges d’indétermination de ce territoire. L’architecture n’est statique que par l’identité contrôlée que lui assigne un champ de normalisation politique. La fixation de cette identité a pour effet la dénégation de tout mouvement, de tout événement, qui dès lors ne pourront avoir lieu qu’à l’occasion d’une destruction / reconstitution.
LA PRESEANCE INVERSEE : LE RECIT- La question ouverte par 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS est celle d’un récit problématique. Un récit, c’est-à-dire à la fois une durée (séquences temporelles) et un trajet (déplacements topographiques). Quels en sont les lieux ? protaTTrioreau proposent la connexion d’un lieu proprement dit (la maison) à un événement (la destruction de la maquette), puis au récit de ce lieu et de cet événement (l’archive, la mémoire). Interrogeant la question du récit, le dispositif nous en montre les ruptures constitutives, partant l’unité problématique. La dernière phase de l’installation peut ainsi être vue indépendamment de ce qui la précède (le site de la destruction), dont elle demeure pourtant le prolongement. Détail singulier de l’ensemble du processus, elle y introduit une discontinuité interne, en pouvant fonctionner séparément du reste, selon une temporalité et une spatialité distinctes. Une possible fragmentation est maintenue dans l’installation-récit. Ce qui, dans la totalité du processus, est continuité, reprise et mémoire, peut légitimement s’ordonner comme singularité, autonomie et événement. Mais protaTTrioreau rendent le récit problématique en un sens plus souverain encore, par l’exposition des documents d’un événement imminent. Quelque chose a (déjà) eu lieu : la destruction de la maquette. Quelque chose n’a pas (encore) eu lieu : la destruction de la maison. Il nous faut alors admettre les paradoxes d’une temporalisation à rebours pour nous tenir face à l’exacte mesure de la liaison événement / représentation. Qu’est-ce qu’un récit ? Le récit est toujours récit d’un événement, cependant il faut immédiatement ajouter que sans récit l’événement n’a pas (eu) lieu. Il n’a pas de lieu de l’événement (en tant que ce qui est passé) est son propre récit. La mémoire mise en œuvre par l’installation 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS s’avère proprement fantomatique, ou fondée sur un pas encore, à l’image de l’architecture-palimpseste finale. Il s’agit d’une représentation sans objet, ou plus exactement de l’inversion du rapport réalité / représentation. Pour que l’événementialité ait eu lieu et s’articule dans un récit, elle doit paradoxalement présupposer sa reprise, sa mémoire. Autrement dit, l’événement « sort » du récit. Reconstitution d’une destruction qui n’a pas (encore) eu lieu, 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS décrit ce mouvement : la préséance inversée du récit sur la réalité qu’il inscrit. Le partage entre l’original et sa duplication est déplacé : dans le processus dynamique de leur préséance inversée, c’est tout aussi bien l’événement « réel » qui fonctionne comme duplication de son propre simulacre. Dans la lignée successive des copies de l’installation, l’original n’a de consistance que fantomatique, et sa copie soit-disant fictive devient elle-même l’événement, que « l’original » imitera.
UN REBUS- Trois instances, donc : le lieu, l’événement (avoir-lieu), le récit (avoir-eu-lieu), dont il faut décrire la circulation, les connexions et les ruptures. Détour par Mallarmé considéré comme un rébus. « Rien n’aura eu lieu que le lieu ». Comment comprendre cette énigmatique formule ? Elle ne peut revenir au « Seul est le lieu », où celui-ci, présence immédiatement donnée, se dispenserait de toute médiation-récit (équivalent : le lieu est lieu). De même : « Le lieu a eu lieu », où s’exprime la fausse préséance du lieu sur son récit différé. On l’a dit, la reprise précède l’événement. Pourtant, « Le lieu n’a eu lieu que comme avoir eu lieu » ne convient pas non plus, où se dit la préséance inversée du récit sur le lieu. « Rien n’aura eu lieu que le lieu » : ce qu’il faut entendre ici, et où le lieu est enfin pensé comme événement, c’est : « Le lieu n’a eu lieu que comme aura eu lieu ». Par l’utilisation du futur antérieur, et non d’un infinitif passé, le récit n’a plus de préséance sur ce qu’il décrit (ce qui, loin de le dépasser, se contente d’inverser, en le conservant, le partage traditionnel entre l’original et sa copie). Le récit est en fait synthèse disjonctive entre un déjà là et un pas encore. Il n’annonce qu’autant qu’il remémore. Il est, de façon indécidable, fuite et fidélité. Aucune préséance ne s’exprime plus, dans l’exacte contemporanéité de l’événement et sa mémoire.
CIRCULARITE SIMULTANEE- Le récit est toujours récit de l’événement : archive. 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, la forme architecturale finale est la reprise, ou la reconstitution d’un événement passé, par entassement de documents. Mais, réciproquement, l’événement n’a eu lieu que dans sa copie, et devient lui-même la reprise paradoxale de son propre simulacre. L’installation de protaTTrioreau est le récit d’un événement dont l’imminence peut donc apparaître à la fois comme (encore) future et (déjà) antérieure. Le récit traverse l’événement comme l’événement traverse le récit : loin de toute préséance, l’un et l’autre n’apparaissent qu’à travers cette relation simultanée l’un sur l’autre. Quelque chose, reconstitué, n’a pas (encore) eu lieu ; mais, par effet de boucle, ce quelque chose a trouvé son lieu comme récit, et a ainsi (déjà) eu lieu par avance, dans le jeu de sa répétition anticipée. 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS, le simulacre n’imite donc pas davantage l’événement, que l’événement n’imite le simulacre, dans ce lien d’auto-constitution circulaire et simultanée. Lorsque se forme, au terme du dispositif de protaTTrioreau, un nouveau bâtiment de feuilles plastiques transparentes, sa texture même peut être dite fantomatique, c’est-à-dire revenante, quoique pas encore venue. »
Renaud Rémond, philosophe et écrivain, Toulouse, France
Art Présence, numéro 28, p. 18-21
BP 1152, 37011 TOURS CEDEX 1BP 1152, 37011 TOURS CEDEX 1 est une installation réalisée par protaTTrioreau à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Tours. Leurs recherches s’articulent autour du système de mobilité des structures architecturales. Pour BP 1152, 37011 TOURS CEDEX 1, il s’agit du déplacement d’un appartement sur l’extérieur du bâtiment, extension doublant la superficie de celui-ci.
Ce projet, NEW TERRITORIES, EXTENSIBLE APARTMENT, HONG KONG project a été développé en 1997 à Hong Kong, s’inscrivant de manière politique dans l’urbanisme de cette mégapole.
La proposition à échelle réduite utilise la salle d’exposition de l’école comme espace architectural indépendant du lieu de monstration.
PASSE-MURAILLES, un drôle de concept pour un drôle de projet
Les espaces urbains en mutation prennent, depuis leurs premiers projets, une place prépondérante dans le travail de protaTTrioreau. Les deux tourangeaux ont un temps installé leur atelier dans un hangar rapidement voué à la destruction. Qu’à cela ne tienne : le lieu de travail devient, au fil du temps, la plate-forme d’un projet destiné à prévenir de la transformation prochaine du local. Quelques mois et un voyage dans les Nouveaux Territoires à Hong Kong plus tard, ils réfléchissent de manière plus précise sur la mobilité des structures architecturales. D’observation en questionnement, ils constituent un prototype d’intervention qui fait, ce mois-ci, l’objet d’une présentation à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Tours. Non loin de là et durant la même période, le duo – qui a fait de l’association de ses deux noms la marque de fabrique protaTTrioreau – présente un projet entièrement autofinancé qui questionne sur l’espace intermédiaire.
Dans une maison abandonnée proche du Centre de Création Contemporaine de Tours, ils ont élaboré un processus visuel qui donne au visiteur l’impression de traverser littéralement tous les niveaux du bâtiment sans tenir compte des sols et plafonds. Depuis, les deux artistes n’ont qu’un rêve en tête : retourner à Hong Kong pour concrétiser ces structures qui viendraient se coller comme des parasites sur les parois des immeubles chaotiques.
Olivier Reneau, critique d’art, Paris, France
Technikart, numéro 28, p. 98
BP 1152, 37011 TOURS CEDEX 1
Vaincre le chaos
Les propositions sont des structures architecturales mobiles, ouvertes, susceptibles de transformations. Sans doute incarnent-elles, comme les concepts en philosophie, autant de fragments « qui ne s’ajustent pas les uns aux autres, puisque leurs bords ne coïncident pas . » Elles sont disjointes. Comment concevoir à quatre mains quelque chose de fixe ? Une proposition ne peut être, simultanément, le fait de l’un et de l’autre. Elle s’immisce plutôt entre, dans la turbulence qui émane de deux pensées, fussent-elles – et elles le sont – complices. Aborder telle proposition nécessite d’admettre qu’il s’agit d’une fraction (parcelle d’un ensemble) qui n’est perceptible (habitable) que dans l’acceptation de son inachèvement. La constellation est plus vaste. Les points qui la structurent (projets qui coïncident avec les lieux) sont seulement identifiés par des adresses (telles des indications de domicile). Les espaces concrets, qu’ils soient ou non institutionnels, font l’objet d’une occupation. Dans le temps du séjour, forcément provisoire, les lieux sont transformés. Rien de cette transformation n’est en principe visible après qu’ils aient été abandonnés (désertés). Ce qui est construit pour être démembré, morcelé (tel un corps), n’est pas seulement une architecture éphémère mais l’espace-temps d’un séjour et sa transformation par le double événement d’une présence et de cette forme de retrait qu’on appelle l’absence, ou si l’on veut par la scansion d’un avènement et d’un évanouissement. Rien ne réunit vraiment les propositions en un projet délimité. Au contraire, elles semblent se détacher l’une de l’autre à travers des variables qui ne confirment pas une perspective close mais une indétermination où se décident des mutations. Il s’agit que la maison – et avec elle ses symboles : institution, pouvoir, économie – soit défaite, que son habitabilité soit incertaine, comme en suspens. La proposition (ou point-repère) n’est pas la structure mais ce qui la ruine, physiquement et conceptuellement, et rend sensible (perceptible) la chaos. « On définit le chaos moins par son désordre que par la vitesse infinie avec laquelle se dissipe toute forme qui s’y ébauche . » La proposition réalisée n’est pas hantée par sa propre unité mais par ce qui l’éloigne et la rapproche de son anéantissement. Chaque proposition est une image arrêtée (un arrêt sur image) à l’intérieur de quoi se reconstitue un mouvement. Ne dirait-on pas qu’on est entré dans une pensée, et que dans cette pensée on se retrouve à mi-distance de ce qui tout à la fois la fortifie et la menace ? La proposition est un fragment de fragment. La pensée s’élargit de se segmenter, de se parcelliser. Et les parcelles entrent en résonance. D’un espace, on considère en surplomb l’intérieur qui est vide. Un autre volume dispose d’une porte qu’il faut pousser. Lorsqu’on pénètre, un mécanisme se déclenche et l’on voit dans un écran l’image brève d’un immeuble qui s’effondre. Les deux cubes sont logés dans une architecture de telle sorte qu’on n’en perçoit pas l’échelle. Dans le deuxième habitacle on ne sait plus où est situé le premier. Il faut ressortir. Refaire le chemin inverse. Remonter à l’étage. Regarder de nouveau le vide. Redescendre. Reparcourir le dispositif. La proposition est un affrontement : « il s’agit toujours de vaincre le chaos par un plan sécant qui le traverse . »
Alain Coulange, écrivain et directeur de l’Ecole Supérieure d’Art, Tours, France
octobre 1999
New Territories, extensible apartment, Hong Kong project
Depuis plusieurs années, Hervé Trioreau témoigne d’une démarche pluridisciplinaire inédite, associant à sa pratique artistique une réflexion sur l’architecture et l’urbanisme. Son travail est largement présenté en France et à l’étranger, et engage des compétences touchant à de nombreux champs de la création contemporaine, installations, interventions, projets architecturaux, textes, vidéos, recours aux nouvelles technologies.
L’urbain est ici entendu comme un « territoire » à la fois géographique, social, politique, jamais figé, toujours problématique. Les interventions de TTrioreau l’appréhendent comme une interface en devenir, aux prises avec la mobilité humaine.
Les propositions d’interventions de cet artiste se situent dans un entre-deux, voire dans un enchevêtrement des espaces privés et publics dont il retourne comme un gant les codes, ainsi son intervention à « La Box », Ecole nationale supérieure d’art de Bourges, où l’exposition se donnait dans la continuité de l’espace urbain. Le passant se retrouvait spectateur, à l’intérieur d’une galerie « dans » la galerie d’exposition et le spectateur, passant, projeté mentalement et physiquement dans l’espace de la ville. Comme dans la plupart des œuvres de TTrioreau, les logiques du regard étaient inversées, l’intérieur et l’extérieur échangeaient leurs dimensions.
En 1997, il met en route un nouveau projet suite à son séjour à Hong Kong. Espace greffé, nomade, extensible, ce projet n’est pas sans rapport, non seulement avec l’utopie d’une architecture mobile des années 60, ouverte à l’appropriation de ses habitants, mais aussi avec la démarche de nombreux jeunes architectes actuels, sur un plan international, en quête d’alternatives. Ce projet de TTrioreau est par essence hybride, entre l’habitat et l’urbain, le sédentaire et le nomade, entre l’espace privé et social, en quête de nouvelles modalités d’interaction avec les habitants, interrogeant la ville ici et là-bas, dans une métropole telle que Hong Kong parmi les plus fascinantes. Entre la fictionnalisation croissante de l’espace urbain, pris dans sa médiatisation par l’image, et le questionnement de ce que peut encore signifier aujourd’hui l’intériorité, les projets de TTrioreau se donnent fondamentalement dans leurs dimensions d’expérimentation, considérant l’architecture comme un outil de prospection de la complexité de notre rapport au monde.
Marie-Ange Brayer, directrice du FRAC Centre, Orléans, France
Dans un texte désormais célèbre, Michel Foucault opposait au XIXème siècle, période obsédée par l'histoire et les thèmes de la crise et du cycle, notre époque, désormais engagée dans une redéfinition de l'espace. « L'époque actuelle serait plutôt l'époque de l'espace. Nous sommes à l'époque du simultané, nous sommes à l'époque de la juxtaposition, à l'époque du proche et du lointain, du côte à côte, du dispersé. Nous sommes à un moment où le monde s'éprouve, je crois, moins comme une grande ville qui se développerait à travers le temps que comme un réseau qui relie des points et qui entrecroise son écheveau. Peut?être pourrait?on dire que certains conflits idéologiques qui animent les polémiques d'aujourd'hui se déroulent entre les pieux descendants du temps et les habitants acharnés de l'espace . » A sa suite, on pourrait maintenant affirmer que nous vivons dans une époque de la dissémination, une époque enfermée dans la trop grande visibilité spatiale de certains phénomènes qui, bien que locaux, s'inscrivent dans une dynamique aux dimensions planétaires. Mais là ou Michel Foucault repérait les règles de formation des discours du pouvoir étatique comme mécanisme d'exclusion, il est désormais possible de dire que le pouvoir de l'état, en tant que médium d'organisation de la société, s'est en partie dissous dans la constitution de sphère d'échanges économiques directement issues des théories néo?libérales.
Concevoir l'économie comme unique régulateur des rapports sociaux nécessitait deux choses. Il fallait en premier lieu ôter aux Etats?nations toute possibilité d'influer sur la constitution de nos identités. Ensuite, il s'avérait nécessaire de jeter le discrédit sur le modèle démocratique actuellement en court afin de mettre en place une « démocratie du management » propre à assurer les besoins des masses. Pour cela, coloniser l'espace public (espace social, politique et territorial) par un système communicationnel propre à transformer le citoyen en consommateur devait se révéler une arme imparable. Tel serait sans doute le rôle aujourd'hui dévolue aux mass médias. Or, cette théorie ne fonctionne pas aussi idéalement que voulu. Détruire l'espace du dialogue social a directement conduit à la construction d'appartenances identitaires et aux rattachements communautaires. La question n'est donc plus de savoir si il faut ou non lutter contre cette idéologie régressive mais bien de voir et comprendre les conséquences définitives que ce processus a eu sur la hiérarchisation des territoires économiques, sociaux et identitaires. Ce questionnement, cette interrogation sur la notion d'identités à l'heure de la mondialisation, est au cœur de la stratégie artistique de TTrioreau .
HongKong, la ville qui ne s'appartient pas comme disait Serge Daney . Si ce territoire constitue le prototype de cette ville mondialisée dont on nous parle tant, c'est que son destin s'est toujours joué ailleurs. Londres, Pékin, autant de centres économiques et politiques qui délibérèrent à son sujet. Ce n'est donc pas un hasard si l'une des pièces les plus importantes de TTrioreau s'inscrit dans ce contexte urbain. Ici, centre et périphérie ne forment plus qu'un amas d'où émergent, telles des bornes incertaines, quelques tours, véritables icônes surmontées de logos lumineux et dont les façades de verre réfléchissent le chaos du schéma urbain. Ici, plus qu'ailleurs, l'espace fait déficit. Il suffit de regarder les personnages qui peuplent son cinéma ou de croiser plus simplement les habitants de la ville réelle ; le sentiment d'espace aveugle prévaut. Les corps se glissent dans chaque interstice sans se voir, sans même se croiser. Et lorsque les êtres se heurtent, c'est pour quelques rencontres aussi exclusives et provisoires que le destin de cette ville. Nos années sauvages (1992) et Chungking Express (1993) de Wong Kar?wai, montraient de façon exemplaire ce motif obsessionnel de la recherche d'un autre perdu dans une densité urbaine qui semble échapper à ses habitants .
L'espace à Hong Kong dissocie les habitants du réel. Cette ville est bien une colonie, un cul-de-sac pour immigrants, lucioles attirées par l'éclat de promesses jamais tenues. Cette colonie, comme toute les colonies, est aussi un décor. Sa beauté se trouve dans ces grands murs rideaux qui habillent les buildings des compagnies internationales. Construits à grands frais, ils en constituent l'ossature visible. Mais son sang, ses tripes, sa merde se trouvent ailleurs, sans doute dans ses milliers d'HLM sordides où s'entasse une population corvéable à merci. De tout ces lieux échoués, Kowloon est sans doute le plus célèbre. L’histoire de ce quartier débute dans les années 50, époque où la ville doit faire face à plusieurs vagues d'immigrations. Ce qui compte alors, c'est la réussite financière de la colonie, l'intégration de celle?ci dans le concert économique de la zone asiatique. Les bidonvilles prolifèrent sur les moindres parcelles disponibles. Qu'importe l'absence d'eau potable, de sanitaires, d'infrastructures, le rêve semble au bout de l'aventure. Le tout se brise en 1952 et 1953. De violents incendies rasent nombres de ces quartiers de tôles et de bois. Le gouvernement improvisent quelques solutions d'urgences. On bâtie à la hâte de grands HLM pour reloger ces dizaines de milliers d'habitants laissés à l'abandon par ces sinistres. Désormais, les communautés feront défauts. La misère loin de s'étaler trouve une nouvelle dimension : les étages, les coursives et sous-sols de ces constructions déjà insalubres. Entouré d'immeubles lépreux qui en constituent l'enceinte, Kowloon se transforme en un labyrinthe de boyaux inextricables d'où suintent toutes les corruptions. Juridiquement, le territoire est une enclave chinoise échappant ainsi à la police de Hong Kong. En son centre, Walled City, le repaire de la pègre et des triades. Dans les plis et replis de la nouvelle cité interdite fleurissent les commerces illicites : prostitution, marché libre de la drogue et des armes. Ce quartier, depuis nettoyé par des autorités chinoises soucieuses d'ordre, constitue un lieu exemplaire à partir duquel il était possible de construire une critique de ce fétichisme urbain aujourd'hui tant à la mode.
La pièce de TTrioreau pose le problème de la ville, le problème de l'urbain dans une cité à la fois intégrée au système économique international tout en produisant simultanément des logiques d'appropriation du territoire différentes de celles de l'occident. Mais ne nous y trompons pas, ici, le thème de la ville n'est finalement que prétexte, illustration parfaite et conventionnelle d'un problème plus vaste : celui de notre devenir au moment où le vivre en commun des hommes se trouve soudainement mis en crise.
New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. se compose d'une structure mobile installée dans un appartement quelconque situé dans les étages supérieurs d'un immeuble. Vidé de ses cloisons, l'espace devient cube de béton dans lequel s'insère très exactement une structure aux murs et plafonds transparents, sorte de seconde peau. Des rails au sol permettent à l'ensemble de coulisser au-dessus de l'espace de la rue. New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. se déploie, investit provisoirement le vide laissé béant entre les immeubles. Le mobilier toujours présent suit le mouvement et devient signe d'occupation de cet espace privé. Exposé aux yeux de tous, c'est à dire exposé aux regards des locataires des immeubles voisins, la structure ouvre sa sphère de l'intime dans l'espace public. L’extrême visibilité des fonctions de l'habitat pourrait laisser supposer que la pièce est conçue comme un lieu de rencontre et d'échange entre les habitants du quartier. Il n'en est rien. L’ensemble est clos sous la transparence de ses parois vitrées. En prenant la fonction d'un cadrage simple et neutre, New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. détermine déjà un contexte urbain particulier : une ville qui plus que toutes autres est ouverte aux expérimentations anarchiques de ses habitants et simultanément totalement enserrée dans une projection rationaliste régulée par les instances politiques et économiques. Ouvert et clos, mobile et pourtant si tributaire d'une structure architecturale, l'œuvre modélise donc un territoire en posant clairement la question de l'espace public. L’espace public est?il encore l'espace utopique de l'échange et de la médiation, ou bien porte?t?il en germe la possibilité d'une guerre entre des forces d'où l'humain est exclu.
Cet ensemble de questions venait d'être posées d'une manière plus abstraite, quelque temps plus tôt, par Jüngen Habermas dans un ouvrage consacré à l’histoire de l’espace public . Il affirmait, entre autre, que le caractère patriarcal de la famille restreinte, attribut de la bourgeoisie occidentale, avait permis au XVIIIème siècle la constitution de la sphère privée. La spécificité de ce territoire reposait sur le simple fait qu'il constituait un nouveau lieu de formation pour des expériences psychologiques, répondant ainsi à l'apparition d'une subjectivité totalement centrée sur elle?même. L’ancienne famille élargie, communauté de soutien des individus entre eux, commençait à disparaître. En démontrant que la propriété privée et le patriarcat constituait le fondement du public, Jüngen Habermas établissait également que l'instauration d'un nouvel espace public au XVIIIème, siècle répondait bien aux mutations de l'Etat et de l'économie. Que ce nouveau public réclame une participation accrue aux affaires de l'Etat, rien de plus normal. Dorénavant, l'espace public pouvait être perçu selon une double acceptation dont chaque terme est complémentaire de l'autre. L’espace public est évidemment un territoire spatial qui se définit comme un domaine non privatif (les rues, les places) régi par un ensemble de règles et de lois. C'est aussi et surtout un espace de médiation, un espace fictif (les journaux, les salons littéraires) entre les citoyens et l'Etat, désormais perçu comme médium d'organisation démocratique de la société. La structure de cet espace résulte de la libre circulation d'une information à la fois objective et échappant à toutes censures. L’espace public est donc un espace d'information et de médiation. On comprend ainsi mieux pourquoi, les grands enjeux du XIXème siècle furent bien la question du droit de vote et de la liberté de la presse. Toutes inflexions sur l'un des deux termes influaient directement sur la structure de cet espace. Ainsi, on peut désormais percevoir dans l'urbanisation de Paris par Hausmann, une réponse directe à la reprise en main du droit de la presse et au relatif élargissement du droit de vote.
Mais ce que Jüngen Habermas repérait soudain dans l'époque contemporaine, la société des années 60, c'était bien une nouvelle transformation structurelle de la sphère de l'intime et de l'espace public. On assistait alors à une privatisation de l'espace public sous les effets d'une culture libérale nourrie de motivations et d'orientations normatives non sans conséquences sur les termes de la démocratie. Entre le siècle des Lumières et la fin des années 60, l'information était devenue un droit pour tous. Désormais, elle pouvait intégrer la sphère consumériste. Conscient de cet état de fait, les luttes pour les droits civiques de la fin des années soixante aux Etats?Unis s'appuyaient aussi sur une production alternative de l'information. De même, la révolte hippy en refusant l'ordre établi attestait non seulement d'un engagement pour réaffirmer la citoyenneté comme contre?pouvoir face aux décisions de l'administration (guerre du Viêt?nam) mais aussi d'un grand embarras quant aux conséquences identitaires de ces phénomènes. Sur un mode plus humoristique, d'autres manifestations de la culture américaine enregistraient la même inquiétude face à ce phénomène insidieux. L'on pense notamment à certaines de ces productions hollywoodiennes qui, de Midnight Cowboy à Easy Rider, semblaient répondre aux idéaux de la contre culture. Afin de mieux comprendre la portée de New Territories, extensible apartment, Hong Kong project., il convient d'évoquer Alteration to a Suburban House réalisée par Dan Graham en 1978. Dans cette œuvre, l'artiste avait transformé la façade d'une maison de banlieue en vitrine. Dan Graham utilisait ici l'un des matériaux de prédilection du mouvement moderniste : le mur en verre ou mur rideau. Ce qui participait initialement d'une utopie démocratique, montrer aux yeux de tous le fonctionnement de l'entreprise, se trouvait ici inversé. Rendre transparent la sphère de l'intime, l'ouvrir vers une plus grande visibilité, la transformer en scène pour l'espace public, démontrait surtout combien l'habitat occidental avait vu sa structure interne profondément modifié. L'ancien système. patriarcal faisait soudain défaut sous l'action d'une sphère marchande à même de déstabiliser les fondements de la structure familiale occidentale. L’ancienne ligne de partage entre un espace semi?privé (le salon), ouvert aux échanges et à la communication, et une sphère de l'intime réservée à l'affirmation de la subjectivité (la chambre, le boudoir), cédait la place à un territoire indifférencié puisque colonisé par les médias (la télévision). Désormais, salon et cuisine ne faisaient plus qu'un, le boudoir disparaissait définitivement et la chambre n'était plus que le territoire résiduel du sommeil et des pratiques sexuelles. Les échanges se déroulaient ailleurs, dans des lieux publics et commerçants normalisés pour la circonstance (cinéma, restaurant, golf, …). Ce que Dan Graham venait de repérer intuitivement, d'autres artistes, à la même époque, l'enregistraient dans des pièces aux codes étrangement similaires. Les Non?sites de Robert Smithson, les interventions de Hans Haacke, certaines performances de Vito Acconci et le Slitting de Gordon Matta?Clark partageaient tous l'idée d'une soudaine dépréciation de la sphère de l'intime au profit d'une esthétisation de l'espace public.
En ouvrant l'intérieur d'un pavillon aux regards des passants, Dan Graham instituait un double déplacement. Ce qui devait rester secret, ce qui habituellement participe de l'organisation sociale de la famille se trouvait soudain exposé au grand jour, comparable en cela à un spectacle. De même, la circulation dans l'espace public se retrouvait soudain projeté sur les murs du pavillon, tel un écran de cinéma au déroulement permanent. Vous l'aurez compris, la notion d'information et de spectacle étaient au cœur de cette pièce. Pour Dan Graham, l'information constituait une nouvelle dimension propre à structurer la subjectivité de chaque individu. Quoique similaire sur les principes, New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. intègre désormais des variables ignorées de Dan Graham.
Ces variables sont principalement au nombre de deux. La première, sans doute la Plus immédiate, revient à s'interroger sur la nature de l'espace public contemporain. Ses mutations attestent?elles de ruptures économiques, politiques ou sociales ? L'importance des notions d'espace public et de territoire urbain dans les discours contemporains n'est'il pas aussi le simple résultat d'une impossibilité à penser la complexité des forces qui régissent notre société ? La seconde interrogation de TTrioreau reposait sur la compréhension du rôle joué par l'information, en tant qu'élément structurant, dans notre monde contemporain. En liant dans une même problématique espace public et information, en transformant un habitat en support d'information, TTrioreau rompait avec un certain nombres de stéréotypes trop fréquemment entendus de nos jours. En effet, les thèmes de l'urbain et de la ville, thèmes du centre et de la périphérie, thèmes de la mobilité et des flux, thèmes des réseaux sont désormais au centre de tous les débats. Théorisée par les intellectuels, récupérée par les journaux, utilisée comme fond de commerce par une classe politique trop heureuse de se partager une thématique facilement solvable électoralement, la politique de la ville est désormais un élément essentiel de la pensée contemporaine occidentale. Bien qu'il existe un véritable florilège de discours, deux modèles principaux peuvent être repérées.
Le premier pense la ville comme le territoire par excellence des principes de citoyenneté, d'émancipation des mentalités dans un espace placé sous contrôle de l'état. En se référant à la ville historique, cette analyse conçoit la politique comme instance de médiation et le fait social comme action de collaboration implicite. Dès lors pourquoi s'étonner si les maîtres mots de ce discours reste sociabilité directe, lien social, co?présence, co?visibilité, bref autant de concepts clés pour l'idéologie de l'être?ensemble. La ville devient alors un théâtre où se met en scène les rapports des citadins sous l'action civique et régulatrice de l'Etat. Cette approche de la ville perçoit son territoire comme une forme, un ensemble d'espaces signifiants, de lieux identitaires : le centre historique, les quartiers administratifs et financiers, les zones d'habitats populaires, la banlieue. Chacun de ces emplacements est porteur de signification qui s'imposent à ceux qui les fréquentent au point d'influer sur leurs représentations d'eux?mêmes et sur leurs rapports aux autres.
Le second type de discours revendique une approche plus contemporaine du territoire urbain en proposant une lecture idéalisée de la ville et de ses mutations. Pour les tenants de ce modèle cinétique, la ville devient réseaux. Sa structure surgit spontanément sous l'action conjointe des technologies et de la révolution des communications. Au sein de cette ville?mégalopole, agglomérats de tissus urbains, des points d'ancrages sont encore repérables : centres historiques et centres symboliques, bref autant de points de connections dans une spatialité sillonnée de réseaux de communications, d'axes de circulations, de nœuds d'activités. La mobilité accrue de ses habitants modèle désormais un type de rapports sociaux inédits. Basés sur la performance, la recherche des partenaires les mieux adaptés à l'optimisation de l'activité professionnelle, ces rapports démontrent que la ville est maintenant un processus, un ensemble de flux et non une disposition de stocks (humains, financiers et marchands). Pour les héros de cette ville de la fluctuation et de la dissémination, sa puissance réside dans son incroyable capacité à démultiplier les échanges économiques, sociaux et culturels. Curieusement, le fait que cette exacerbation des processus concurrentiels appliqués à tous les domaines de la vie individuelle et collective aboutisse à une mercantilisation des rapports sociaux ne semble pas les gêner. Au contraire, le fait que la ville?réseaux conduise à des échanges humains basés sur la confrontation, n'est pour eux que la logique naturelle d'une pensée économique et politique individualiste, libérale et compétitive. Internet est un bon exemple de ce processus. Censé favoriser nos dons d'ubiquité et d'omniscience, ce médium démultiplie aussi les emplois à distance dans une optique proche du management libéral. Ce qu'il faut c'est morceler la cohésion sociale au sein de l'entreprise. Dès lors la solidarité primaire l'emporte sur les intérêts collectifs, l'adhésion politique cède la place à l'allégeance au groupe et l'égalité des conditions sur la liberté d'agir. Cette ville tant vantée, décriée par d'autres, est le siège d'une démocratie technologique de propriétaires et de consommateurs. Structuré par les signes de la distinction, par les codes de la mise en scène de soi, où derrière l'anonymat censé autoriser la liberté se profile en fait un mode d'adhésion très conformiste à une rhétorique du libre échange. Désormais, l'utilisateur et l'usager ne sont plus de mise.
Or, ce que recherche en priorité TTrioreau c'est justement la possibilité de remettre l'homme au centre de ces stratégies en concevant l'espace comme un réservoir de pratiques potentielles. New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. réfute tout autant la ville historique et sa mythologie d'un accomplissement citoyen de l'espace public que cette instrumentalisation de la circulation, de la communication et des technologies de l'échange. « Afin d'inventer des outils plus efficaces et des points de vues justes, il importe d'appréhender les transformations qui s'opèrent aujourd'hui dans le champ social et en particulier dans les cadres de médiations que sont l'architecture et l'urbanisme, de saisir ce qui a d'ores et déjà changé et ce qui continue à muer. La forme architecturale ne prend sa consistance et n'acquiert une réelle existence qu'au moment où elle met en jeu des interactions humaines, un dialogue, dans un espace de relations, un interstice, qui tout en s'insérant plus ou moins harmonieusement et ouvertement dans le système global, suggère d'autres possibilités d'échanges que celles qui sont en vigueur dans le système.» Dans ce cadre, Hong Kong est effectivement un prototype parfait. Cette mégalopole ne peut plus s'inscrire dans l'imaginaire occidental comme l'une de ses villes étendues de l'Orient où se superpose des cultes divers, des ethnies multiples et exotiques, des castes et des classes fortement différenciées. Au contraire, les marges de cette ville dépourvue de centre n'en finissent pas de montrer les stigmates d'une exclusion économique sans rémission. Hong Kong comme Caracas, Delhi et même Los Angeles est déjà une ville à l'abandon. Hormis quelques forteresses paradisiaques pour une bourgeoisie fortunée, on rencontre parfois une petite bourgeoisie qui encore et encore espère intégrer les cercles privilégiés du pouvoir. Le reste, une population frappée d'exclusion, une population qui survit avec moins de cinq dollars par jour. Désormais la périphérie devient centre, norme d'une spatialité que l'on doit percevoir non plus en terme d'harmonie, mais en termes de contrastes, de tensions, de discontinuités, de fragmentations, d'assemblages, de disséminations. New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. déjoue sur un mode dramatique ces multiples discours qui oblitèrent notre compréhension des faits urbains et des rapports entre les hommes. Ici, l'exorcisme touche à ses limites. L'œuvre, ouverte à toutes les utilisations, ouverte à une compréhension technique des problèmes de surface dans une ville où celle?ci fait désespérément défaut, ouverte à la vue des autres, se révèle finalement impraticable. New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. est une architecture d'intentions. Cette notion provient du fameux article de Nathan Silver qui, en 1969, déclarait : « l'intention de l'architecture signifie design (dessein, dessin) ; l'intention de l'utilisateur signifie préférence, souhait, désir. L'intention de l'un ou l'intention de autre fait de l’architecture .» Nul habitant ne peut vivre dans cet appartement. Aucune famille ne peut y résider. L'espace y transforme l'intimité en spectacle. Le projet serait donc une simple projection artistique, objet à la validité incertaine. Rien n'est moins sûr. Au contraire, la solution, à y regarder de plus près, s'avère plus subtile qu'il n'y parait. « Mon projet repose sur l'observation des terrasses pirates, sortes d'extensions presque organiques de l'architecture existante, construites par les habitants de Hong Kong pour augmenter leur surface d'habitation.» Or ce que repère là cet artiste est bien un processus d'appropriation du bâtit. New Territories, extensible apartment, Hong Kong project., justement à cause de son impossibilité à être pratiqué, nécessite de la part de son occupant les plus audacieuses solutions aptes à sauvegarder sa sphère de l'intime. Aucun compromis ne lui est permis. Ses espoirs mais aussi ses maux s'inscrivent dans un environnement mobile.
Dans son travail, l’artiste veille toujours à établir une stricte distinction entre espace et lieu. Michel de Certeau affirmait qu’un lieu est un ordre selon lequel des éléments sont distribués dans des rapports de coexistence. S'y trouve donc exclue la possibilité pour deux choses d'être à la même place. La loi du propre y règne : les éléments sont les uns à coté des autres, chacun est situé en un endroit distinct qu'il définit. Un lieu est donc une configuration instantanée de positions. Il implique une indication de stabilité. Il y a espace dès que l'on prend en considération des vecteurs de direction, des quantités de vitesse et la variable de temps. L'espace est un croisement de mobiles. Il est en quelque sorte animé par l'ensemble des mouvements qui s'y déploient. Est espace l'effet produit par les opérations qui l'orientent, le circonstancient, le temporalisent et l'amènent à fonctionner en unité polyvalente de programmes conflictuels ou de proximités contractuelles. En somme l'espace est un lieu pratiqué. New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. ne possède aucune des ambiguïtés d'une affectation. Ses mutations dues à des voisinages successifs défient la prétendue stabilité de l'espace public. Pour reprendre les termes de Merleau?Ponty, il est espace anthropologique puisque qu'il appartient à un type d'expérience au monde inédit. New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. n'est qu'une solution transitoire qui par sa mobilité même joue le jeu d'un rationalisme réclamé par les autorités. Simultanément, il balaie toute frontière entre intériorité et extériorité. L'homme n'y est qu'un élément, un objet dans un espace cinétique. Renversant les observations couramment admises, l'appartement est un lieu qui devient espace au sein d'un espace désormais perçu comme un lieu : la ville de Hong Kong. Puisqu'il est aujourd'hui impossible de croire que la mise en conformité de l'espace de la ville puisse faire advenir une conformité sociale, puisque l'espace est désormais vécu comme un inducteur de vie individuelle et collective, l'œuvre de TTrioreau développe une pensée de la vie urbaine comme bigarrure, entrecroisement permanent d'activités, de relations, dans des espaces différentiels. Concevoir un appartement mobile et transparent, un appartement ouvert à toute les manipulations, une sorte d'espace de réserve puisque non conforme et non contrôlé par les raisonnements gestionnaires, revenait à construire un pur espace de médiation entre deux registres qui bien que distincts structurent aujourd'hui la forme de la société. Le premier est le modèle de compensation dans la sphère publique d es tyrannies domestiques. Centrées sur la recherche d'une identité bloquée par la volonté de réussite individuelle et la tentation du réconfort communautaire, ce modèle repose sur la mise en représentation de l'individu et de son environnement. Le second consiste en cette neutralisation des handicaps sociaux et des inégalités économiques dans la sphère privée. L'espace public est l'appartement. Il offre la possibilité d'exposer au grand jour ces fameuses tyrannies domestiques. Sa trop grande visibilité ne cache plus rien. Tout est présenté. L'individu se trouve transporté sur une sorte de scène où le public serait toujours mouvant ou absent. Le public idéal serait celui sans cesse mouvant de la rue. L’intimité se trouve dépourvue de son cadre secret. L’inégalité devient toile de fond. Certains ont cru percevoir dans cette pièce un métaphore de la maison-cerveau. Or, l’agencement simple de l’espace ne peut en aucun cas s’apparenter à un symbolisme ésotérique de l’univers. Il ne fait que reprendre sur un mode dramatiquement banal l’idéologie de la transparence qui modèle notre société. Alors que l’œuvre de Dan Graham esthétisait un rapport entre deux types d’espaces, New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. joue pleinement le jeu des puissances libérales. Puisque le marché doit être ouvert, puisque les secrets doivent désormais être bannis, exposons jusqu’à l’absurde les conséquences de cette idéologie. New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. est bien l’antithèse absolue de ces cabinets de curiosité du XVIème et XVIIème siècles censés représenter dans un vaste panorama d’objets les mystères de la nature et de l’univers. L’homme y était platonicien. Aujourd’hui, l’appartement extensible est vide. Rien ne peut s’y inscrire durablement. Tout reste en suspension, sans fixation aucune. Le déploiement de cette architecture est un leurre. Elle singe désespérément les modalités d’allégeances à la nouvelle élite internationale, celle des banques et des grandes entreprises. Ce n’est pas pour rien, que malgré la rétrocession, Hong Kong reste encore l’une des principales places financières de la zone asiatique et la ville la mieux dotée en capacité télématique de toute l’Asie. La greffe de l’appartement extensible ne pouvait se produire que dans un lieu à la fois totalement modelé par ces flux financiers et en même temps capable de générer, grâce à son prolétariat, une culture spécifique.
L’art des installations humaines est riche de rebondissements, de tours et détours, d’appropriations heureuses face à un ordre régnant. C’est en partie la leçon laissée par la banlieue française avec ses zones, ses terrains vagues et ses marges. Loin de vouloir encenser cet exemple (les conditions de vie étaient parfois effroyables), les années 30 sont aujourd’hui perçues par certains historiens comme l’époque où une certaine stratégie de récupération permettait aux plus démunis de trouver les conditions d’une décence qui leur était normalement refusée. En inscrivant leur objet architectural dans une métropole asiatique, TTrioreau refuse toute esthétisation des marges territoriales. Ici, l'œuvre n'illustre pas un propos, aussi séduisant soit?il, sur la beauté et la misère de ces populations oubliées. New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. investit un territoire déjà occupé, un territoire déjà surpeuplé, un territoire où l'on ne s'amuse pas à laisser un espace vide, sans locataire. La gratuité du geste au sein d'une situation d'urgence transforme justement l'œuvre en terrain libre et ouvert. Transformation puissante puisqu'elle engage des hommes, des habitants, des corps, des habitudes. New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. n'est pas une œuvre liée à l'actualité. Elle est machine. Machine d'actualisation de situations désespérées. De telles machines, parce qu'elles introduisent un objet inédit dans l'espace urbain, parce qu'elles déjouent toute logique de rationalisation, parce qu'elles produisent une information distanciée et dramatique sur l'état de notre monde, ces machines donc ne peuvent être acceptées par l'institution et le pouvoir. C'est bien pour cette raison, et nulle autre, que New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. ne fut jamais réalisé. Seul subsiste une maquette à l'échelle 1, maquette présentée à l’Ecole supérieure des beaux?arts de Tours : enveloppe éphémère d’une inscription non encore réalisée.
Que sommes?nous en ce temps qui est le nôtre ? Question obsédante s'il en est dans un monde où les mutations ouvrent sur un avenir qui parait on ne peut plus incertain pour nombre de nos contemporains. Il est vrai que la crise yougoslave mais aussi les tensions continuelles en Asie centrale semblent présager d'un nouvel âge où la multiplication de guerres restreintes semblent l'unique réponse aux différentes crises identitaires. Dans ce cadre qu'en est il exactement de New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. ? Quelle place trouve cette œuvre non réalisée dans la continuelle symphonie de faits politiques, économiques et sociaux ? La question peut paraître dérisoire. Elle possède pourtant un mérite. Celui de poser clairement les termes des relations entre art et politique. En d'autres termes, elle permet de s'interroger sur l'empreinte que peut laisser une œuvre dans un contexte donné. Travailler sur l'espace, perturber le territoire des humains, réfléchir sur l'art des installations humaines n'est pourtant pas un geste anodin. New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. possède plusieurs mérites qui en font une œuvre de tout premier plan. Outre le fait qu'elle insiste sur le fait que l'ancienne dichotomie entre espace public et sphère de l'intime n'a désormais plus lieu d'être, elle ouvre aussi sur des failles qui aujourd'hui se font de plus en plus insistantes. Ainsi New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. porte atteinte à des oppositions que nous admettons comme toutes données. Par exemple entre l'espace de la famille et l'espace social, entre l'espace culturel et l'espace utile, entre l'espace des loisirs et l'espace du travail, entre l'espace de la culture et l'espace de la pratique et de la communication. Toutes ces oppositions sont là, présentes, dans cette pièce unique. Il convient aussi d'insister sur un autre point, non encore abordé dans ce texte. New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. parle aussi de notre espace du dedans. Cet espace chargé de qualités, empli de nos fantasmes et de nos rêves, cette espace où nos perceptions premières nourrissent notre imaginaire. En juxtaposant en un seul lieu réel plusieurs emplacements à priori incompatibles, en organisant un espace d'ouverture et de fermeture qui isole et rend pénétrable l'appartement, TTrioreau indique que cette œuvre se déploie entre deux pôles extrêmes : celui d'un espace d'illusion qui dénonce comme plus illusoire encore l'espace réel et un espace qui est simultanément un espace bien réel, aussi méticuleux et transparent que le nôtre est désordonné, mal agencé, sujet à tous les dégradations. Etre sur la corde raide entre ces deux pôles revient bien à créer une grande réserve pour l'imaginaire. Et si somme toute l'unique fonction de cette œuvre n'était pas de rester à l'état de projet pour mieux captiver notre pouvoir à nous évader, notre pouvoir à construire des architectures de rêves, comparables en cela au travail que nous effectuons devant ces ruines antiques où nous prenons un tel plaisir à recréer et reconstruire par la pensée une cité que l'on sait fausse mais tellement utile pour nos fantasmes et nos voyages intérieurs. Mais ici nulle nostalgie. New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. n'est que le prototype de ruines à venir. C'est sans doute sa force, sa faiblesse aussi.
Damien Sausset, critique d’art, Art Press, Connaissance des Arts, …, Paris, France
« Les logement de la maison hélicoïdale auront la forme d’une tranche de gâteau. Il pourront être agrandis ou diminués à volonté par le déplacement des cloisons mobiles. La graduation par demi-étage évite de limiter le nombre de pièces, le locataire pouvant demander à utiliser la tranche suivante en surplomb ou en contrebas. Ce système permet de transformer en six heures trois appartements de quatre pièces en un appartement de douze pièces ou plus . »
L’ensemble de mon travail s’ordonne comme réflexion critique sur la question des limites ou des clôtures architecturales, et par extension sur celle d’un territoire et de ses frontières. La dimension politique des projets apparaît explicitement, servie par l’utilisation régulière de l’urbanisme et des systèmes de vidéo-surveillance comme supports ou matériaux privilégiés. L’enjeu est de définir, à partir de l’extension du concept de frontières, de nouveaux territoires, des spatialités aux séparations désormais mobiles (interstices). Mes installations détournent l’image, sinon la réalité, des clôtures de sites urbains préexistants pour non plus penser la frontière comme séparation, mais comme mobilité, communication, porosité. Ces dispositifs de transgression s’expriment de façon privilégiée par des propositions de constructions architecturales mobiles (extensives), ou par des jeux sur les limites physique du bâtiment. Toutefois, la production de nouveaux territoires ne renvoie pas exclusivement à cet horizon politique. Les spatialités mises en œuvre relèvent d’architectures plus abstraites : il s’agit des superpositions plastiques de supports radicalement hétérogènes, construisant un nouvel espace où les séparations s’épuisent, s’étirent et s’extravasent dynamiquement, traitant les supports comme des territoires aux frontières ductiles, modifiant les configurations et étendant l’élasticité.
Depuis 1995, ma démarche artistique se déploie dans une perspective explicitement politique. Prendre pour support l’architecture urbaine a immédiatement pour fin d’interroger, de façon critique, l’urbanisme comme champ de normalisation sociale et aménagement contrôlé d’un territoire.Dès mes premiers travaux, j’ai investi principalement des sites en marge des lieux traditionnels d’exposition. A l’intérieur du complexe urbain, mes installations se sont ainsi déployées au sein de zones d’indétermination, réelles anomies architecturales : des espaces provisoirement vacants, des bâtiments voués à la destruction. L’enjeu politique de la forme architecturale réside en effet dans son caractère intermédiaire. J’entend déjouer notre confiance dans la solidité structurelle d’une construction, pour en brouiller l’identité. Il s’agit de substituer aux signes du bâtir et à la permanence immobilière un processus de mobilité affectant l’architecture elle-même. Cette démarche exhibe donc les caractères socialement et juridiquement normatifs des concepts de limites ou de clôtures architecturales. L’intervalle entre la destruction d’un bâtiment et l’échéance d’immeuble à venir constitue une durée équivoque par excellence. La vacance désœuvrée d’un lieu, hors de toute finalité fonctionnelle, en fait provisoirement un territoire incertain, sans réel statut social. Cet espace, en suspens, manifeste le caractère transitoire de l’urbanisme, à rebours de l’identité contrôlée que lui assigne un champ de normalisation politique. Anomal, ce lieu ne s’inscrit plus dans le réseau urbain que comme vestige.
Dès mes premiers projets, cette dimension politique apparaît manifestement : exhiber la production, immanente à l’espace urbain, d’éléments irréguliers, d’anomies architecturales.
En 1998, l’exposition au sein de l’Ecole supérieure de beaux-arts de Tours, BP 1152, 37011 TOURS CEDEX 1., consistait ainsi en un prototype du projet New Territories, extensible apartment, Hong Kong project., conçu en 1997 lors d’un séjour prospectif dans la ville chinoise. Il s’agit d’un projet de construction d’appartement extensible sur le modèle des structures illégales que les habitants, de fait, greffent à leur résidence. Des terrasses pirates couvrent les immeubles de Hong Kong et surplombent les rues, afin d’augmenter les surfaces habitables.
New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. se définit tout à la fois comme excroissance physique d’un bâtiment hors de ses limites murales, et comme percée-transgression hors du champ de normalité que lui assigne un cadastre. La projection d’une terrasse mobile aux cloisons transparentes au-dessus de la voirie renvoie donc à une transgression polysémique du concept de limite architecturale. La discrimination entre intériorité et extériorité s’efface. L’espace privé s’extravase sur l’extérieur, pour définir un nouveau type d’espace intermédiaire, qu’il est possible de caractériser comme intervalle ou interstice. Les terrasses pirates, construites par les habitants de Hong Kong, constituent une multiplicité de stratégies individuelles et locales, formant un réseau d’a-normalisation du territoire. La transparence des cloisons prévues pour ce projet d’appartement extensible implique un nouvel usage de l’urbanisme, où les séparations se fluidifient, où les frontières disparaissent vers une composition protéiforme et modulable des espaces. L’enjeu politique de New Territories, extensible apartment, Hong Kong project. consiste non seulement à exhiber la production immanente à l’espace urbain, d’éléments dysfonctionnants ou irréguliers, mais également à montrer que l’architecture n’est statique que du fait de l’identité contrôlée que lui assigne un champ de normalisation.
De quelles mutations un bâtiment est-il capable ? Il s’agit d’expérimenter quel ensemble de dégradations, de transformations et d’agressions peut permettre un site préexistant. Il faut noter la place singulière que le projet à Hong Kong occupe dans man travail. Depuis 1995, celui-ci se concentre sur les détournements d’espaces : les bâtiments investis sont traités en tant que ready-made pour en permettre de nouveaux usages. Il s’agit moins de construire de nouveaux bâtiments, que d’élaborer et d’ouvrir de nouvelles pratiques au sein de ces constructions. Le projet à Hong Kong, s’il semble annoncer désormais mon orientation vers un travail de construction architecturale proprement dit, ne rompt pas pour autant avec la pratique du détournement. En effet, l’espace-interstice, intériorité ouverte sur l’extérieur, que doit définir l’appartement extensible préexiste déjà sous la forme des passerelles construites par les habitants de Hong Kong. Avec New Territories, extensible apartment, Hong Kong project., il s’agit donc moins de signer une première œuvre architecturale, que de proposer le détournement d’un état de fait.
Dans un très beau texte , Jean-Luc Nancy énonce une étrange hypothèse : peut-être, un jour, ce que nous nommons ville oubliera jusqu’à ce nom de ville. Un nom, peut-être, disparaît. Certaines villes, Los Angeles, Hong Kong ou Singapour, donnent à voir ce processus singulier, qui peut s’étendre progressivement à l’ensemble des grandes villes industrialisées, chacune selon un configuration propre. Avec la discrimination tant visuelle que sociale qui ordonne les rapports entre centre et périphérie, entre bourg et faubourg, s’efface l’image que nous nous faisons d’une ville. Si la répartition géographique des villes européennes fonctionne évidemment comme discrimination inégalitaire, à Los Angeles il n’y a plus de centre. Sans doute, la discrimination sociale s’exerce toujours, par un ensemble de processus de refoulement et d’éloignement. Il s’agit désormais d’une politique de répartition et de séparation des corps tendant à l’invisibilité, à la discrétion : les remparts du bourg disparus ont fait place aux loyers, aux boutiques, aux codes de sécurité à l’entrée des résidences. Mais architecturalement, la ville bourgeoise n’existe plus. Les rues de Los Angeles disparaissent, par l’absence de murs. Les habitations forment de simples axes d’alignement et d’espacement refusant tous les signes du bâtir des villes européennes. Comme l’écrit Jean-Luc Nancy, cette mutation « opère une diffusion de la ville, son évaporation, sa dissipation de fonctions et de lieux dans les espaces périphériques qui deviennent moins périphériques à mesure que le centre s’y extravase, sans pour autant cesser d’être central . » Par cette porosité croissante du centre ville et de sa banlieue, se dessinent de nouveaux territoires aux frontières labiles, mobiles, plastiques. La question n’est donc sans doute plus de s’interroger sur ce qu’est la ville, ou ce qu’elle devrait être, ou encore comment aménager l’urbanisme à la périphérie de nos villes pour en préserver le centre : autant de questions qui réitèrent la séparation obsolète et réactionnaire de la ville et de sa banlieue. La ville n’est pas avec ou sans banlieue ; la ville est dans sa banlieue. Aussi la question ne doit plus porter sur l’identité et la conservation des villes. Il faut bien plutôt se demander quelles relations peuvent être, à travers la ville, établies, inventées, multipliées, modulées. User toujours davantage de cet espace pour nouer une multiplicité de relations. Que peut une ville ? Quelles rencontres permet ou interdit-elle ? Quelles en sont les lignes de forces internes ?
« … Les projets de TTrioreau se présentent comme des tentatives de dépassement des oppositions strictes attribuées à l’architecture : immobile-mobile, permanent-temporaire, dedans-dehors… Le statut de l’architecture est réexaminé par rapport à celui du monument, dont l’expression contemporaine est notamment celle du logement sacralisé, signe de la victoire de la sphère privée sur la sphère publique. A ce statut fixe, TTrioreau veut substituer un statut mobile : celui de la dimension futile et périssable des constructions humaines qui les ont amenés à intervenir dans des mégapoles (Hong Kong), des espaces délaissés (une maison abandonnée à Tours) ou encore dans l’étonnant bâtiment de l’école d’architecture de Nantes. Ce statut mobile implique également que l’architecture ne peut se réduire à une construction, à une forme figées, pour à tout moment devenir une image, une projection. Chaque espace objet d’intervention est ainsi éprouvé dans sa capacité à se transformer, pris dans des séquences, des récits qui mêlent films vidéo, photographie, maquettes ou élaboration de prototypes. TTrioreau s’intéresse aux constructions anarchiques, à l’architecture des non-architectes dans les villes, comme jeux sur leurs limites physiques : pour New Territories, extensible apartment, Hong Kong project., il s’agit d’étudier des terrasses pirates, extensions de l’architecture existante construites par les habitants pour augmenter leurs surfaces d’habitation. Ce principe de greffe, d’excroissance, d’architecture-parasite, décliné notamment par le groupe Archigram dans les années soixante, est largement repris aujourd’hui par une nouvelle génération d’architectes dans des projets d’habitats « nomades », de cabanes ou de maisons mobiles (Philippe Grégoire et Claire Pétetin, Didier Fuiza Faustino, Archi Media, …). On retrouve chez TTrioreau la fascination pour la mobilité urbaine, l’idée d’architecture - dispositif, le principe de flexibilité des éléments assemblés, où l’architecture cherche à communiquer, en temps réel, avec les faits et les usages de son époque… »
« … L’histoire jeune de TTrioreau commence quand deux tourangeaux passionnés d’architecture, Vincent Protat et Hervé Trioreau, se retrouvent dans un hangar voué à la destruction où ils élaborèrent ensemble leurs premières réflexions et expérimentations sur l’architecture urbaine et son rapport aux arts plastiques. De l’aventure architecturale à l’aventure du voyage, les voila déjà partis vérifier leurs concepts en examinant des appartements proliférant dans une grande métropole asiatique en mutation accélérée. Observant les gens qui y vivent, constatant l’organisation architecturale et spatiale des bidon-villes et la construction spontanée justifiée par la paupérisation, ainsi qu’ils l’ont entrepris à Hong Kong, ils en reviennent pour s’investir et l’appliquer dans le décalage de leur région. C’est à Tours dans une maison abandonnée près du Centre de Création Contemporaine qu’il monte un projet en apparence burlesque et qui permettait aux visiteurs de découper chirurgicalement le corps du bâtiment au scalpel visuel. L'intervalle, le passage, l’hybridation, le métissage, la prothèse architecturale, la géopolitique, l’interface sont autant de données qui fondent l’analyse entreprise dans leurs recherches. Une architecture modulaire qui procède par agrégats, raccordements, entassement, juxtapositions et qui trouvent ses applications artistiques dans une dimension humaine… »
« … Le travail de TTrioreau s’inscrit dans une réflexion liée à la nature du réseau urbain. Leurs propositions agissent sur la structure même de l’espace construit. Elles mettent en place des déplacements qui en perturbent notre perception et désignent de façon politique le caractère normatif de l’architecture. Son travail intervient dans les intervalles urbains ; il établit des jonctions dans les rapports intériorité/extériorité. Prenant en compte les enjeux liés à l’urbanisme, et ne visant pas à la seule représentation, TTrioreau crée nécessairement in situ et principalement hors des lieux d’exposition. Il en va ainsi du projet New Territories, extensible apartment, Hong Kong project., conçu pour Hong Kong lors d’un premier séjour de prospection et qui ne peut prendre son sens que dans le contexte très particulier de cette ville. Ce projet d’appartement extensible repose sur l’observation des terrasses pirates, sortes d’extensions presque organiques de l’architecture existante, construites par les habitants de Hong Kong pour augmenter leur surface d’habitation. TTrioreau reprend ce phénomène unique et propose une construction qui s’y intègre, en accentuant l’idée de mobilité et d’ouverture sur l’extérieur. Espace d’observation de la ville, l’appartement extensible met également à nu l’habitat privé, dévoilé à la rue. Il constitue à la fois une architecture potentiellement fonctionnelle qui reconsidère les frontières des territoires publics et privés et un objet symbolique qui s’inscrit de manière politique dans l’urbanisme de cette mégapole… »
« … Les espaces urbains en mutation prennent, depuis ses premiers projets, une place prépondérante dans le travail de TTrioreau. Il a un temps installé, avec Vincent Protat, son atelier dans un hangar rapidement voué à la destruction. Qu’à cela ne tienne : le lieu de travail devient, au fil du temps, la plate-forme d’un projet destiné à prévenir de la transformation prochaine du local. Quelques mois et un voyage dans les Nouveaux Territoires à Hong Kong plus tard, il réfléchit de manière plus précise sur la mobilité des structures architecturales. D’observation en questionnement, il constitue un prototype d’intervention qui a fait l’objet d’une présentation à l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Tours . Non loin de là et durant la même période, Hervé Trioreau, qui a fait de son nom la marque de fabrique TTrioreau, présente un projet entièrement autofinancé qui questionne sur l’espace intermédiaire. Dans une maison abandonnée proche du Centre de Création Contemporaine de Tours , il a élaboré un processus visuel qui donne au visiteur l’impression de traverser littéralement tous les niveaux du bâtiment sans tenir compte des sols et plafonds. Depuis, cet artiste n’a qu’un rêve en tête : retourner à Hong Kong pour concrétiser ces structures qui viendraient se coller comme des parasites sur les parois des immeubles chaotiques… »
NEW TERRITORIES, EXTENSIBLE APARTMENT, HONG KONG project
L’EXTERIORITE DE L’INTERVALLE
(transversalités, réseaux, connections, déplacements, déambulations, marches, démarches).
L’intervalle, écart entre action et réaction, est ce qui apparaît en des points quelconques de plan d’immanence pour permettre que s’y constituent les images, non pas espaces de représentation, mais plutôt espaces de conversion, un dispositif de passage, de transfert d’un mode d’appréhension à un autre, mouvement permettant de les entraîner vers la solution cinétique.
« CECI N’EST PAS UNE REPRESENTATION »
L’image se définie par une sorte de suspension temporelle qui fixe, à un moment, l’action sur une plaque sensible et l’y maintient pour elle-même, en l’arrachant à ses coordonnées d’espace et de temps, une délocalisation devenant événement et, de surcroît, une déterritorialisation éloignant le centre vers les périphéries, un déplacement de l’œil, une défocalisation.
« VISION IN MOTION »
Ex-situ car mobile et délocalisée, l’image / intervalle peut, à l’instar de l’interface, entretenir des connexions permettant un échange entre deux ensembles ne parlant pas le même langage, une communication, un interstice de relations, un espace–temps régis par une économie allant au-delà des règles établies concernant la gestion des espaces. L’intervalle se constitue comme espace, espace entre-deux, stratégique, dynamique, transitif, un dialogue non pas conçu comme un environnement monolithique de déterminations, mais comme un langage, un jeu de structures interdépendantes, une œuvre ouverte favorisant une multiplicité, voire une infinité d’interprétations de lecture et de déplacements : un hypertexte.Les lignes de conjugaisons entre divers modes de territoires tangentiels, entrecroisements d’assemblages de sous-ensembles formant des domaines intermédiaires, des zones liminaires de transitions, deviennent des liens, des relations entre les limites et frontières, des interrelations où l’espace se définit dans les « conflits » et les interstices, fonction de seuil, passage d’une spatialité à l’autre : communication.
De ce fait, la forme ne prend sa consistance et n’acquiert une réelle existence qu’au moment où elle met en jeu des interactions, un dialogue, au sein duquel l’image assume le rôle de vecteur communicationnel apte à déterritorialiser notre perception avant de la rebrancher sur d’autres possibles, un opérateur de bifurcations dans la subjectivité. Cet ensemble combinatoire, dont les trajectoires obliques entraînent l’œuvre à se repositionner sans cesse, se réfléchit dans l’image de synthèse. Celle-ci, démultipliant au-delà de toute mesure la puissance de l’analogie, alors même qu’elle l’absorbe et la fait disparaître en l’arrachant à l’enregistrement du temps, flotte, se détruit, s’objectivise et s’autoreproduit comme le monde où elle se produit. Les images sont prolongées, étendues, transférées, hors de leur contexte, sont unies par contact, contiguïté, approximation, conjonction, prolongement, tension, extension, fracture linéaire et longitudinale, deviennent mobiles, légères, fluctuantes, versatiles, liquides où les contours disparaissent. Les surfaces glissent les unes par rapport aux autres, se superposent, un traitement par masses qui s’interpénètrent, topologies élastiques, territoires panoptiques d’expansion où les frontières sont inexistantes, espaces déformés où intérieurs et extérieurs se mêlent, où les structures sont toujours en décalage avec la façade , où les concepts d’articulation des volumes et de répétition des éléments échappent aux conventions, cut-up , origami et morphing spaces , effet de distorsion cinématique .
Central et prescriptif, dans la perspective classique, l’œil est devenu mobile, face à une nature désormais fragmentaire et contingente : passage de la tavoletta12, le prototype par lequel l’espace moderne de la visibilité s’est trouvé institué, de façon à la fois historique et légendaire, au confluent de l’art et de la science, de la psychologie et de la scénographie (à l’origine de la perspective), à la quadratura , une respiration spatiale, ouvrant un infini dans l’architecture, la dissolvant dans la lumière, où l’espace feint se confond avec l’espace réel, et, est conçu à travers un espace apparitionnel et relationnel comme opérateur complexe de visualisation et d’actualisation simultanée, un processus orienté sur les questions des problèmes de relation dans l’établissement d’un environnement singulier de relations spatiales entre l’objet et l’architecture qui force le « spect-acteur » comme partie prenante de la situation donnée .
De manière identique à l’image, l’architecture se transforme en actuation complexe des procédures de modélisation du territoire : elle ne s’érige plus d’un sol, mais à l’intérieur d’une expérience critique qui opère une mutation des paramètres contextuels et développe une dynamique du lien, de l’échange individuel et social, une communication composée, décomposée par des systèmes de transferts, de transits et de transmissions. Ces niveaux de transports et de transmigrations dont la configuration renouvelle celle de l’organisation cadastrale sont aussi réception collective simultanée , de plus, ne pas la penser comme déconstruction isolée, mais comme partie intégrante du complexe urbain et du réseau de communication qui la constitue .
« PLUG-IN CITY »
« Instant city » et trait d’union, l’architecture, manifeste de ces continuum topologiques, assemble des domaines intermédiaires, des zones de transitions qui réactivent aussi bien les fonctions que les logiques économiques, sociales ou proprement humaines en disloquant les espaces par asymétries , multipliant ainsi métissages, greffes et parasitages. Le déplacement de ceux-ci se crée à cause de la division fonctionnelle de la structure urbaine, du développement parallèle des systèmes décentralisés jusqu’à la construction et l’extension globale des situations communicationnelles et pousse l’architecture vers son « devenir-image » dans l’entrecroisement et l’intersection des modalités du visible.
« OPEN ARCHITECTURE »
Afin d’inventer des outils plus efficaces et des points de vues justes, il importe d’appréhender les transformations qui s’opèrent aujourd’hui dans le champ social, et en particulier dans les cadres de médiations que sont l’architecture et l’urbanisme, de saisir ce qui a d’ores et déjà changé et ce qui continue à muer. La forme architecturale ne prend sa consistance et n’acquiert une réelle existence qu’au moment où elle met en jeu des interactions humaines, un dialogue, dans un espace de relations, un interstice, qui tout en s’insérant plus ou moins harmonieusement et ouvertement dans le système global, suggère d’autres possibilités d’échanges que celles qui sont en vigueur dans ce système.
Vecteurs intersticiels, liaisons et transferts de plans de réalités opposés (intériorités et extériorités), véhiculent des rapports au monde à l’aide de signes, de formes, de gestes et/ou d’objets . Ce « coefficient de l’art », terme duchampien, produit des rencontres d’entités hétérogènes sur un plan cohérent, où les limitations deviennent communications, rapprochements de la sphère privées vers l’espace public, et inversement, un va-et-vient où les frontières, domaines intermédiaires, transitent vers une élasticité, un coulissement entraînant une spatialité extensionnelle des différents territoires. La construction de situations , cette interpénétration des espaces sans distinction entre public, privé et psychologique, amène l’architecture vers la solution cinétique, l’image et l’écran, son support, se meuvent ensemble et sont structurés, à l’instar de l’hypertexte, par un réseau de liens, interfaces et connexions : un urbanisme unitaire .
Dans cet entre-deux, l’architecture s’extériorise en constructions variables et en aménagements temporaires alliant la transparence spatiale à la mobilité, à la flexibilité, à la dynamique et à l’ouverture dans tous les sens du terme, ex-situ. La surface du volume se transforme en une membrane osmotique , mouvante et influencielle, par détournements, inversions, transpositions, distorsions, superpositions, altérations, inclusions, mixages, collages, montages et devient un trait d’union dérivant entre les espacements, une combinaison dont les trajectoires obliques l’entraînent à se repositionner sans cesse. Ce questionnement sur la mobilité de l’articulation des périgraphies de l’architecture, zones intermédiaires qui l’entourent et lui permettent d’être accessible, se caractérise par des essais de coexistence des espaces distincts, fonction transitive du seuil, de médiations entre l’habitat, l’urbanisme et les problématiques des rapports de l’art avec ceux-ci.
En passant, car le passage est relation, déplacement, transfert, par 4, RUE MONTAIGNE, 37000 TOURS , où le périmètre d’un espace privé se fragmentait pour devenir support d’une structure de palettes, alliant transitivité et transport donc mouvement, où la rigidité architecturale, par cette installation prothétique, se muait pour créer une passerelle visuelle entre deux mondes opposés, par CARTON(s) , une interrogation entre deux états, l’un utilitaire et public, en l’occurrence la création d’un mobilier se déplaçant dans un deuxième temps vers le lieu de monstration où le spect-acteur n’avait que visuellement accès au plan sol-plafond, par 114, RUE STEPHANE PITARD, 37000 TOURS , la superposition de deux espaces différents donnant l’illusion au visiteur d’un morcellement physique et psychologique, devenant avec JARDIN FRANCOIS 1er, 37000 TOURS , une enceinte architecturale en stockage, en attente d’un plan, d’une future cartographie, par 1, RUE SERAUCOURT, 18000 BOURGES , le diagramme du pouvoir, œil panoptique sur l’environnement, gérant ou expulsant le citoyen, puis par 35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS , où les multiplications d’échelles déplaçaient les supports, comme territoires stables et assignables, de leurs frontières en extériorités, et enfin par BP 1152, 37011 TOURS CEDEX 1 , l’aboutissement de ces recherches sur la mobilité des structures architecturales, leurs spatialités extensionnelles, leurs déplacements s’inscrivant de manière politique dans l’urbanisme, NEW TERRITORIES, EXTENSIBLE APARTMENT, HONG KONG project s’est développé, pris consistance : intervalle constituant un rapprochement entre intériorités et extériorités, synthèse rassemblant la syntaxe grammaticale de l’architecture face à l’urbanisme et leurs liaisons communicatives, s’est extériorisé, un développement se rapprochant d’une véritable public-cité, plateforme multimodale orientée sur une constitution heuristique de l’architecture, une naissance d’espaces tangentiels de médiations où tous les échanges peuvent être possibles : extension et expansion synonymes de communication.
« … le travail de protaTTrioreau s’inscrit dans une réflexion liée à la nature du réseau urbain. Leurs propositions agissent sur la structure même de l’espace construit. Elles mettent en place des déplacements qui en perturbent notre perception et désignent de façon politique le caractère normatif de l’architecture. Leur travail intervient dans les intervalles urbains ; il établit des jonctions dans les rapports intériorité / extériorité.
Prenant en compte les enjeux liés à l’urbanisme, et ne visant pas à la seule représentation, protaTTrioreau créent nécessairement in situ et principalement hors des lieux d’exposition. Il en va ainsi du projet NEW TERRITORIES, EXTENSIBLE APARTMENT, HONG KONG project, conçu pour HONG KONG lors d’un premier séjour de prospection et qui ne peut prendre son sens que dans le contexte très particulier de cette ville. Ce projet d’appartement extensible repose sur l’observation des terrasses « pirates », sortes d’extensions presque organiques de l’architecture existante, construites par les habitants de HONG KONG pour augmenter leur surface d’habitation.
protaTTrioreau reprennent ce phénomène unique et proposent une construction qui s’y intègre, en accentuant l’idée de mobilité et d’ouverture sur l’extérieur. Espace d’observation de la ville, l’appartement extensible met également à nu l’habitat privé, dévoilé à la rue. Il constitue à la fois une architecture potentiellement fonctionnelle qui reconsidère les frontières des territoires publics et privés et un objet symbolique qui s’inscrit de manière politique dans l’urbanisme de cette mégapole… ».NEW TERRITORIES, analyse décomposant tous les constituants des jonctions entre intériorité et extériorité si représentatives dans la ville de HONG KONG, une recherche, prenant en compte la dimension humaine de l’espace urbain par l’intermédiaire de l’observation d’éléments prothétiques, menée en relation avec les positions économiques, politiques et historiques de cette ville plurielle, tente de parler d’hyperarchitecture.
Un pays, deux systèmes, EXTENSIBLE APARTMENT a été constitué en 1997, lors d’un séjour à HONG KONG, à partir de sa rétrocession à la CHINE mettant ainsi en parallèle, mais aussi en intersection, architecture et politique : la péninsule du « port des parfums » se retrouve dans la même situation que celle de l’appartement extensible, raccrochée comme une greffe à son arbre-tuteur, à l’architecture, son port d’attache. Celui-ci, du fait de sa transparence, devient une enseigne, une publicité, mais aussi un interstice faisant une liaison, un transfert et un rapport entre les deux systèmes cités ci-dessus, la limpidité du verre étant la seule limitation entre l’habitat privé et la rue, lieu public de déplacement.
« CONURBATIONS »
De ce fait, l’hyperarchitecture, infrastructure de communication (relations entre pouvoir public et publics divers, entre extériorités et intériorités), se constitue comme une prolifération en réseau où se réunissent et se cristallisent architecture, urbanisme, image et écran, dynamisée par l’interpénétration des espaces. Ces déplacements se créent à cause de la division fonctionnelle de la structure urbaine, du développement parallèle des zones décentralisées reliées par la construction et l’extension des raccords de communication : ex-situ entraînant des mutations périphériques, transformations urbaines liant public / privé, production / consommation, lieux de transbordements sociaux, économiques et politiques.
L’architecture se détache de toutes fondations pour ouvrir et opérer un déplacement vers un espace hybride où elle peut naître d’un glissement du sol, plissement et décollement de plaques et bandes qui définissent l’ossature et la singularité du bâtiment, d’un « conflit » vers le mouvement d’une dimension ouverte, une échappée géométrique contre l’idée d’inscription territoriale, un déplacement, décentrement (délocalisation / défocalisation) qui ouvre de nouvelles possibilités, potentialités pour ces projets d’échanges image / architecture, de diffusions et débats dont les démarches s’entrecroisent et se chevauchent dans une même voie d’action / réaction : faire mentir le paragraphe 167 et démontrer que les choses peuvent être au delà des codes assumés.
Hervé Trioreau
1997
JARDIN FRANCOIS 1er, 37000 TOURS
Réutilisant la terre issue des tranchées du 114, RUE STEPHANE PITARD, 37000 TOURS qui définissaient la limite extérieure, les fondations, le périmètre, du futur immeuble, protaTTrioreau ont constitué 7000 briques installées sur des palettes. Cette structure transitoire en transit, c’est-à-dire la possibilité d’utiliser les briques pour construire l’enceinte d’une architecture sur un lieu à définir, était mise en mouvement par la maquette du bâtiment à venir qui donnait naissance par l’intermédiaire d’un photocopieur à plateau mobile au plan de masse par empilement de celle-ci.
1, RUE SERAUCOURT, 18000 BOURGES
Cette installation se présente comme une réflexion sur le lieu dans lequel elle se déploie : le château d’eau.
De l’architecture, nous disons qu’elle se fait selon deux directions corrélatives à deux dimensions. La construction est, soit demeure, soit liée à une fonction finalisée. Les deux dimensions de l’architecture sont ouverture comme accueil de la demeure ou fermeture comme expression du pouvoir.
La maison possède une dimension ouverte faisant de son site un lieu d’accueil pour l’homme. C’est cette dimension de l’architecture comme demeure que les textes de Levinas nous invitent à penser.
L’autre dimension est celle dont les textes de Michel Foucault, concernant le rapport entre espace et pouvoir trace le diagramme. La bâtisse n’est plus le site du recueillement mais la manifestation d’un pouvoir.
Le château d’eau est un tel lieu. Sa fin est dans le stockage et la redistribution d’une denrée essentielle. Cette fin suppose un pouvoir qui la régule. Stocker, c’est prélever, redistribuer suppose une politique. La dimension propre de ce bâtiment est sa fermeture de l’intérieur. Le rapport sur l’extérieur relève de la redistribution, en cela ce lieu exprime le pouvoir comme focalisation, comme une certaine idée du pouvoir, celle de la centralisation.
L’installation, parce qu’elle est une installation, est destinée à un regard. Elle questionne le rapport de l’homme à la manifestation du pouvoir. Ici, ce n’est plus l’eau mais l’information qui est l’élément du dispositif.
L’état central, pour asseoir son pouvoir, doit être un état informé, c’est ce que nous rappelle la présence des moniteurs, réel « œil du pouvoir » d’aujourd’hui. Le fût central constitue le stockage des données. Le mouvement des soufflets indique la redistribution de celles-ci selon les points stratégiques de la ville de Bourges (gendarmerie, hôpital militaire, palais de justice, aéroport, aérospatiale, cité administrative, maison d’arrêt, usine d’armement). Ce mouvement repousse le corps du visiteur vers l’extérieur comme si ce dernier entrait par effraction.
L’installation se veut un regard critique des rapports liant aujourd’hui image, pouvoir et citoyenneté.
Surveillance et théorie
« Certains jours il ne faut pas craindre de nommer les choses impossibles à décrire. »
René Char, Recherche de la base et du sommet, Gallimard, 1955.
On me fait part d’un projet d’artiste . Le sens en serait aussi puissant qu’inquiétant. Le dispositif : sur un moniteur, la terre, la possibilité de cliquer sur un point quelconque, apparaît alors une image satellite à l’échelle d’une nation, cliquons encore, une image encore plus précise, une région, à nouveau, une ville, image de plus en plus précise, de plus en plus réelle, dernière image, dernier plongeon dans la réalité : l’image en direct d’une caméra de surveillance retranscrivant la vie d’une rue, d’un carrefour. Il apparaît très vite qu’il s’agit là d’une œuvre limite : non pas qu’elle signifierait l’épuisement des possibilités d’un support (l’art vidéo), mais qu’elle se joue d’un détournement brutal, ce qui lui donne son indéniable puissance, d’un fait de pouvoir établi : la surveillance. Tout se passerait comme si l’art, au terme d’une histoire, s’étant débarrassé de la question de la représentation, inscrirait son propos sur le socle de la réalité, ou plutôt sur l’écran de la réalité visible. Que l’on puisse ou non interpréter cette œuvre comme une mise en garde, elle effectue le rêve mabusien d’un regard total et final (qui à son tour ne puisse être regardé), le rêve d’un panoptisme démoniaque totalement accompli. On ne s’étonnera pas qu’une préoccupation actuelle des artistes soit la surveillance et sa fonction dans la société. Michel Foucault, dans « Surveiller et punir », mène une analyse très complète de ce que l’on appelle déjà « société de surveillance » et montre comment de sa naissance dans diverse procédures au XVIIIème siècle, elle n’a fait qu’évoluer vers la forme hyperbolique du contrôle. A travers les analyses du pouvoir effectuées par Michel Foucault, un mouvement se lit. Ce mouvement, propre à l’Occident, est celui dont le leitmotiv serait : « encore plus de visibilité » ou encore « tout doit se ramener à la visibilité. » Le contrôle serait l’utopie d’une surveillance de tout un chacun sur tous. C’est cette tendance à faire de la visibilité le critère absolu, que nous voudrions aujourd’hui interroger. Que la surveillance, qu’elle soit télé-surveillance en premier lieu, soit l’expression politique de rapport de forces semble être évident. Pourtant, il y a quelque chose, je veux dire dans les travaux de Michel Foucault, qu’il nous faudrait profondément méditer et dont ces quelques lignes ne seront que l’esquisse : Michel Foucault montre qu’il y a une logique dans les stratégies de pouvoir faisant de la visibilité un critère de plus en plus déterminant, pourtant, dans la manière même par laquelle il envisage ses analyses, de par sa méthodologie, Michel Foucault tend à scinder le visible et l’énonçable selon deux espaces hétérogènes. Il nous faudrait tenter l’effort d’une synthèse entre le fond des analyses posant la tendance à l’exigence optique comme un devenir de l’Occident et l’exigence pour la pensée d’une rupture du lien voir/parler.
A la fin du XVIIIème siècle, un juriste anglais du nom de Jeremy Bentham, publie un ouvrage intitulé « Panopticon. » C’est un ouvrage curieux, à la limite de différents genres : il se présente comme un traité d’architecture, une réflexion utopique, ou encore une proposition réformiste de la société selon un principe simple. Bentham s’inscrit dans la grande modification que traverse l’Europe à cette époque, et particulièrement le Royaume-Uni, le passage au capitalisme moderne. Cette transition a pour conséquence la naissance d’une couche nouvelle de la société, couche dont les anciennes techniques de gouvernementabilité (néologisme de Michel Foucault) ne sont plus à même de gérer. Le panoptique de Bentham est la description schématique de ce que Michel Foucault nomme la société de discipline ou société de surveillance. C’est l’événement qui résonne jusqu’à nous sous le regard de ces minuscules caméras qui, de plus en plus, quadrillent nos vies. Le panoptique est le diagramme de notre société, non pas structure fixe, mais son devenir comme machine productive de vérités dans le savoir et le pouvoir. Le système panoptique définit un espace de pouvoir dont le critère est la visibilité. Dans le cas d’une prison, les cellules sont aménagées selon un demi-cercle : chaque cellule jouxtant l’autre, au centre duquel se trouve le regard du surveillant, pouvant à tout moment d’un seul coup d’œil effectuer sa fonction. Le panoptisme opère une distribution individuante des cas. Or pour Bentham, il est évident que ce système ne doit pas seulement être réservé aux lieux punitifs, mais qu’il doit aussi œuvrer dans un sens préventif. La surveillance préventive doit, dans ce projet utopique, abolir la répression punitive. Ainsi, le panoptisme se généralise jusque dans les casernes, les écoles, les usines, bref, deviendra la structure essentielle du pouvoir. Il inaugure une nouvelle expression du pouvoir : cette expression est regard : gouverner passera par une politique de la visibilité. Tel nous semble être le curieux mouvement théorique du devenir de notre société : ramener les techniques de pouvoir à des techniques de visibilité. Le panoptisme instaure une politique des corps dans l’espace, il distribue dans un espace quadrillé les corps selon la possibilité que chacun peut être observé comme individu ou cas particulier. Comme le dit Michel Foucault, le panoptisme assure au pouvoir un caractère visible et invérifiable : chacun, à tout moment, voit le pouvoir sans être en mesure de vérifier s’il est actuellement surveillé mais sachant qu’il peut l’être. En conclusion, le panoptique n’est pas seulement une structure architecturale s’exprimant en diverses manifestations du pouvoir, c’est la structure idéale ou le diagramme de toute société de surveillance. La prolifération aujourd’hui des systèmes de télé-surveillance, ne font que réitérer sous de nouvelles formes techniques le projet de Bentham : la transparence absolue de l’Etat, la visibilité ou l’exigence optique étant le moyen et la fin de ce projet.
Le panoptisme est une politique des corps soumettant ceux-ci à des procédures de vérité dont le critère est l’exigence optique. Pourtant, cette exigence optique, loin de naître au XVIIème siècle, apparaît plutôt comme la répétition du geste fondamental accompli par Platon, consistant à soumettre la vérité au critère de la visibilité. De Platon, on sait qu’il est à l’origine de la philosophie, ou du moins de la configuration de son lieu, et ceci sous la forme de la théorie des Idées. La théorie des Idées soumet la pensée à l’exigence optique de deux manières. Premièrement, la pensée, la philosophie sont définies comme noesis ou theoria, ce qui signifie que celles-ci sont une activité de vision (theoria en grec peut se traduire par vision d’un spectacle), ce faisant, il fonde la philosophie comme théorie. Deuxièmement, la connaissance des Idées, ou philosophie, si elle est une sorte de vision, est elle-même conditionnée par ce qui rend possible toute vision, à savoir la lumière. On retrouve ce deuxième point dans la célèbre analogie du soleil développée dans la République : tout comme la vision sensible est garantie par la présence de la lumière solaire, la philosophie comprise comme théorie est conditionnée par la présence d’une lumière qui éclaire le monde des Idées, tel est le sens de l’Idée du Bien. L’Idée du Bien est au monde de la pensée, ce que le soleil est au monde de la sensibilité : source de clarté, condition d’apparition. Penser serait une sorte de vision, penser se fait sous la garantie de la lumière et la menace de l’obscurité. Il ne faudrait surtout pas se méprendre sur le statut de la lumière, jamais celle-ci, dans son lien avec la pensée, n’est envisagée d’un point de vue métaphorique. La lumière n’est pas la métaphore ou la représentation dérivée de la pensée. Elle est sa condition ou mieux encore la manière dont la pensée, depuis son inauguration platonicienne, se définit elle-même, bref, son mode d’être essentiel dans l’histoire de l’Occident. Il s’agirait de montrer comment la philosophie, jusqu’à Heidegger, a développé sa structure théorique et d’envisager si une autre voie que celle-ci reste possible. On voit en Descartes l’événement qui constitue pour la philosophie le passage à la modernité, ceci avec la figure de la subjectivité et la philosophie de la représentation. Or, quelle est la nouveauté apportée par Descartes ? Celui-ci refonde la pensée dans la possibilité selon les critères de la vérité la plus certaine auxquels le doute méthodique conduit, ces critères qui sont ceux du cogito étant la clarté et la distinction. Une vérité sera telle en tant que claire et distincte. Or, comment penser ces critères en dehors de l’exigence optique qu’ils sous-entendent ? Descartes répète le geste consistant à soumettre la pensée à un critère de visibilité. Heidegger, dont on dit qu’il clôt la métaphysique, reconduit la pensée à son origine grecque et à l’oubli de cette origine. Cette origine oubliée, c’est la pensée de l’être comme tel, ou de sa vérité au profit de la détermination du plus étant des étant. Heidegger décrit le recouvrement de la pensée originelle et la possibilité du retour (le pas en arrière), avec le couple voilement/dévoilement. Penser authentiquement serait dévoiler la vérité, l’être se dévoilant, fiat lux ! Toute pensée, reprenant à son compte l’exigence optique formulée par Platon est théorique en tant qu’elle articule le visible sur l’énonçable. Cette articulation du visible sur l’énonçable est une structure essentielle de la pensée depuis Platon, on trouve ça et là (Lévinas, Blanchot, …) des indications nous proposant d’interroger le bien-fondé de cette structure, peut-être est-il temps d’y œuvrer.
La société de surveillance est au fond la société la plus théorique qui soit. Elle accomplit cette exigence de visibilité et de transparence que l’Occident a formulé lors de ce geste qui n’était pas simplement symbolique, soumettant tout procès de vérité à un principe de vision. Du point de vue judiciaire, le symptôme de cet accomplissement se lit dans le passage d’une stratégie d’enquête à une politique de la surveillance. La prison est le lieu de cet accomplissement. L’enquête n’a pas disparu pour autant, celle-ci reste le mode opératoire le plus sûr pour une procédure d’établissement de vérité, mais il y a dans la surveillance le projet de toucher à une strate en deçà de celle que l’enquête met en œuvre, au fond, mieux surveiller pour éviter d’enquêter. Michel Foucault montre que l’enquête naît avec l’inquisition et que son terme doit être l’aveu. Le stade ultime de la vérité serait alors dans l’aveu, c’est-à-dire dans l’énoncé de celui qui est accusé de sa propre culpabilité. Dans cette stratégie, le lieu de la vérité serait dans l’énonçable, l’aveu de celui qui s’accuse. Le projet de la société de discipline est tout autre : il ne s’agit plus d’extraire la vérité comme énoncé, mais d’imposer la présence de celle-ci, comme a priori, sous la figure d’un regard. La vérité n’est plus dans l’établissement de faits au terme d’une procédure, elle devient comme l’a priori dans lequel nous agissons, non plus énoncé mais visibilité. La prison se constitue comme panoptisme, en cela elle reprend et accomplit l’exigence optique du pouvoir. Mais la prison doit aussi répondre à une autre exigence : dans l’ordre de la justice, elle s’affirme comme lieu de punition. Etre en prison, c’est être puni pour avoir œuvré contre la société. En ce sens, la prison prend à charge la fonction qu’avait le supplice, le bannissement, l’exil ou encore la mort. Cette fonction punitive, elle la reprend tout en la modifiant considérablement. La punition ne sera plus définie de manière strictement négative, mais s’inscrira dans une volonté de redressement, elle se voudra éducatrice et tâchera d’aller dans le sens d’une prévention à toute récidive. Le mouvement qui anime le diagramme de la société de surveillance est double. Du strict point de vue de la prison, il s’agit de passer d’une fonction négative, la punition comme enfermement, à une fonction positive, le but de la prison étant une forme de redressement et d’éducation. De cette manière la prison se sociabilise. Cette mutation de la fonction pénitentiaire va de paire avec une tendance à faire fonctionner la société en son ensemble comme une prison. La surveillance, d’une certaine manière, abolit la relation d’exclusion que la société entretenait avec ses anciens lieux d’enfermement. La structure dedans/dehors éclate au profit d’une interpénétration des deux mondes. Que l’on songe aux expériences menées actuellement dans certains pays, de prison à domicile, où le « captif » purge sa peine chez lui tout en étant surveillé par le biais d’un bracelet informant le pouvoir du moindre de ses mouvements.
On peut lire l’œuvre de Michel Foucault comme une critique de la visibilité. Non pas que Michel Foucault dénoncerait la prépondérance pris par la visibilité, Michel Foucault ne dénonce rien, il nous incite d’abord à penser ce mouvement. Mais Michel Foucault, par sa méthode, nous engage à comprendre, voire à remettre en cause, le lien qui articule la visibilité sur l’énonçable, faisant de la visibilité la condition de l’énonçable. Il interroge le bien fondé de cette articulation, que nous nommerons théorique. Dans ses analyses, il détache l’énonçable du visible. Il accorde un primat méthodologique à l’énonçable. Il fait de l’énonçable et du visible deux couches absolument irréductibles l’une à l’autre. Ce faisant, Michel Foucault rompt avec la tradition théorique, dont la phénoménologie demeure le dernier chaînon, pour qui le visible est la condition de l’énonçable. Ainsi, il rejoint les perspectives inaugurées par Levinas et Blanchot, perspectives que nous nommerons anti-théoriques. Au-delà de la visibilité ne veut pas dire au-delà du langage. Blanchot et Levinas se sont efforcés de penser le langage hors de sa fonction descriptive ou monstratrice accordant au sens un statut primordial. Une pensée anti-théorique placera au centre de son propos la question du sens, le sens n’étant plus ce qu’il faut découvrir mais l’œuvre de la pensée, cette errance, sans jour, ni nuit…
Alexis Cailleton, philosophe et écrivain, Paris, France
catalogue Bandits-Mages, p. 70-72
114, RUE STEPHANE PITARD, 37000 TOURS
Dans l’enceinte d’un entrepôt abandonné alloué par une société immobilière, protaTTrioreau ont investi ce lieu dans l’optique d’un travail collectif.
Déstructurant cet espace promis à la destruction, protaTTrioreau proposent une nouvelle circulation issue des plans du bâtiment à venir (tranchées reprenant la périphérie du futur immeuble).
Par des projections soulignant d’autres parcours, en proposant ce palimpseste, ils invitent le spectateur à déambuler dans cet entre-deux. Quel que soit son choix de déplacement, le visiteur s’inscrit dans la volonté d’évolution, de transformation architecturale, sociale et intime.
114, RUE STEPHANE PITARD, 37000 TOURS. (vidéo)
Ce film est la marque d’une installation ayant eu lieu au 114, RUE STEPHANE PITARD, 37000 TOURS. Cette installation interrogeait la segmentation d’un espace et se donnait comme l’entre-deux transitoire fixé par la mémoire d’un passé et l’échéance d’un immeuble à venir. Il s’agissait, à partir d’une installation éphémère, de tenir ensemble la question même de l’espace et celle de sa fonction.
La vidéo, à sa manière, procède aussi par morcellement. En superposant trois images, renvoyant aux trois niveaux du trajet proposé par l’installation, elle interroge les rapports de l’espace aux temps (temps réel de la « construction » de l’installation, temps composé par le déplacement de celui qui visite).
CARTON(s)
Prototypes de mobilier, propositions pour des chaussures et vêtements, vidéos, maquettes, projets d’architectures mobiles, transmutation d’un mobilier carton à l’usage de la cafétéria en une installation.
Les travaux présentés ici sont l’aboutissement de recherches menées par les départements art et architecture intérieure de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Tours, dans le cadre d’une collaboration avec un industriel. Ceux-ci ont pu, dans cette situation d’interdisciplinarité, développer une réflexion à partir d’un matériau spécifique, réunissant leurs approches et compétences différentes, ainsi que les savoir-faire et les modes de fonctionnement de l’entreprise.
L’intervention proposée par protaTTrioreau se définit comme l’interrogation entre deux états et deux espaces : l’un utilitaire et public, en l’occurrence la création d’un mobilier pour la cafétéria se déplaçant dans un deuxième temps vers la salle d’exposition ; le mobilier se transforme en une installation où le spectateur n’a accès que visuellement au travail.
4, RUE MONTAIGNE, 37000 TOURS
En guise d’introduction, un fait à souligner. Fait trop souvent oublié, dénaturé, voire tout simplement nié de telle sorte que son importance n’en est que plus grande. L’ART PENSE. Ne pas se méprendre sur l’apparente simplicité de cette proposition. Son lieu même d’énonciation, ce texte, sensé fournir une introduction aux propos de protaTTrioreau, exprime déjà cette ambiguïté. Lorsque l’on dit que l’art pense, on ne dit pas qu’il pense à la manière… du philosophique par exemple (ce double qui le hante, sa limite extérieure). Dire « l’art pense », c’est donner au verbe penser un sujet qui le meut, l’art. Chose que Platon avait déjà saisi en pleine lumière. Nous sommes d’accord avec Gilles Deleuze pour dire du platonisme qu’il se constitue comme une doctrine sélective des prétendants. Ici les prétendances, ce sont les prétendants à la pensée. Platon a de très bonnes raisons de vouloir chasser l’artiste, sous la figure du poète, de la cité ; car il sait qu’un tel personnage, de part son être même, remet en question l’univocité philosophique accordée à la pensée. Il est vrai aussi que c’est à partir de ce geste exclusif que la philosophie a su se constituer selon sa propre puissance. En retour, de Platon à Hegel, et aujourd’hui le seul nom de Heidegger, suffit à faire trembler les fondements de tout discours sur l’art, philosophie n’a cessé de vouloir réduire l’art comme pensée à la critique (au sens moderne du terme). Tout d’abord avec la constitution d’une philosophie de l’art, toujours selon cette présupposition que l’art serait une manifestation inconsciente à elle-même de l’esprit, incapable de par sa chute dans la pratique, de penser son fondement et sa finalité, bref son sens. Le sens n’appartient pas à la pratique elle-même, l’art étant l’appel de la philosophie de l’art. Il ne faut pas s’y tromper, l’importance prise par la philosophie de l’art depuis l’idéalisme allemand n’est pas tant l’expression d’une reconnaissance de l’essence de l’art mais plutôt une étape de plus dans le procès de main mise de la philosophie sur l’art. Procès favorisé par l’éclosion de tout un pan artistique dont l’objet se veut le concept.
De même que l’art n’a jamais eu besoin de la philosophie pour penser, nous n’assisterons jamais à un retour à l’essence de l’art. Rien de plus tendancieux que cette mélopée sur un retour à l’essence de l’art, celle-ci débarrassée de son fardeau conceptuel non-artistique. L’essence de l’art, sa pensée n’a jamais traîné un tel fardeau, si ce n’est dans ses écueils, lorsque d’un geste pour le moins obscur, elle décide de son objet comme concept. C’est bien plutôt le conceptuel, voyant en l’art quelque chose lui échappant, qui a-posteriori s’est greffé sur le processus artistique selon le mode d’une fausse nécessité. Le regard triomphateur de l’idéaliste face à l’œuvre le suppliant.
En tant que pensées, philosophie et art produisent des objets, c’est la nature hétérogène de ces productions ainsi que l’irréductibilité de leur lieu de création qui déterminent la différence essentielle entre ces objets. « Ce qui définit la pensée, les trois grandes formes de pensée, l’art, la science, la philosophie, c’est affronter le chaos, tracer un plan, tirer un plan sur le chaos . », la philosophie crée un plan d’immanence, peuplé de concepts, portant le chaos à l’infini. L’art trace une composition esthétique selon des percepts et des affects, portant à l’infini le fini de son plan. Percepts et affects, objets de l’art, ne sont pas réductibles aux perceptions et affections d’un sujet. La grandeur de l’œuvre n’est pas dans la contemplation mais dans la puissance intrinsèque de ses objets. Tous les artistes savent bien que l’on ne fait pas l’œuvre pour un sujet contemplatif. A la manière de Paul Klee, l’artiste sait que l’œuvre s’adresse à un peuple qui n’existe pas. Il est ici nullement question de la position d’un quelconque avant-gardisme, où l’œuvre est ce qui vient trop tôt historiquement pour un public incapable d’une juste perception, mais d’une structure interne à la création artistique ; créer un peuple qui n’existe pas, volonté de créer ce peuple-ci.
Etrange impression que celle-ci, qui à l’instar du consul et de son tournesol chez Lowry ; l’installation de protaTTrioreau nous regarde. Impression qui a bien y regarder, constitue bien un universel de l’œuvre en général, non pas que l’œuvre s’adresse à un sujet à la manière du sentimentalisme adolescent (un tableau fait pour moi, moi qui suis le seul à même de le comprendre), non pas que celle-ci constituerait la relation à un sujet dans la contemplation , l’œuvre est d’abord puissance, cette puissance est regard. protaTTrioreau nous donne à voir un lieu, c’est – à - dire qu’ils le peuplent d’êtres nous regardant. La proposition est simple : un lieu, en l’occurrence une cour intérieure, un vide structuré par l’apparition ci et là d’une ouverture, fenêtre ; lieu dont le sens donné est net – question du regard qui de l’intérieur des appartements, plonge dans ce vide à l’apparence dérisoire.
Nous sommes à l’intérieur de la proposition. Il faut comprendre cet « être à l’intérieur de » non pas comme inclusion, la partie à l’intérieur du tout, au sens naturel où la partie appartient au tout, mais selon un sens proche de celui du passage et du bouleversement. C’est un viol que notre présence ici exprime. Viol déjà entamé par la présence hétéroclite d’une structure verticale à base de palettes, que notre présence dans le passage ne fait que redoubler. A la sollicitation des fenêtres nous regardant, protaTTrioreau ont répondu par de brèves séquences vidéos, d’un format similaire à celui des fenêtres, nous montrant les passages fantomatiques de visages dans la foule, passages exprimant la vérité même de l’image (celle d’être un fantôme) et formant comme le pendant inversé de l’urgence de la manifestation de la présence et du lieu, que déjà les fenêtres nous suggéraient. Non plus la présence vitale du regard dirigé vers nous, mais cette fois une violente intrusion de l’extériorité absolue (le passage d’un visage) pro-jeté sur ce mur censé faire du lieu un intérieur. C’est dans cette douloureuse irruption du passage à l’extériorité que vient se loger la mise en scène dramatique et drôlatique des palettes. Soulignons ici le caractère transitoire en tant qu’elle assume le transit et que son espérance de vie n’en est que plus faible. Dans sa fonction, une palette possède deux attributs : elle sert à asseoir un objet et elle en assume le transit.
Dans la cour, on retrouve l’ambivalence de la palette, mais d’une manière clownesque et perverse. Comme assise, elle est en fonction de l’image, du film. Mais le film n’est pas à proprement parlé projeté à travers la palette ou par celle-ci, il est plutôt dé-projeté, dispersé selon un subtil effet d’agencement de la dispersion – traversant là, s’atomisant ailleurs, fixé par le bois là, aboutissant enfin, après s’être fait joyeusement éparpillé tout entier sur la surface du mur. Il y a un certain comique dans la mise en scène de protaTTrioreau, la palette n’en faisant qu’a sa tête assure sa fonction d’assise, et de l’assise fait une dispersion. Il faut quand même admettre, à la décharge de la palette, que protaTTrioreau exhibant celle-ci dans une stance peu orthodoxe quant à sa fonction, de manière verticale, sont quelque peu responsables de cette comédie.
A la perversité introduite dans sa fonction d’assise répond une autre perfidie envers notre palette, cette fois dans sa fonction de transit. D’abord, cela est notable, la palette ne transite pas ce qu’elle assoit. Si l’image comme telle, dans son aspect « matériel » est l’objet de l’assise , il n’en va pas de même du transit. Ce transit, en fait, n’en est pas un, ou plutôt n’est pas cela. Plus que d’effectuer un passage entre deux endroits, ce dont il est question ici, c’est d’opérer un bouleversement qui au sein d’un même espace effectue l’expérience de l’accomplissement du lieu.
Le problème de l’espace n’est pas un problème secondaire. C’est selon nous, le problème du politique . Toute réflexion, qu’elle soit philosophique ou artistique, sur l’espace, est une pensée possédant une dimension politique. Le problème posé est celui de l’agencement ou encore de l’organisation. Qu’est-ce qu’un espace, sinon d’abord une mise en forme, une organisation ou un agencement ? Un espace se définit selon ces catégories, en retour celles-ci exprimeront à chaque fois un type d’espace particulier. Les analyses de Gilles Deleuze nous sont précieuses à ce titre. Dans Mille plateaux, on retrouve la distinction entre deux espaces – espace strié et espace lisse – déterminés chacun par un mise en forme particulière. L’espace strié est l’espace des coordonnées, il est peuplé de corps qui se répertorient selon des points. L’espace lisse est un espace ouvert, peuplé d’intensités se distribuant selon les lignes qu’elles créent. Le point et la ligne n’entretiennent pas le même rapport selon le strié et le lisse : dans le strié, la ligne est entre deux points, elle est ce qui lie un point à un autre, dans le lisse, le point est à l’intersection de deux lignes, le moment produit par la rencontre de deux vecteurs. L’archétype du strié est le modèle urbain, l’espace est jalonné, sa fin est sa fermeture ; pour le lisse, c’est le désert, l’espace est ouvert, son régime, la continuelle métamorphose. Du point de vue politique, c’est sur le strié que peut se construire l’appareil d’état alors que l’espace lisse est le lieu de la machine de guerre. En réalité, il est difficile de distinguer les deux, car souvent les deux sont réunis en espace se donnant comme un ; néanmoins l’hétérogénéité des deux espaces est de droit, même si de fait la réalité donne à voir un entrelacement des deux. Ainsi les métropoles, relevant de l’espace strié, possèdent à leur périphéries des bidon-villes qui eux relèvent d’un espace lisse. On peut encore souligner à titre d’illustration, l’immixtion d’espace lisse à l’intérieur même d’un espace strié. Ainsi la proposition de protaTTrioreau.
En vérité le bidon-ville ne fait pas partie de la ville tel l’organe du corps, il est à sa périphérie comme une excroissance monstrueuse, comme une excroissance rhizomatique. L’appareil d’état a raison de voir dans le bidon-ville, une tumeur, un grand danger pour sa puissance, car outre le fait que le bidon-ville soit le lieu de la pauvreté et de manière négative celui de la révolte, il est de manière positive l’affirmation d’un autre type d’espace, et donc d’une autre possibilité de concevoir le politique. L’espace du bidon-ville étant résolument hétérogène de celui de l’appareil d’état, ce dernier sent la menace poindre quant à l’illusion savamment entretenue de donner à l’appareil d’état le statut consensuel de seul et unique possibilité offerte à l’effectuation de l’essence politique. Le bidon-ville est d’abord une menace, car sa présence montre que l’espace strié n’est pas le seul cas où quelque chose comme du politique a lieu. Pour cette raison, il est juste de penser que toute immixtion du lisse dans le strié est un acte politique.
protaTTrioreau construisent une proposition rhizomatique dans un espace qui ne l’est pas. On sait qu’une propriété de rhizome est sa capacité, quelque peu inquiétante, à se construire n’importe où, ainsi dans le cadre resserré d’une structure jalonnée selon un espace strié (une cour intérieure). L’installation de protaTTrioreau nous proposent une conversion du regard ; le fait de traverser la ville pour y accéder, sa non-visibilité de l’extérieur souligne le caractère violent du passage. Il s’agit pour nous de faire l’expérience d’un espace lisse fonctionnant comme un rhizome, selon une démarche quasi-initiatique (le fait que l’on ne peut soupçonner l’existence de la structure du dehors, le couloir à traverser, …), au sein d’un espace urbain, strié comme peut l’être celui de la ville de Tours. Cette expérience se traduit en termes de percepts et d’affects.
« Composition, composition, c’est la seule définition de l’art »
Percepts et affects ne sont pas réductibles aux affections et perceptions d’un sujet. Ils sont comme le concept, des êtres de pensée dont la dimension surpasse celle du sujet dans lequel ils peuvent s’actualiser ou non. Percepts et affects s’agencent au sein d’une composition esthétique. Revenons quelque peu sur une impression déjà épinglée : la structure de protaTTrioreau nous regarde. C’est la définition même des percepts et affects que ce regard nous convie à penser. Un percept n’est pas une perception, c’est un être autonome constitué comme un bloc de sensations. Le paradigme du percept est le paysage pictural, le peintre ne représente pas la nature à partir de ses perceptions, il compose un percept, indépendant du sujet percevant, un être de pensée composé comme un bloc de sensations. Du fait qu’il est cet être à part entière, le paysage du peintre nous regarde. Il en est de même de l’affect, qui n’est pas le sentiment de l’artiste, ni celui de quiconque face à l’œuvre, mais un être autonome, lui aussi bloc de sensations, être de pensée tout comme le percept. Une autre disproportion existant entre la perception ou l’affection d’un sujet et le percept ou l’affect crée par l’artiste, réside dans le caractère éternel de l’être de ces derniers se distinguant du régime furtif et éphémère des deux premiers. Peu importe que la toile ou la structure de protaTTrioreau soit détruite, ce qui compte c’est de donner aux sensations un caractère d’éternité dans la durée même d’une perception. Une œuvre d’art, qu’elle soit plastique, littéraire, musicale ou autre, est une composition esthétique de percepts et d’affects. C’est une telle composition, au lendemain de la mort de Gilles Deleuze et de Don Cherry, que nous voulons saluer dans la proposition inaugurale de protaTTrioreau.
Alexis Cailleton, philosophe et écrivain, Paris, France
1995